Description
Date de publication: 2021
Éditorial : Le savoir, état critique
Karim Basbous
AfficherFaisons le pari, avec Foucault, que le savoir est lié au plaisir. Le projet architectural conforte cette hypothèse : dessiner des bâtiments est une activité qui nous fait oublier le poids des heures, alors même que nous produisons un savoir. Ce savoir qui porte sur des lignes, des mesures et des matières n’a pas toujours été institué, son étendue reste difficile à cerner et sa transmission a connu plusieurs formes. Universel tout en étant attaché à des cultures locales, spécifique mais sans être réductible à un métier, ce savoir qui se situe entre la théorie et la pratique est de l’ordre du mystère. Toutefois, le grand écart qu’il revendique entre la science et l’art ne suffit pas à expliquer son prestige. Interrogeons-nous sur la provenance de ce savoir que jadis les traités tentaient de rassembler, et sur son destin, depuis que l’intelligence artificielle défie la pensée humaine. Son évolution au cours des dernières décennies témoigne-t-elle d’une lente érosion, ou d’une transformation ? L’école y joue-t-elle encore un rôle ? La recherche, qui affirme prendre ce savoir pour objet, livre-t-elle des résultats à la hauteur de ses ambitions ? Le principe d’un développement durable, si souvent invoqué, a-t-il transformé le savoir autant que le marché de la construction ? Telles sont les questions qui inspirent ce numéro du Visiteur, sans oublier la plus importante de toutes : l’invention d’un plan ou d’une coupe est la première manifestation de ce savoir. En la matière, les projets de maisons ont toujours servi de laboratoire à idées. Ceux de Mies van der Rohe ont établi un minimalisme qui ferait école aux dépens de la commodité, comme si un nouvel académisme moderne avait remplacé celui des Beaux-Arts. En retraçant les difficultés que pose le plan fluide miesien lorsqu’il s’agit de loger une famille, Olivier Gahinet amorce un travail critique qui reste à poursuivre, notamment sur les « illusions » du plan, qui rappellent étrangement celles que dénonçait Le Corbusier il y a un siècle, dans Vers une architecture. Jean-Pierre Chupin revient sur Colin Rowe, l’un des grands penseurs du siècle dernier, avant le tournant des années 1970 qui allait faire de la théorie architecturale le terrain d’application de concepts importés de la philosophie. Tout savoir implique des méthodes, et en architecture, le comparatisme en est une, par laquelle l’auteur de Mathématiques de la villa idéale mêlait étroitement la connaissance historique et la théorie de la forme architecturale.
Si le comparatisme est un exercice savant, l’analogie comporte quelques risques. Pascal Engel se penche sur ce thème, en explorant les multiples aspects de la connaissance architecturale, opposant notamment celle de l’architecte à celle de l’habitant. Ces questions occupent également Alessandro Armando et Giovanni Durbiano, pour qui le travail de la critique ne saurait être uniquement postérieur au projet architectural : c’est au sein même de la conception que l’architecte se doit d’être critique de sa propre production, conduisant le savoir à se protéger de ses propres errances. La question d’une « négativité » en architecture est périlleuse, mais elle promet une clé de lecture profitable : y a-t-il un envers du savoir, une sorte de pensée en creux, mais qui ne sombrerait ni dans le cynisme ni dans l’ignorance ? Si une telle pensée existe, quels en sont les enjeux et les personnalités ? Ce travail spéculatif mené par Can Onaner éclaire d’une lumière noire l’oeuvre de Loos et de Rossi, tandis que celui de Philippe Potié se tourne vers Mies, Wright ou Eames, pour y déceler la présence des mythes.
Le savoir de l’architecte ne peut, au nom de la technique, s’affranchir de la nature, bien que celle-ci puisse être manifeste ou dissimulée. De l’ornement inspiré du règne végétal à la baie moderne qui fait de la forêt un spectacle, l’architecture a toujours eu rendez-vous avec cette réalité du vivant, avec laquelle composent aussi bien le langage classique que les figures radicalement modernes. Dans l’édifice du savoir architectural, les anciennes fondations sont invisibles, mais elles sont encore là et reviennent à Vitruve. Le savoir du premier théoricien dont l’histoire a gardé le nom n’est pas tant dans les canons et les règles, mais dans la posture et la méthode. Pierre Caye fait de l’architecte d’Auguste un penseur indispensable à la critique du système constructif actuel ; aussi étrange que cela puisse paraître, c’est à partir du De architectura que l’on peut faire le diagnostic d’une crise de la profession d’architecte. Laurent Salomon se penche sur cette même crise, en s’appuyant sur l’oeuvre de l’un des derniers grands bâtisseurs, mort récemment, pour qui l’architecture – ce qui en fait un descendant de Vitruve – est une science à l’échelle du territoire : Vittorio Gregotti. L’auteur décrypte les discours, les injonctions et les codes auxquels la pratique architecturale est désormais confrontée, par lesquels le savoir se transforme en valeur marchande en même temps qu’il perd de sa hauteur.
Peter Sloterdijk, à qui l’on doit la trilogie des Sphères, où l’architecture apparaît comme l’une des enveloppes dont l’homme s’entoure pour faciliter son existence, revient ici sur le rapport de l’individu à ces « milieux » dans lesquels il s’immerge, tant matériels (comme l’intérieur d’un bâtiment), qu’immatériels (par exemple un régime politique), mais aussi psychologiques et technologiques. L’état critique des savoirs suscite de nombreuses questions, en ayant l’architecture pour objet ou en prenant appui sur elle pour observer le monde. Du statut du savoir dans nos sociétés et de l’influence qu’il exerce sur le cours des choses, dépendent nos institutions et, in fine, notre savoir-vivre.
Chronique d’un dépeçage
Laurent Salomon
En savoir +De la pensée de Vittorio Gregotti, récemment disparu, on retient une vision unificatrice. C’est à la lumière de cette pensée que cet article pose un regard critique sur l’état actuel de la discipline architecturale, réduite au statut d’accessoire par des approches urbanistiques de moins en moins urbaines, assignée tantôt à faire valoir les vanités d’un capitalisme triomphant, tantôt à promouvoir les pistes techniques prétendant œuvrer contre le réchauffement climatique, sans que quiconque ne s’interroge sur la finalité de ces initiatives. L’émergence récente du « spécialiste » est à la fois l’agent et le symptôme de cette aliénation. Son action utilise la crise écologique comme une couverture pour servir avant tout les intérêts d’un marché constamment avide de nouveaux produits. C’est d’ailleurs la raison première pour laquelle les « spécialisations » sont encouragées par l’État, promues par l’industrie et désormais intégrées aux programmes des écoles d’architecture. Lorsque nous aurons compris qu’il ne suffit pas de renouveler en permanence notre arsenal technologique pour sauver la planète, l’architecture pourra retrouver sa place dans sa capacité à produire, à diverses échelles et avec les outils les plus pertinents, les lieux utiles d’une société responsable.
« Architectura est scientia… »
Pierre Caye
En savoir +L’architecture vitruvienne ne saurait se réduire à la collection de ses formes aisément reconnaissables ni à son répertoire ornemental rigoureusement codé. L’architecture vitruvienne est d’abord une méthode d’édification ou, plus précisément, de surédification du monde. Mieux encore, elle en est la « science » comme l’affirme fièrement la théorie architecturale de la Renaissance : une science encyclopédique qui mobilise l’ensemble des savoirs pour asseoir sa maîtrise sur le chantier artisanal et empirique, et davantage une science architectonique qui soumet à sa méthode de conception et de réalisation un large éventail de produits et d’ouvrages qui dépasse largement ce que nous nommons aujourd’hui « l’architecture ». Cette situation épistémologique explique la domination symbolique de l’architecture vitruvienne sur le monde pratique à l’âge humaniste et classique. Mais les prérogatives scientifiques de l’architecte humaniste sont aujourd’hui passées dans les mains des ingénieurs et des bureaux d’études selon une tout autre signification des savoirs et de leur rapport à la construction du monde. L’architecture contemporaine reste néanmoins un savoir privilégié, plus souverain encore que la science des Anciens, un savoir transcendantal, l’intelligence du temps et de l’espace, dont dépend l’ensemble de la praxis humaine.
L’architecture, l’esprit du temps
Philippe Potié
En savoir +Alors que le temps de la nature s’impose comme une dimension incontournable de la culture, l’architecture, héritière d’une pensée élaborée autour de la technique pendant le XXe siècle, rencontre quelques difficultés à réinventer ses modèles. Nous faisons l’hypothèse que c’est autour de nouvelles perceptions du temps qu’émergent des figures intégrant la dualité entre nature et culture dont Lévi-Strauss nous avait montré qu’elle constituait le ressort de l’imaginaire. Dépassant l’injonction contradictoire de préserver la nature tout en construisant des édifices, la discipline redécouvrirait alors les dialogues entre Apollon et Dionysos, Prométhée et Déméter en repensant le rapport de l’édifice avec le jardin, de la structure avec l’ornement. Une temporalité plurielle semble se déployer, moins rigide, qui met en scène plus librement une esthétique des contraires. Une histoire se dégage alors qui relie dans une même perspective les premières tentatives postmodernes et les expériences écologiques. En posant l’architecture comme une théâtralisation du temps, la nostalgie patrimoniale et les performances high-tech, l’expressionnisme déconstructiviste et la pureté minimaliste participent d’une même dramaturgie et d’une même comédie où se conjuguent des temps retrouvés.
Le mystère de la chambre en plus
Olivier Gahinet
En savoir +L’architecture, comme la peinture, est une connaissance hors du langage. Cela ne devait pas empêcher les écrivains d’en parler, mais ils se sont plus souvent attachés à commenter la peinture, art plutôt « privé », que l’architecture, art pourtant « public ». Paradoxalement, ce moindre intérêt nous aide à comprendre l’architecture : quelque chose de plus spécifique encore résiste en elle au langage, au commentaire, à l’élucidation, et échappe à la glose. Cette chose qui reste quand tout a été dit, c’est le savoir de l’architecte, la connaissance par le projet. Comme les peintres, les architectes se parlent entre eux à travers les siècles ; c’est cette conversation qui va nous aider à cerner cette connaissance par le projet. On retracera pour cela la fortune projectuelle (comme il y a des fortunes critiques) d’un projet dont il ne reste que les mauvaises photos de deux dessins perdus : le projet de maison en brique de Mies van der Rohe (1923). On essaiera en même temps de répondre à la question – très importante – que se posent tous les architectes qui ont eu à dessiner une maison : où mettre les chambres ?
De la négativité en Architecture
Can Onaner
En savoir +Chaque fois que l’architecture se veut indéterminée, alternative ou marginale, le néolibéralisme trouve les moyens d’en tirer profit. Chaque fois que l’architecture se définit par une volonté de dépendance écologique, économique ou sociale, elle court le risque de disparaître sous le poids des forces qui la conditionnent depuis l’extérieur. À l’inverse, si elle prétend à l’autonomie fondamentale de sa discipline, sur la base d’une culture spatiale et architectonique, alors l’architecture se retrouve devant l’écueil inverse : celui de s’enfermer dans un cénacle sans grande audience, dépassée par les forces économiques qui n’ont que peu à craindre de cette illusion d’autonomie. L’architecture, comme mode de pensée et de narration du monde, n’a-t-elle pas de nouveau besoin de la négativité critique, pour éviter d’être dépassée ou de disparaître ? À travers un court récit de la négativité en architecture avec les figures d’Adolf Loos, Aldo Rossi et Andrea Branzi, cet article se propose d’éclairer les multiples enjeux du passage de la modernité à la condition postmoderne, en distinguant trois aspects de la négativité : existentielle, esthétique et politique. En passant de l’ambivalence à la radicalité, puis de la radicalité à la neutralité, nous verrons que la négativité a perdu de sa puissance critique. C’est pourquoi nous proposerons de revenir à l’ambivalence, au beau ambigu et à l’autonomie négative comme mode d’existence. Celui d’un Bartleby : « I would prefer not to ». Entre cruauté des formes et révolte des foules, entre monuments hors du temps et événements éphémères, entre autonomie de la théorie architecturale et hétéronomie de ses modes de production, la négativité consistera à constituer des forces antagonistes parmi lesquelles le sujet peut se tendre et se déplacer.
Ce que sait l’architecture (Colin Rowe pionnier du comparatisme)
Jean-pierre Chupin
En savoir +Dans l’addenda que Colin Rowe rédige en 1973 pour la réédition de Mathématiques de la villa idéale se trouvent rassemblés, en moins d’une page, les termes principaux de l’équation méthodologique qu’il n’a cessé de reformuler au fil de ses écrits en autant de parallèles, d’analogies, de comparaisons mais également de différences. Ce comparatisme ne porte pas sur de simples rapprochements, comme le regretteront des historiens de l’art, mais sur une méthode d’analyse architecturale croisant phénoménologie de la perception et décryptage de la forme en autant d’appariements.
Pour comprendre la finesse des intuitions de Rowe, l’explicitation méthodologique peut s’effectuer en plusieurs temps. Un survol des origines de la démarche est incontournable. Tout autant qu’un résumé des critiques instillées par Reyner Banham en ce qu’elles perdent aujourd’hui de leur vigueur à la lumière des fines analyses biographiques d’Anthony Vidler, lesquelles confirment l’intérêt de Rowe pour les questions méthodologiques. Cela conduit à souligner le rôle des diagrammes et de la pensée visuelle, avant de clore par un inventaire à la Prévert des énoncés confirmant un comparatisme des différences, dans le texte même de l’essai de 1947. Il faudra d’ailleurs se demander pourquoi le sous-titre de l’article initial paru dans Architectural Review fut systématiquement supprimé dans les éditions qui suivirent.
Pour Colin Rowe, l’histoire de l’architecture n’est pas faite que de recommencements, mais elle laisse des traces tangibles qui précèdent toute forme d’innovation. Ce savoir incarné – ce que sait l’architecture est visible, le plus souvent, dans des œuvres marquantes. Cette méthode, qu’il ne cherchera plus à théoriser dans ses travaux ultérieurs, sera pour nous le chantier à reprendre.
L’architecture comme plan de connaissance
Pascal Engel
En savoir +Il peut paraître paradoxal d’envisager l’architecture comme produisant et transmettant une connaissance, car toute connaissance suppose des représentations vraies, alors que les productions architecturales ne sont pas des représentations. De plus, si l’architecture est un art, elle relève de jugements et non cognitifs. Enfin, parce qu’on admet souvent que les productions architecturales ont une vocation utilitaire. Le fonctionnalisme contemporain traite l’architecture en matière d’action, d’expérience et d’espaces sociaux. Je propose de défendre ici le « cognitivisme architectural », à travers deux thèses. D’abord en mettant en avant l’idée que les œuvres d’architecture sont des possibilités d’action fondées sur la perception d’ »affordances ». Ensuite en associant ces possibilités d’action à des possibilités conceptuelles, sur la base d’expériences de pensée. L’architecture n’implique pas des connaissances mais des plans de connaissance.
Performativité de la critique
Alessandro Armando et Giovanni Durbiano
En savoir +Nul n’oserait soutenir que le savoir de l’architecte n’est pas un savoir critique. La critique du monde est en effet inhérente à tout projet qui vise à le transformer. Néanmoins, l’ampleur de la perspective ouverte par la conscience critique est un produit historique, qui change avec le temps. Depuis une quarantaine d’années (au moins depuis qu’on a accusé les architectes italiens d’opérer un « repli stratégique de l’architecture moderne »), une certaine notion de savoir « critique » assume une fonction de plus en plus prépondérante. Après la crise du lien supposé par les modernes entre langage architectural, programme de transformation sociale et perspectives éthiques, le concepteur n’agit plus seulement en fonction d’une disposition déterminée dans l’espace et le temps ; mais à travers le projet il ouvre un discours sur le monde qui présuppose d’autres espaces et temps futurs invérifiables. C’est ce qui s’est passé en Italie entre les années 1950 et 1980, où le projet a été interprété comme le véhicule neutre d’un discours élaboré principalement dans la tête de l’architecte. La prévalence de l’intention permet ainsi à l’architecte de proposer sa propre « vision du monde », dont la légitimité, fondée sur l’origine et non sur les effets, n’a pas besoin d’être négociée avec quiconque, et court constamment le risque d’être autoréférentiel. Si en revanche le projet se comprend comme le produit d’une stratégie continuellement déviée par un certain nombre d’instances, alors la condition critique perd son statut de tierce partie, et entre dans le jeu de l’action comme un outil parmi d’autres de la performance du projet. Placer le savoir critique à l’intérieur, et non au-dessus, du travail pratique permet d’ouvrir une réflexion systématique sur la puissance du projet. Cela implique un déplacement de l’attention du sujet-auteur vers l’objet-projet, et permet un traitement analytique et vérifiable des pratiques projectuelles. L’action projectuelle peut en effet se comprendre comme un ensemble spécifique de compétences et de pouvoirs à mi-chemin entre technique et politique, dimension bureaucratique et symbolique, prévision et narration.
L’architecture comme art de l’immersion
Peter Sloterdijk
En savoir +S’il est un espace susceptible d’offrir un volume d’immersion, c’est bien celui de l’architecture, art qui permet à celui qui y plonge de vivre et d’éprouver le volume qui l’entoure. Mais depuis les « panoramas » du XIXe siècle jusqu’aux lunettes de réalité virtuelle, quelles conséquences les nouveaux modes de vision apportés par la modernité, c’est-à-dire les immersions « artificielles », ont-ils eues sur la philosophie de l’architecture ? Et comment les penseurs de l’architecture, de Platon à Valéry, ont-ils envisagé cette question ? C’est la question que pose cet article, après que l’auteur a retracé, dans la trilogie Sphères, le processus qui a mené l’homme de la bulle à l’écume, et tout particulièrement sur le phénomène de l’habitat de l’homme dans le « palais de cristal ». Où nous mène l’immersion ? Dans quel univers nous conduit-elle ? Dans quelle mesure l’immersion architecturale est-elle aussi une immersion dans l’empire ? L’architecture, du fait même qu’elle traite de l’immersion, est-elle elle une forme de totalitarisme ? C’est en s’appuyant sur Valéry et son Eupalinos que l’on peut considérer une conception de la maison comme « installation de plongée » : un espace mis en forme et remplaçant l’environnement premier, un espace de servitude volontaire en somme.
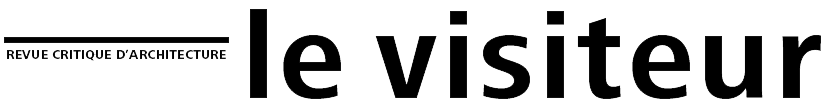
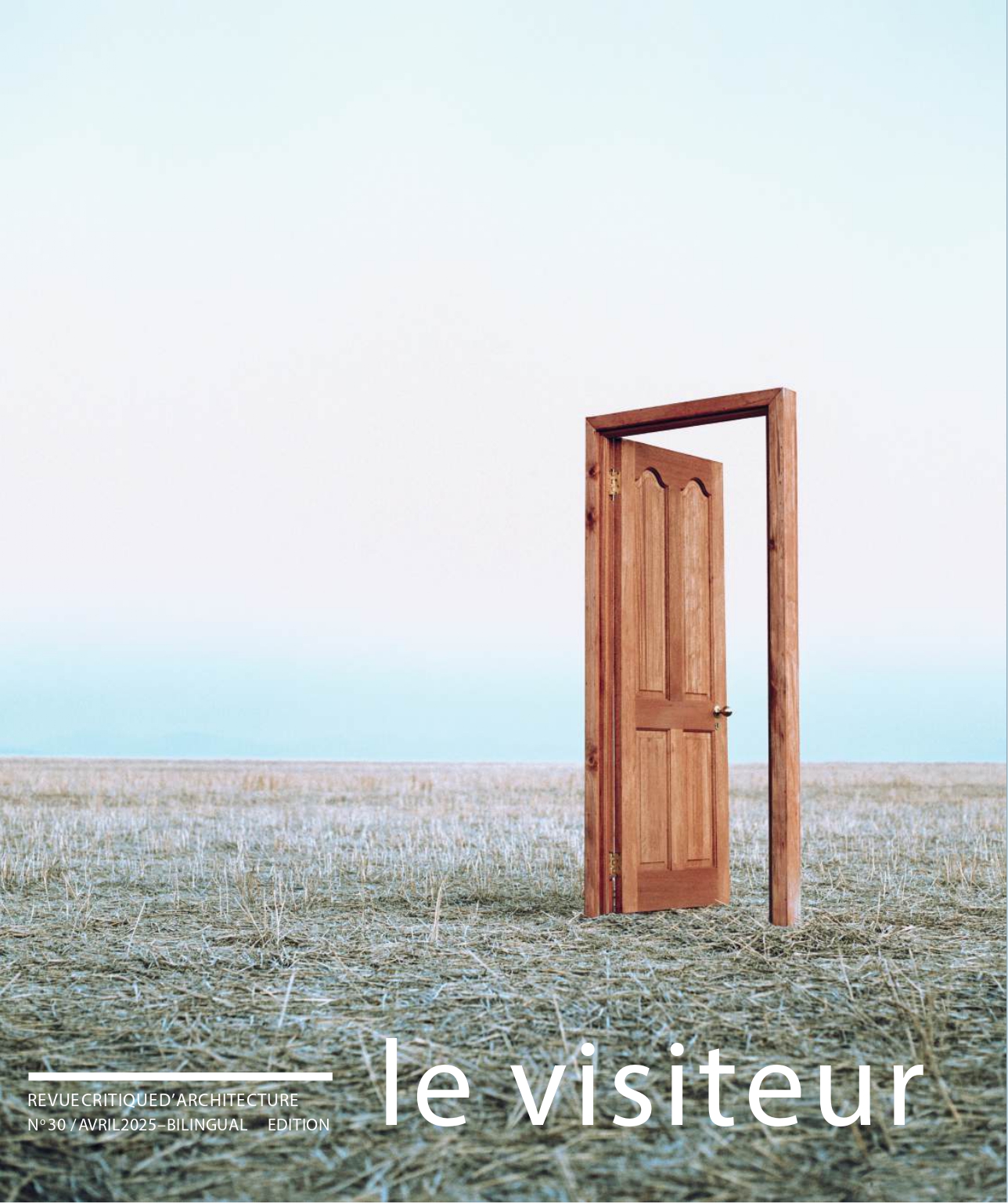
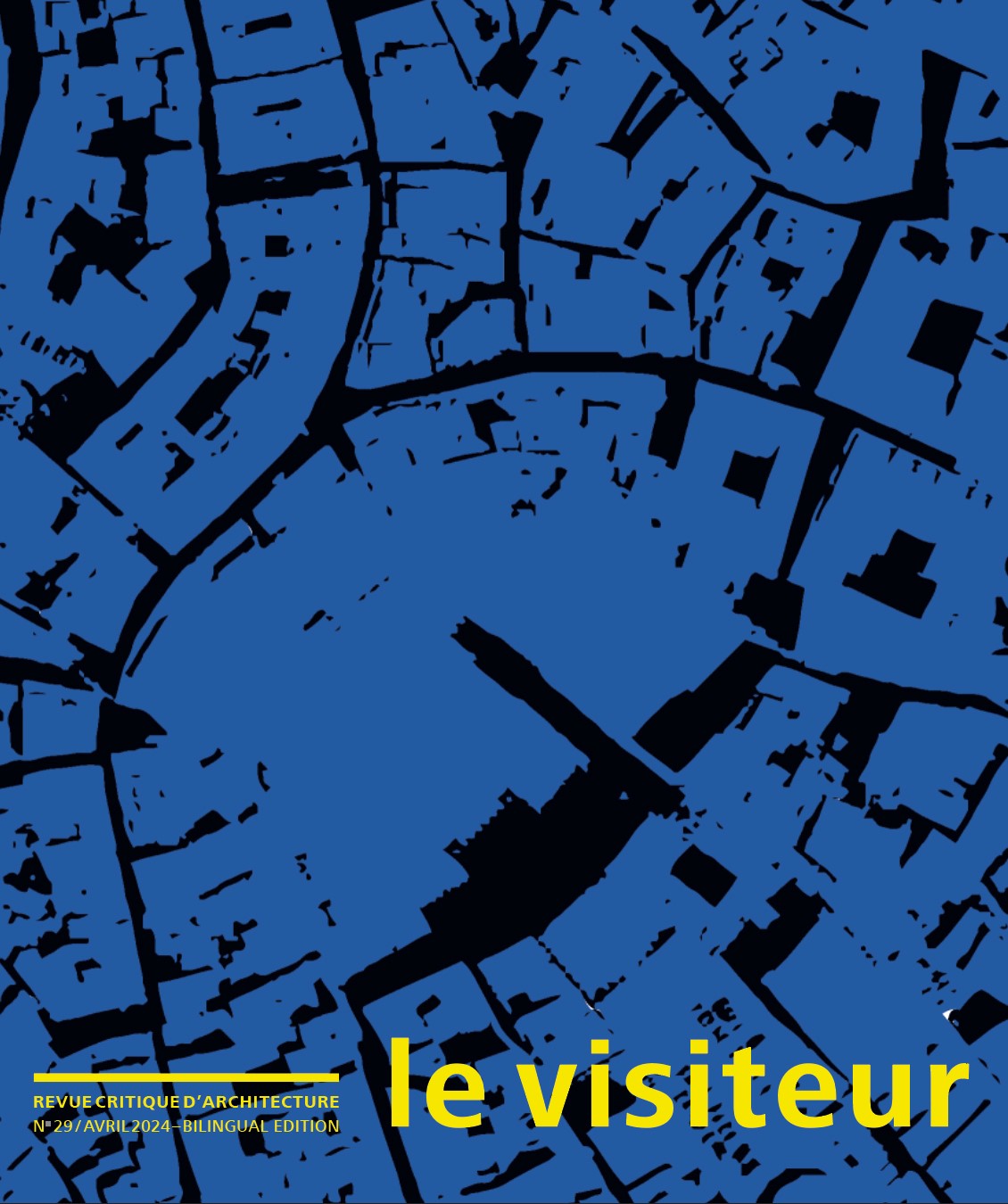
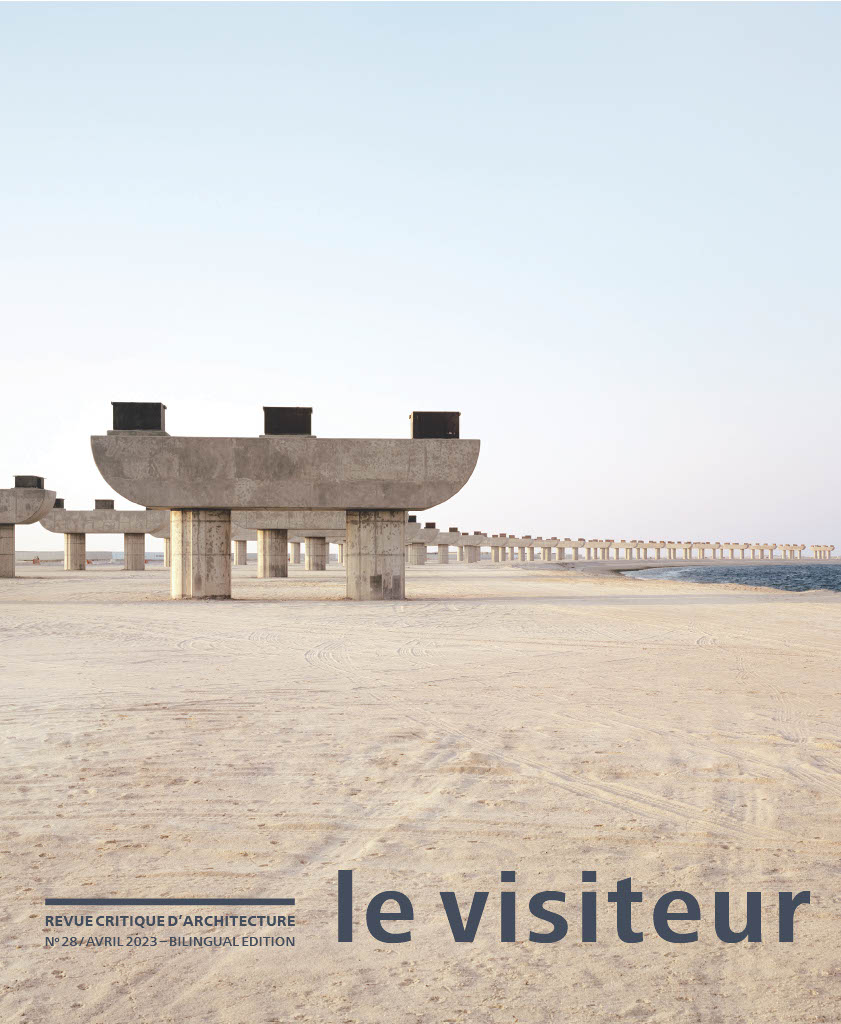
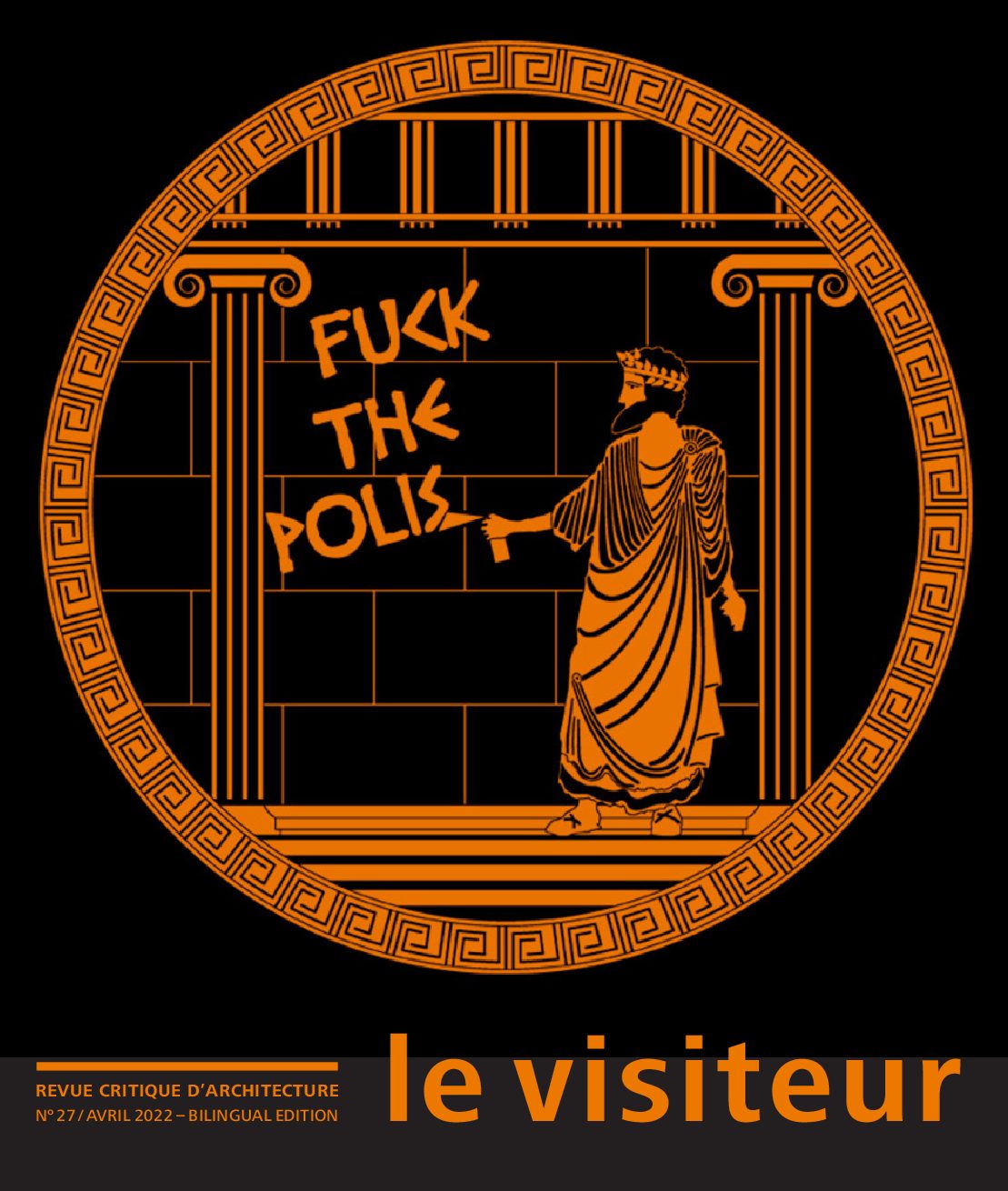
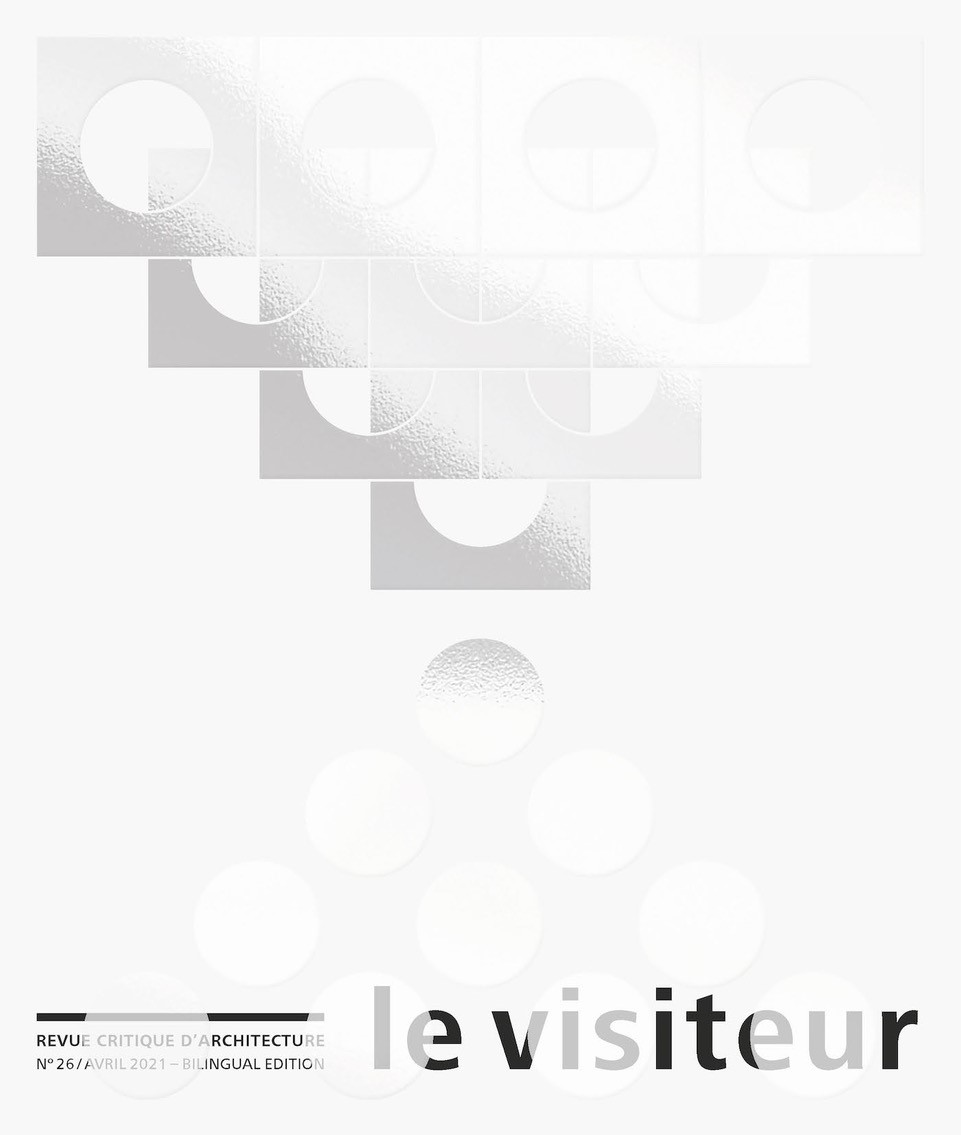



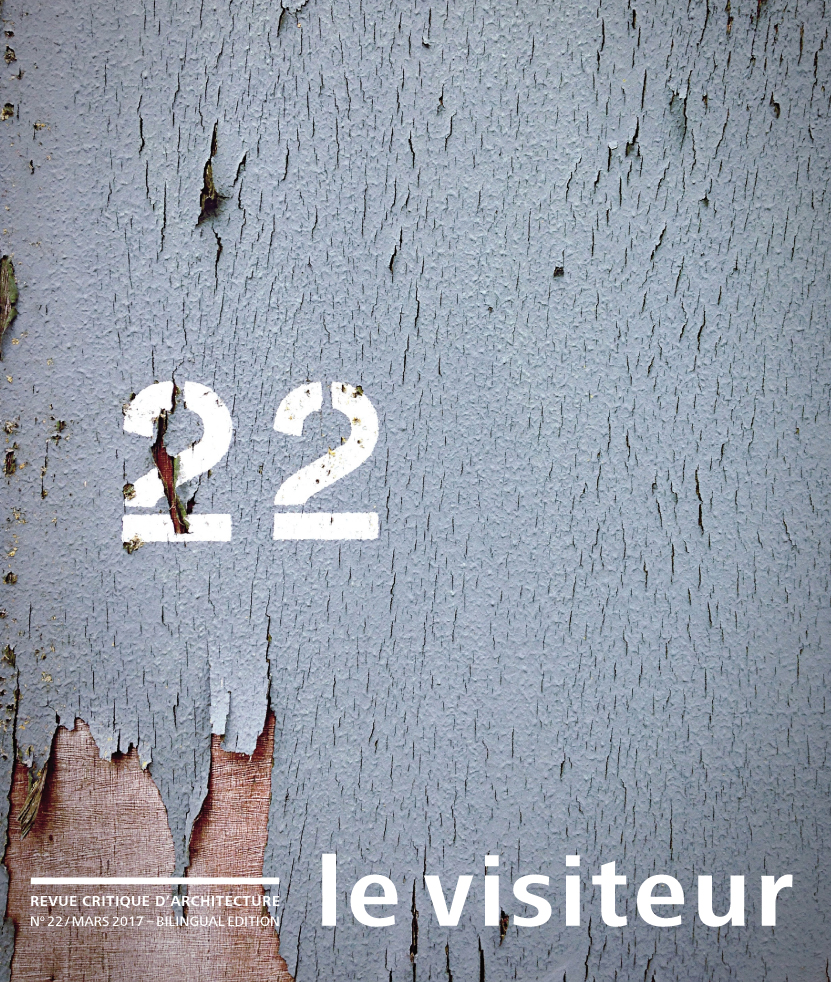

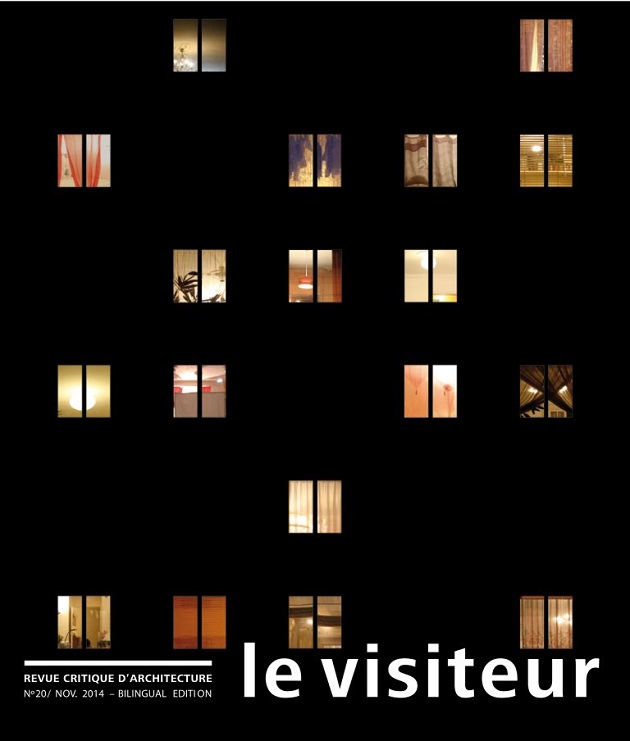


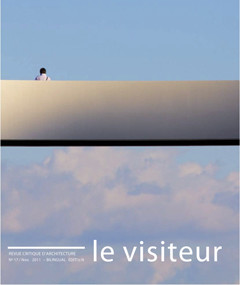

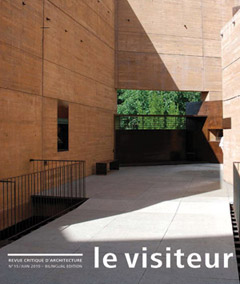


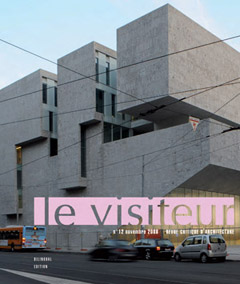

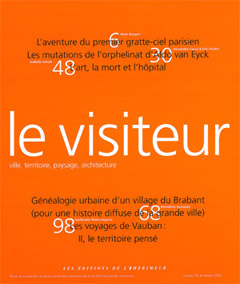
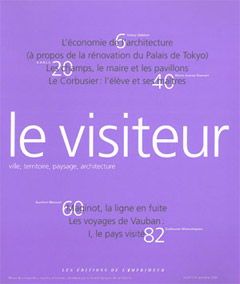
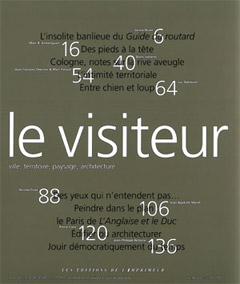
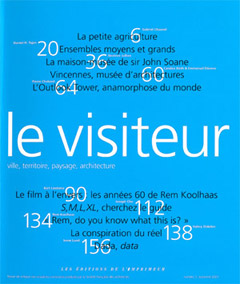
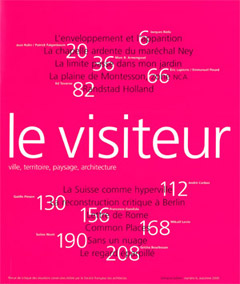
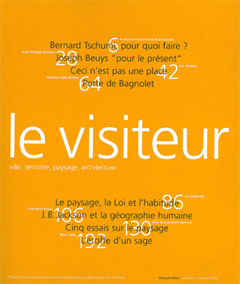

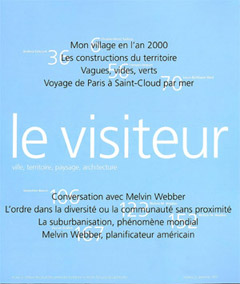
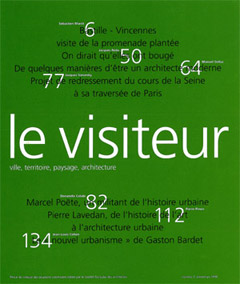

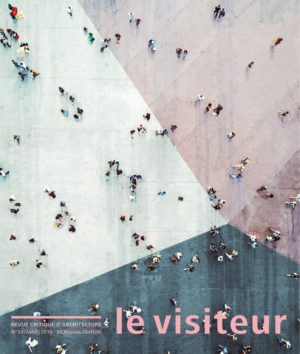
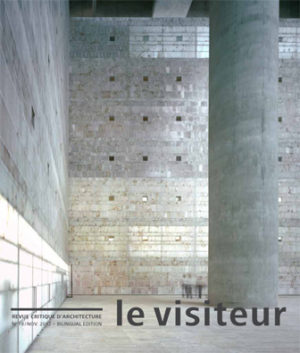
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.