Description
Date de publication: 2023
Éditorial : L’usure du monde.
Politique, architecture et développement durable
Karim Basbous
AfficherUne mauvaise conscience plane sur l’architecture. Bâtir serait presque devenu un acte immoral, au service d’une industrie dévastatrice des sols, des ressources naturelles et des paysages. Pour se refaire une vertu, certains architectes comptent sur des matériaux biosourcés et l’emballage des édifices dans l’isolant, tandis que des élus misent sur le marché des points carbone pour accompagner ce que l’on appelle de manière lénifiante la « transition écologique ». Les contradictions ne manquent pas : les trouble-fête d’un capitalisme débridé appellent à la frugalité, mais nos habitudes changent lentement et les indices de croissance restent une grande source d’inquiétude. La situation appelle une réflexion plus ambitieuse, s’agissant de surcroît d’un grand art – l’architecture – auquel nos civilisations doivent tant. Ce numéro propose donc un angle d’attaque différent, en interrogeant le rapport que le projet architectural peut entretenir avec le système productif au sens large. Art des formes que se donne une société, l’architecture s’est de tout temps inspirée des contraintes pour offrir bien plus qu’une solution à un problème. Cette dynamique, qui a été à l’œuvre notamment dans l’Antiquité romaine et à l’époque moderne, dont le siècle dernier nous a laissé d’insignes exemples, n’appartient pas qu’au passé. Elle se manifestera à nouveau pour renouveler l’intelligence du fait architectural et urbain, au service non seulement d’une certaine idée du progrès, comme il en était question hier, mais d’une planche de salut pour l’humanité. Les lieux que nous habitons pourraient représenter un projet de société. C’est le pari de ce numéro. L’usure du monde se manifeste en premier lieu dans la réalité palpable du paysage, ce témoin des transformations à l’œuvre. À l’instar de Pier Paolo Pasolini s’inquiétant des altérations d’Orte, dans le texte que nous avons publié dans un numéro précédent, Jean-Christophe Bailly se fait ici l’avocat de cette attention aux échelles, aux mémoires et aux relations, bref, à tout ce que le verbe cohabiter met en jeu, et dont le système productif s’inquiète bien peu. Les lieux et les transitions sont aussi au cœur du septième art, qui transforme le réel par le simple regard qu’il pose sur lui. Celui d’Antonioni a inspiré à Olivier Gaudin un texte où le désarroi que certains paysages nous inspirent a été, pour le réalisateur du Désert rouge, un moyen de représenter les apories du monde industrialisé. C’est également sous l’angle de l’économie, entendue comme une juste distribution des moyens, que l’on peut entreprendre une réflexion critique. C’est ce que proposent Pierre Caye, en s’appuyant sur des notions albertiennes pour éclairer la place du projet architectural dans l’histoire de la production de richesse, ainsi que Marc Lozza, à travers l’analyse d’un bâtiment à la fois simple et exceptionnel, digne représentant du temps où la frugalité était si évidente parmi les bâtisseurs qu’elle ne faisait pas l’objet de théories architecturales. Ce numéro du Visiteur porte également une parole politique : Yann Legouis démasque les significations que dissimulent les nombreuses directives, labels et annonces, et Philippe Bihouix complète parfaitement ce dernier s’agissant de fonder sur un bilan scientifique un plan d’action pragmatique. La question du temps est au premier plan de deux textes : Paul Landauer s’intéresse au dialogue avec la ruine, faisant du vestige un outil de projet, et Olivier Gahinet se propose de construire une architecture de la parcimonie, où les qualités architecturales et urbaines d’un projet sont conservées même quand son usage change. Ce sommaire serait incomplet sans un regard critique sur l’industrie ; Pierre Veltz apporte ici un éclairage indispensable sur les conditions matérielles de production. Enfin, Dominique Bourg et Geneviève Azam prennent la mesure de l’urgence du siècle, l’un dans la perspective historique d’un rapport de l’homme à la nature, l’autre procédant plutôt de la nature vers l’homme.
Trois contributions libres complètent ce sommaire thématique, ayant plus spécifiquement le projet architectural en ligne de mire. Elles portent une parole d’espoir, où se mêlent la contemplation et l’hommage. Franck Forster livre une analyse savante de la maison Miller de José Oubrerie sous les traits d’un propos de table ; Emmanuelle et Laurent Beaudouin parlent des bâtiments comme des anges, et Laurent Salomon fait honneur à trois grands architectes – et amis – emportés en pleine crise sanitaire. Nous déplorons également la mort de Mike Davis l’automne dernier, qui était membre de notre conseil scientifique ; sa pensée accompagnera le siècle.
L’architecture au-delà du projet
Jean-Christophe Bailly
En savoir +Ni l’optimisme du chantier tel qu’il est figuré dans le jeu de poutrelles des Constructeurs de Fernand Léger, ni la vision onirique de La Ville entière de Max Ernst, œuvres du siècle dernier, ne seraient possibles aujourd’hui. La ville, et avec elle l’architecture sont passées ailleurs, mais où, elles ne le savent pas. Si le sacro-saint projet maintient son idéalité comme si de rien n’était, le monde où il atterrit ne répond plus. Composite, à la fois alvéolaire et saturé, oppressé par la quantité quand il n’est pas dévasté, le contexte échappe à la saisie et s’évapore. Face aux enjeux d’un univers en crise qui semble voué à la désappropriation, il serait grand temps d’abandonner les prouesses d’une architecture hantée par la proclamation de son génie et d’inventer des logiques et des pratiques d’articulation et de réparation, tout entières tendues par la vision critique d’un espace qui ne serait plus à conquérir mais à sauver.
En finir avec l’espoir fou des métropoles « vertes »
Philippe Bihouix
En savoir +Émissions de CO2, consommation de ressources, étalement urbain : la « fabrication » des villes est largement intenable. Face à ce constat, trois pistes sont essentiellement explorées pour « réinscrire » les villes dans les limites planétaires : la densification, la technologisation accrue, l’écoconstruction. Difficile à mettre en œuvre et à rendre attractive, la densification porte son lot de contraintes ; les « cas d’usage » environnementaux de la smart city s’avèrent peu évidents pour adoucir le bilan métabolique des villes, face aux risques d’effets rebond et d’impact des dispositifs numériques ; quant à l’écoconstruction, elle se heurte à grande échelle à la disponibilité des biomatériaux. Même ultra-technologisées, même passablement renaturées, les métropoles risquent fort de n’être jamais ni neutres (en carbone), ni « vertes ». C’est le levier du moins construire, avant celui du mieux construire, qu’il va falloir activer : en exploitant toutes les potentialités du patrimoine existant, en réhabilitant, en rendant la ville adaptable aux profonds changements à venir, bien sûr ; mais aussi et surtout en revisitant profondément l’aménagement du territoire, la répartition des populations, des services et des emplois. Les métropoles ne doivent plus attirer et grandir, mais essaimer, grâce un accompagnement sans faille de la puissance publique à toutes les échelles, une nouvelle décentralisation vers les villes moyennes, les bourgs, les villages et les campagnes. Le tout au profit d’une plus grande résilience, de rythmes de vie plus apaisés, d’une plus grande autonomie personnelle et collective, d’une reconnexion aux processus naturels.
Construire peut attendre
Yann Legouis
En savoir +Le vieux, c’est l’avenir. Derrière cette formule orwellienne, se cache une vérité crue : dans le secteur du bâtiment, la construction neuve n’est plus le sujet principal. Dès lors que 90 % des bâtiments de 2030 sont déjà construits aujourd’hui, la priorité de tous devrait être la rénovation. Quelques dispositifs encouragent la rénovation, mais en s’appuyant essentiellement sur des critères performatifs d’isolation thermique, ils reflètent une indifférence à l’égard de la qualité architecturale des quartiers et des bâtiments : de l’urbanisme Tupperware à l’architecture doudoune, il n’y a qu’un pas. Le gouvernement manque par là l’objectif principal des trente prochaines années : faire de la rénovation des bâtiments de véritables projets, conçus et suivis par des architectes, et ce à travers tout le territoire. Il ne manque pas de mètres carrés abordables et disponibles à Labastide-Rouairoux, Béthune, Cognac ou Carcassonne, représentatifs de tant de petites villes et de villages que l’on a laissés se dépeupler au cours des dernières décennies. Répondre au défi climatique appelle donc un projet ambitieux et global où il s’agit de remettre au centre des débats la question du patrimoine architectural ordinaire, en encourageant un redéploiement de la population à l’échelle nationale. Il faudrait en réalité se doter d’une véritable politique d’aménagement durable du territoire.
La poésie de l’économie. Architecture, matière et énergie
Marc Lozza
En savoir +Si l’on considère qu’au cours des siècles l’homme n’a jamais pu compter que sur sa force physique pour extraire, transformer et assembler la matière, on observe l’histoire d’un autre œil. D’un côté, la production vernaculaire a rationalisé l’usage des ressources, de l’autre, les ordres classiques ont régulé les poids et les mesures. Savante ou populaire, l’architecture a su faire de l’économie un art. Or, la découverte des énergies fossiles a rompu cette tradition : depuis deux siècles, le savoir architectural n’est plus tenu de ménager la rareté. Il ne s’ensuit pas une simple transformation des cultures constructives, mais une dislocation de la discipline. Enivrées par leur toute-puissance, les sociétés industrialisées ont promu la gabegie, donnant lieu à une myriade de bâtiments individualistes, destinés à satisfaire des citoyens devenus consommateurs, conçus par des architectes artistes. Pillant toujours davantage de sol, d’énergie et de matière pour assouvir un appétit sans limites, ce système productif a soustrait l’expérience de la rareté à l’exigence de la rentabilité. L’épuisement en cours des gisements de matières et d’énergies fossiles ouvre un chapitre que nul ne sait écrire. Une génération va devoir apprendre à faire avec moins de ressources que la génération précédente. Cet état de fait, anticipé ou subi, introduit une inéluctable transformation dans nos modes de production du monde bâti. Il appartient aux architectes de s’en saisir, pour faire de la gestion des ressources le fondement d’un savoir, entendu non comme un ensemble de normes, mais comme l’armature d’une rationalité, une poésie de l’économie, loin de la prose de l’économiste.
Ruin Revival
Paul Landauer
En savoir +L’héritage du xxe siècle – siècle durant lequel on a davantage construit et aménagé que durant tous les autres – est en très mauvais état. Nombre de sites sont aujourd’hui abandonnés et pollués. La question n’est plus : est-ce que cette matière déjà construite et aménagée va permettre de répondre à nos besoins ? Ni non plus : est-ce que cette même matière témoigne d’un passé dont il convient de préserver la trace ? Mais bien plutôt : que faire de cet excédent, dont la capacité de remémoration reste limitée, et qui restera sans usage ? C’est cette ruine contemporaine – ou encore à venir – que je voudrais décrire ici, en posant l’hypothèse d’un rapprochement possible entre l’esthétique du sublime et l’ethos de la réparation. Je l’aborderai suivant trois aspects : la ruine comme moyen de retisser les temporalités constructives ; la ruine comme manière de suppléer certaines organisations déficientes du quotidien ; et, enfin, la ruine comme incitation à renouer avec un des principes fondamentaux, et pourtant oublié de l’architecture : sa nature funéraire.
Projets sans programme
Olivier Gahinet
En savoir +Que peut faire un architecte aujourd’hui face à la crise climatique, la ruine de la Terre et la crise de la démocratie ? En premier lieu, comme tout citoyen, lutter pour l’avènement d’une société plus juste, aux structures économiques transformées ; en second lieu, à un moment où la « vérité de parole » est menacée, garder vivant le savoir architectural, l’enrichir et le mettre au service de la transformation sociale ; en troisième lieu, projeter – ce qu’il fait le mieux – et dessiner le cadre d’une vie désirable, une ville partagée et démocratique où l’espace public retrouve toute sa place. Cette « ville d’après » exige une architecture de la parcimonie : pour consommer moins de ressources matérielles et d’espace agricole, pour donner un maximum de qualité à l’espace avec le minimum de moyens, mais aussi pour refonder sur un mode pérenne le rapport entre l’architecture et le programme, entre le statut du bâtiment et sa fonction. Un projet de ville durable doit apporter une réponse à la question restée pendante au xxe siècle : comment faire pour qu’un bâtiment garde ses qualités – spatiales au-dedans, urbaines au-dehors – quand la société souhaite l’utiliser pour satisfaire de nouveaux usages ?
Architectures du bien commun. Une éthique de la juste mesure et de la préservation
Salima Naji
En savoir +Face à une certaine usure du monde, il est possible d’offrir des fronts de résistance pour mettre en œuvre une dynamique d’adaptation territorialisée et sortir des logiques globales et nocives, notamment l’omniprésence actuelle du béton qui en est l’expression la plus évidente dans les sites du Maroc où le paysage géologique est si prégnant. Il s’agit aussi de proposer, avec les usagers, une production architecturale de la juste mesure, souvent modeste et qui se soucie vraiment du bien-être de tous. Une architecture du bien commun, en quelque sorte, qui permet de privilégier les conditions sociales de son édification, d’en reconsidérer les usages, de restaurer notre attachement aux lieux et aux pratiques spatiales spécifiques. Sur ce plan, l’architecture des oasis du Maroc apparaît comme un laboratoire d’essais, avec de multiples terrains de réflexion permettant de renouveler la définition du métier de l’architecte aujourd’hui.
Santa cosa la masserizia. Architecture, économie et durée chez Leon Battista Alberti
Pierre Caye
En savoir +Il faut associer à L’Art d’édifier d’Alberti un autre de ses grands textes, celui qui lui permit d’accéder à la notoriété dans le monde littéraire de son temps : le De familia. Le De familia, en particulier dans son livre III, doit d’abord être lu comme un dialogue sur l’économie : une économie des Anciens inspirée de Xénophon mais adaptée aux réalités de la Toscane renaissante : c’est-à-dire une économie du bon ménagement (masserizia) qui repose sur la sobriété (frugalitas) et qui vise à conserver les biens ainsi qu’à maintenir le fonds, pour mieux prendre soin des êtres. À cette fonction de l’économie, Alberti associe étroitement l’architecture, qui en devient l’infrastructure première, l’instrument privilégié de cette économie de la sobriété. Nous nous efforcerons, par la lecture croisée de ces deux textes, L’Art d’édifier et le De familia, de mieux comprendre leur articulation, et d’en tirer si possible quelques leçons pour notre temps.
De l’espoir à l’angoisse écologique : interrogations sur l’agir humain
Dominique Bourg
En savoir +Nous partirions d’un état des lieux écologiques – nécessaire à notre interrogation sur une forme de dualisme entre homme et nature –, celui qui découle de notre destructivité. Le dualisme homme-nature est consubstantiel à la modernité. La réinscription larmarckienne puis darwinienne de l’homme dans l’évolution des espèces ne l’a nullement fait disparaître. À l’extériorité des êtres humains à la nature s’est substituée une opposition non moins tranchée entre nature et technique, laquelle est censée pouvoir surmonter toutes les aspérités que peut lui opposer la nature. Le dérèglement climatique suffirait à dépasser ces dualismes, sans même évoquer la contestation de la compréhension mécaniste du vivant. Il n’en demeure pas moins une forme irréductible de dualité, celle qui oppose nos artefacts aux autres produits de la nature. Manifestement cette dernière ne parvient pas à les métaboliser. Ils s’accumulent sous forme de stocks, comme le carbone issu de nos combustions dans l’atmosphère ou les océans, comme les macromolécules de synthèse dans les graisses animales, ou encore aux marges des cycles naturels.
Quelques remarques sur l’industrie et l’écologie
Pierre Veltz
En savoir +Les mondes de l’architecture et de la construction sont aujourd’hui confrontés aux défis complexes de la « durabilité » (conception, matériaux, énergies, gestion, nouveaux rapports au vivant, etc.). Mais l’évolution des idées et des pratiques constructives ne peut pas être pensée séparément des trajectoires globales de nos économies et de nos sociétés. En prenant le contre-pied des images habituelles, l’article défend la thèse du passage vers une société non pas postindustrielle, mais hyper-industrielle ; une société où les modèles « industriels » étendraient considérablement leur emprise. Alors que de nombreuses analyses considèrent l’industrie comme l’ennemie quasi ontologique de la bifurcation écologique, on explore ici les zones de convergence entre une trajectoire industrielle en profonde transformation et les enjeux de cette bifurcation. L’article présente les tendances lourdes caractéristiques du basculement hyper-industriel : passage d’une économie des objets à une économie des usages et des expériences, d’une économie de la possession à une économie de l’accès, émergence progressive d’une nouvelle « esthétique » de la sobriété-durabilité. Il insiste sur le rapport à la durée et à la stabilité de l’industrie, qui s’oppose en profondeur à la recherche de liquidités constitutives de la finance. Il montre enfin que l’exaltation actuelle du petit, du local, engendre de belles innovations mais n’est pas à hauteur des défis du moment. Face aux questions du climat et de la biodiversité, nous devons aussi apprendre à penser et à agir en grand.
Réanimer nos mondes terrestres
Geneviève Azam
En savoir +L’usure du monde, ce magnifique sujet de réflexion et de méditation pourrait résonner comme un appel mélancolique à célébrer le passage du temps et la beauté de son œuvre, à plonger dans la durée. Au lieu de cette mélancolie, c’est la tristesse et le désarroi qui viennent à l’esprit, ainsi que le refus d’un refuge esthétique devant les désastres présents. Le monde, celui de la mondialisation, le Globe de la globalisation, unifié, compact, en apesanteur, ne souffrant aucune altérité, pourrait écraser de sa majuscule la Terre et ses communautés biotiques, les mondes vécus, pluriels, ceux dans lesquels nous sommes ancrés. Il est le monde de fins de mondes, de non-mondes, de destruction de la toile de vie, vécus par des collectivités humaines confrontées à des événements irréversibles à l’échelle du temps historique. Le processus de croissance infinie et l’obsession de l’aménagement, guidés par la raison économique, ont désanimé les mondes vécus, humains et autres qu’humains, ils se sont nourris de l’obsolescence des choses jusqu’à l’obsolescence du monde et à la privation d’une Terre habitable. Au lieu d’usure et de ruines, ils laissent une accumulation étouffante de déchets. Pourtant, et malgré les obstacles, la vie échappe à la volonté de maîtrise. Elle poursuit son surgissement. D’autres mondes émergent de communautés dissidentes et résistantes, attachées à habiter en commun les milieux de vie, à cultiver les liens de dépendance et d’attachement, à prendre soin des humains et de la Terre. Ils sont des commencements.
Réaffecter
Olivier Gaudin
En savoir +Le paysage instable et désolé qui ouvre Le Désert rouge d’Antonioni condense les symptômes de la violente dévastation des milieux de vie par la mécanisation et l’industrialisation. Mais l’effacement des pinèdes des abords de Ravenne figure-t-il une perte sans retour du paysage, ou l’exacerbation délibérée d’une tendance encore résistible ? La vision du Désert rouge dépasse cette alternative. Le film tranche doublement avec une nostalgie romantique. D’une part, ses personnages semblent frappés d’une forme d’anesthésie et d’inadaptation qui ne relève pas d’une psychologie des sentiments, mais de perceptions ; l’altération du paysage les affecte encore. D’autre part, ils s’efforcent d’explorer le monde tel qu’il est : abîmé, sali, malade de son système productif, mais tenu par le désir de vivre et de voir. Antonioni observait – non sans analogie avec Rohmer, Godard ou Pasolini – les points de bascule que recèle le monde industrialisé : les chantiers deviennent des brèches à infiltrer (Godard), les failles de la ville en expansion engendrent des franges investies par des marginaux réticents (Pasolini). C’est à même les formes visibles que l’on peut envisager le devenir incertain et menaçant des systèmes productifs. Ces cinéastes suggèrent de quitter les logiques de maîtrise, de croissance et de projet pour accompagner la métamorphose inquiète des lieux habités, à partir d’une attention inédite à leurs interstices négligés ou désaffectés. Cette écologie concrète du regard, sans promesse de renversement, nous met aux prises avec le monde usé dont nous héritons.
Être-ange
Emmanuelle Beaudouin et Laurent Baudouin
En savoir +Alors que nous évoquions le titre de cet article auprès d’un ami philosophe, ce dernier nous a dit : « C’est intéressant… mais quel est le rapport avec l’architecture ? » Nous avons compris que nous nous étions laissé piéger par le plaisir des mots aux sens multiples. Effectivement, cela n’a rien à voir avec ce que l’on attend d’un article dans une revue savante. Il va falloir trouver une explication à ce jeu de mots, et nous n’aimons pas les explications. Nous nous souvenons de John Hejduk évoquant les anges, il en dessinait et réfléchissait à leur représentation en s’intéressant particulièrement à la transition entre la peau et les plumes, ce passage délicat où la peau se transforme en duvet. Les anges de ses dessins étaient présents dans l’étrange communauté qui habitait ses bâtiments. John Hejduk avait une grande connaissance de la littérature et du théâtre, il aimait en parler. Dans ses dessins et ses textes, il évoquait des rapports humains où se déroulaient parfois des drames ou des rites étranges. Ses Masques étaient des scènes de théâtre et ses bâtiments des représentations symboliques de la tragédie humaine. Ses projets sont aussi des récits où ses anges étaient souvent déchus et quelquefois crucifiés. John Hejduk disait : «L’architecture est ce qui touche l’esprit, ce qui ne touche pas l’esprit est la construction. » Alvaro Siza est aussi un dessinateur d’anges, les siens survolent les villes comme s’ils les regardaient du ciel, avec bienveillance. Ses anges semblent flotter sans peser, ils regardent sans intervenir, ils sont contemplatifs. Ils sont les spectateurs et peut-être les inventeurs d’un monde qui se dessine sous leurs yeux. Ils semblent être détachés et impartiaux. Ils ne représentent ni le bien ni le mal, ils sont à l’écoute d’un monde en train de se faire. Ils sont étranges et étrangers, ils regardent la scène à distance. Pourtant les anges de Siza ne sont pas les annonciateurs d’un monde à venir, et encore moins les gardiens. Ils en sont les architectes muets. Cette thématique relie entre eux les projets présentés dans ce texte.
La conversation patiente. (à propos de la maison Miller de José Oubrerie)
Franck Forster
En savoir +En architecture, les conversations fortuites lors de repas tiennent une place importante. Elles se font autour de maquettes, inventées avec ce que l’on a sous la main (couteaux, verres, sucres, miettes de pain), ou bien de petits dessins schématiques tracés sur un coin de table. Une question, bien que simple, demeure sans réponse évidente : que cherchent les architectes quand ils regardent le projet d’un autre ? Ce texte propose une discussion autour de la maison Miller de José Oubrerie, un projet d’une rare complexité dans le corpus des maisons modernes. On essaiera d’emprunter le chemin de l’architecte qui projette, en ayant recours à ses outils privilégiés : le dessin et les mots. On verra alors que la maison Miller maintient vive une certaine idée dialectique, que ce soit dans le processus même du projet ou dans le rapport qu’entretient Oubrerie avec ses prédécesseurs. Cette maison reste avant tout un jeu ouvert, une conversation patiente qui semble s’adresser à qui souhaite y participer.
Ces choses si rares qui font un lieu
Laurent Salomon
En savoir +La finalité de l’architecture, ce pourquoi l’architecte mobilise sa science du projet, reste un sujet de dispute. S’il est établi que l’œuvre bâtie est de multiples façons l’expression d’une forme de civilisation à un moment donné, la posture de son auteur, son rapport aux pouvoirs qui s’exercent déterminent un objectif dont dépendent tout autant la capacité critique, l’ambition prospective et le potentiel poétique de son projet. On s’intéressera ici d’abord à ce qui fait ou défait la mémoire, à la notion de lieu, et finalement à ce qui, au travers de ces choses, relève de l’éthique, rendant ainsi hommage à certains qui ne s’attachent qu’au bien commun.
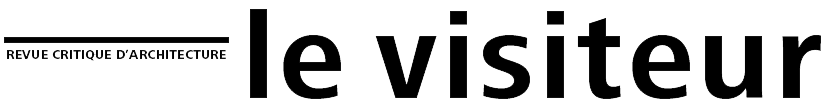


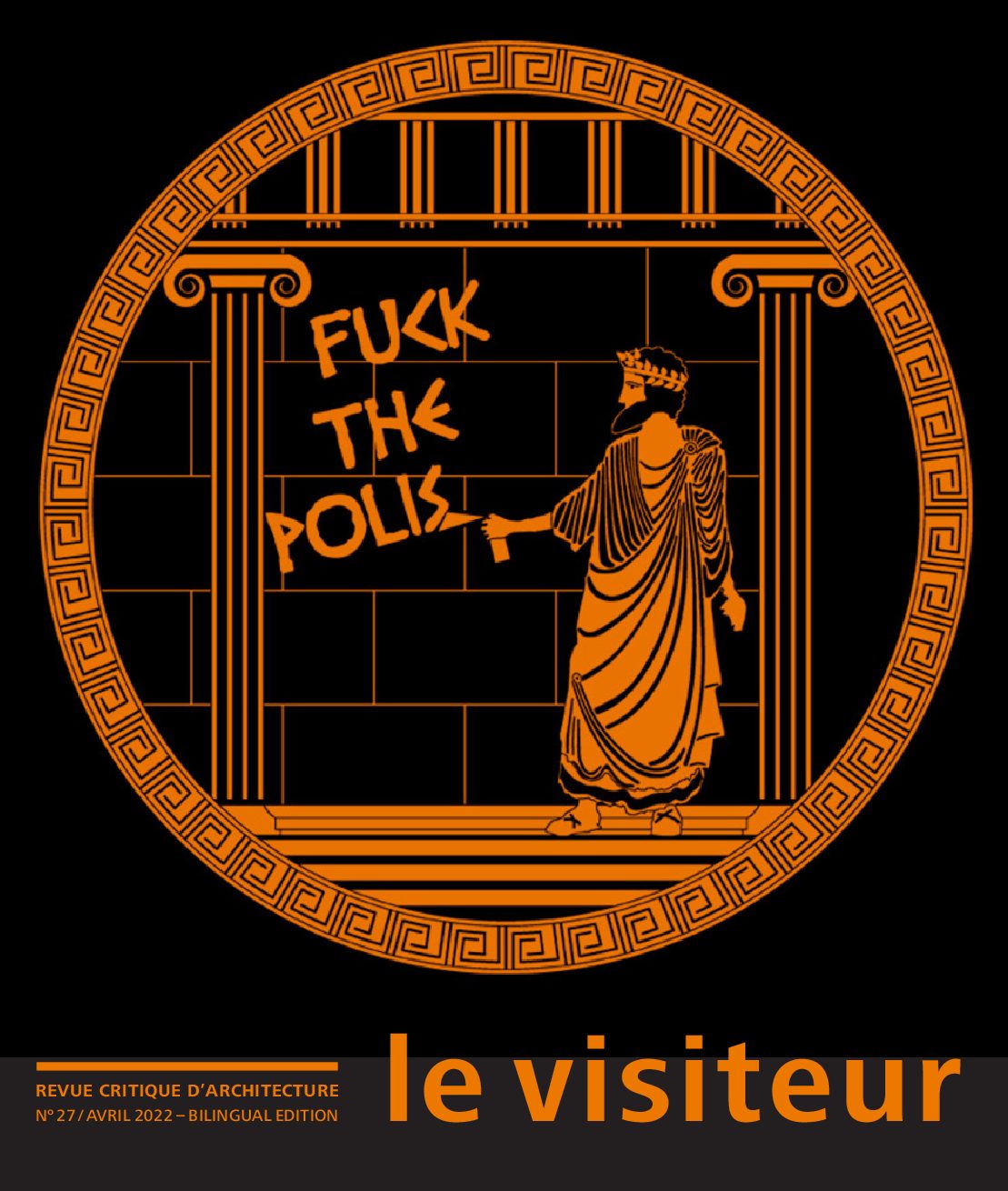


























Avis
Il n’y a pas encore d’avis.