Description
Date de publication: 2018
Éditorial : L’architecture face au marché
Karim Basbous
AfficherEn 1971, le concours du Centre Pompidou, international, ouvert et anonyme, était gagné par deux jeunes inconnus. En 2012, le nouveau palais de justice de Paris est attribué en partenariat public-privé au groupe Bouygues, qui s’était assuré pour l’occasion les services de l’un des deux inconnus de 1971, à la tête désormais de la plus grosse agence de France : en quarante ans la place du projet architectural s’est vue considérablement réduite au profit de la seule notoriété.
Alors que les termes de la commande ont profondément changé, ce numéro du Visiteur est consacré aux rapports qu’entretiennent l’architecture et le marché : il s’agit en premier lieu d’interroger la relation que la discipline architecturale et la pratique entretiennent avec les puissances économiques et, à travers celles-ci, avec les instances politiques. Tout « marché » implique un échange : il faut se demander de quel échange de valeurs l’architecture est le théâtre. Quels critères président aujourd’hui aux choix des projets ? Le goût des élus, la décision régalienne, les « jurys » aux motivations complexes, la doxa architecturale exercent – de manière concentrée ou diffuse, manifeste ou implicite – un pouvoir qui façonne nos villes. L’histoire des concours elle-même en dit long sur le rapport que la société, à travers la commande publique, a entretenu avec les grands projets.
Le « petit monde » de la commande d’État était déjà à l’œuvre dans l’Italie du XVe siècle. Pour Philippe Potié, la naissance conjointe, à ce moment, du capitalisme et du projet architectural n’a rien de fortuit : il y a un morcellement du temps propre au capitalisme que l’architecture « compense » en proposant un « éternel retour » vers un temps archaïque et rêvé. L’architecture, ainsi, rend possible le capitalisme naissant.
Alors que l’architecte semble aujourd’hui perdre le crédit qu’il avait accumulé au fil des siècles, l’histoire de la profession est riche d’enseignements pour comprendre l’évolution des rapports entre praticiens et maîtres d’ouvrage : Robert Carvais retrace la généalogie de cette lente « construction de la confiance » dont a bénéficié le maître d’œuvre sur la base d’un savoir et d’une compétence. Aujourd’hui, ceux-ci sont bousculés par la révolution numérique, et l’on s’interroge, avec Antoine Picon, sur l’avenir du droit d’auteur – et plus généralement sur la notion de paternité de l’œuvre architecturale – sous l’effet des mutations techniques et sociales auxquelles nous assistons.
La notion de Bigness développée par Rem Koolhaas il y a une vingtaine d’années annonçait le déclin de principes majeurs qui avaient jusqu’alors guidé le projet architectural : l’article critique de Pierre Caye démasque cette « théorie de l’extrémisme ». Il ouvre ici une perspective qui permet de regarder au-delà du postmodernisme dans lequel nous sommes embourbés et qui a commencé à s’affirmer dans les années 1980.
C’est de la même époque – de 1977, précisément – que date la loi française définissant la création architecturale comme étant d’intérêt public, et dont on peut se demander si elle est toujours au cœur des préoccupations des maîtres d’ouvrage. S’agit-il encore pour eux d’« entreprendre un projet », ou est-il désormais question d’« acheter un produit », fût-il un équipement ? Les récents bouleversements dans les modes de production urbaine appelaient un état des lieux et une mise à jour des responsabilités des pouvoirs publics aussi bien que celle des architectes. C’est ce que fait Catherine Jacquot dans un article synthétique et lucide. L’engagement politique d’un architecte et l’efficacité commerciale de son activité font-ils bon ménage ? La valeur d’une agence d’architecture est-elle de nature intellectuelle ou financière ? Quel rôle le marketing joue-t-il désormais sur le marché de la commande ? Ces questions sont au cœur du « cas Aravena » sur lequel s’est penché Olivier Namias, cas emblématique des effets combinés du lobbying, des coteries, des prix surmédiatisés et de l’emprise du capital : derrière les slogans, l’auteur cherche à comprendre les réalités d’un système.
L’architecture face au marché : ce thème peut être une source de désillusions et d’inquiétudes. On peut toutefois être en prise avec la réalité d’une manière plus enjouée. C’est ce que font François-Frédéric Muller et Marie-Pierre Duhamel Muller. Le premier s’intéresse au marché de la vente immobilière, illustré par une émission de télévision à succès qui révèle bien des aspects du rapport des Français au marché du logement, de la dictature du goût qui sévit sur les esprits et de l’ingérence des médias dans l’intimité des maisons. Marie-Pierre Duhamel Muller, quant à elle, s’intéresse aux mythes véhiculés par la profession d’architecte vue à travers le prisme du cinéma hollywoodien. Elle en fait le récit à la fois étonnant et délicieux à travers des morceaux choisis.
La forme d’une ville change plus vite, hélas ! que le cœur d’un mortel. Un entretien filmé de Pier Paolo Pasolini évoque ce vers de Baudelaire : le cinéaste s’exprime devant Gianfranco Contini sur ce qu’il appelle, lui aussi, la forme d’une ville. En s’appuyant essentiellement sur l’exemple de la ville d’Orte, le regard critique qu’il pose sur les qualités du paysage bâti et sur la modernisation du monde est l’expression d’une sensibilité, d’une nostalgie et d’une intelligence qui peuvent sembler en décalage avec notre époque. Son cri d’alarme est pourtant très actuel, et nous rappelle que le paysage est une œuvre : une œuvre fragile et difficile à défendre, étant le fruit de multiples interventions, souvent anonymes.
Luigi Moretti, dont on commence seulement aujourd’hui à mesurer l’importance, était l’un des plus grands architectes italiens du XXe siècle, mais aussi un théoricien de valeur. Nous avons choisi de traduire un article paru en 1951 dans la revue Spazio, où il défend le rôle de la modénature. Il y montre qu’elle constitue le trait d’union entre l’architecture classique – dont elle est l’élément le plus abstrait – et l’architecture moderne, tout aussi attachée à la puissance plastique des formes bâties. Les photographies de Marc Lozza restituent la picturalité des détails que Moretti avait sélectionnés.
L’architecte et le banquier, une esthétique du temps
Philippe Potié
En savoir +L’architecte est apparu à Florence au XVe siècle, dans la ville du capitalisme naissant que domine la banque des Médicis. Quelle est la nature du lien qui se constitue alors entre l’architecture et la puissance de l’argent ? On abordera cette question en faisant l’hypothèse qu’à la fragmentation temporelle produite par l’accélération propre à la dynamique capitalistique, l’architecture répond par l’unité d’un temps fictionnel. À l’inquiétant morcellement du temps, que décrit notamment Hartmut Rosa dans Aliénation et accélération, l’architecture offrirait la recomposition imaginaire indispensable au déploiement du « projet ». Aux malaises de la civilisation, à la mélancolie, au spleen, à la dépression, que Rosa perçoit comme la conséquence des ruptures de rythme du capitalisme, l’architecture répondrait en dessinant le cadre stable d’une unité de temps archaïque. Culturaliste ou naturaliste, la scène primitive instaurerait un temps psychique unifié et cohérent, stable et inaliénable. Antiquité et modernité, Renaissance ou postmodernité désigneraient l’opération temporelle par laquelle se restaure, en dépit de la « machine à fragmentation » du capitalisme, une unité à travers le théâtre de l’architecture.
« The Market has a Plan »
Alejandro Aravena et le projet de la Quinta Monroy
Olivier Namias
En savoir +L’année 2016 aura été faste pour Alejandro Aravena, cofondateur et figure de proue de l’agence chilienne Elemental. Déjà nommé directeur de l’édition 2016 de la biennale d’architecture de Venise, il reçoit en janvier le Pritzker Prize, ce qui fait de lui le plus jeune lauréat de ce prix, souvent présenté comme l’équivalent architectural du Nobel. Ces deux distinctions marquent en apparence un tournant vers « une architecture socialement engagée » dont Aravena serait le chef de file. Elles remettent aussi sur le devant de la scène le projet de demi-maison qui lui a valu le succès. Inspiré de dispositifs imaginés dans les années 1960, ce système propose une solution aux problèmes de crise du logement qui s’annoncent. Mais sont-elles aussi vertueuses que leur concepteur le prétend. En examinant les réseaux mobilisés par Elemental, la communication orchestrée par son membre vedette et les implications de ce dispositif, il y a tout lieu de croire que ces demi-maisons remplissent parfaitement les buts du marché néolibéral, et que l’architecture étiquetée « socialement engagée » est une énième ruse des insaisissables marchés.
Vers un nouveau modèle de production de la ville
Catherine Jacquot
En savoir +Nous sommes entrés dans un nouveau modèle de production de la ville. Nous pouvons même parler de privatisation de la production urbaine : vente de biens et de services publics aux investisseurs les plus offrants, création du statut de métropole pour en accroître l’attractivité et assurer le développement en attirant des capitaux privés.Cette privatisation a des conséquences sur la forme de la ville, ses espaces publics, son habitat : macrolots, ventes de propriétés foncières publiques à l’encan, smart cities, gated communities, etc. Elle a aussi des conséquences sur les acteurs de sa production que sont les élus, les aménageurs, les maîtres d’ouvrage, les architectes, les urbanistes, les constructeurs. Le maître d’ouvrage public devient un acheteur qui sécurise coûts et délais par des contrats globaux où entreprise et architecte travaillent ensemble dès l’amont du projet.Cette coproduction entre public et privé de la ville est un fait croissant ; il faut donc se poser les bonnes questions, c’est-à-dire : comment mettre en place une gouvernance, fixer un cadre pour fabriquer une ville durable et responsable, favoriser la confiance et le dialogue entre tous les acteurs et encourager la recherche et l’innovation.
Les réseaux de la confiance
Les contradictions du marché de l’architecture à l’époque moderne
Robert Carvais
En savoir +En France, aux XVIIe et XVIIIe siècles, l’architecte se construit une nouvelle identité sur le double fondement vitruvien de la ratiocinatio et de la fabrica, tout en subissant une concurrence solidement installée depuis cinq siècles auprès des gens de métiers, et précisément des entrepreneurs maçons. L’échange qui s’effectue entre l’architecte et son client s’exerce sur la base d’une « économie de la qualité » (au sens défendu par le sociologue Lucien Karpik) plutôt que sur celle, classique, fondée sur la valeur du produit. D’autant que la qualité de la construction demeure incertaine tant que l’édifice n’est pas achevé, ni n’a vécu un tant soit peu dans le temps. Le marché de l’architecture s’est forgé ainsi quelque peu autour de la part d’incertitude sur la qualité de l’édifice une fois achevé. Pourtant, paradoxalement, la construction de l’édifice se quantifie en termes de coûts de production sur la base du prix unitaire des matériaux (mesurés à la toise) ou du travail (mesurés à la journée). On peut même parler à propos de l’architecture classique d’« économie de la modération » (recherche du moindre coût). La consubstantialité des concepts d’architecture et d’économie, étymologiquement parlant, permet d’envisager l’architecte comme le gestionnaire de la conception et de la réalisation d’un bâtiment « en bon père de famille », devant éviter toute dépense inutile. Comment concilier cette contradiction entre l’incertitude et l’évaluation du coût ? La représentation d’une économie de la qualité induit un marché particulier de l’architecture sur lequel il s’agit de s’interroger par le biais de deux axes : le réseau et la confiance.
Bigness is business
Pierre Caye
En savoir +La dissolution de plus en plus active de l’architecture dans le dispositif constructif a trouvé sa théorie dans la notion de Bigness formulée par l’architecte néerlandais Rem Koolhaas. Cette théorie veut signifier la fin de l’architecture comme Hegel annonçait la fin de l’histoire : elle annonce la fin du projet, la fin de l’architecture en tant qu’art, sa soumission aux principes de la narration cinématographique, mais aussi son indifférence au contexte et par là même son amoralité foncière. Cinq points fondamentaux donc qui forment comme autant de dogmes nouveaux, expressément revendiqués par cette théorie. Nous montrerons que ce genre de théorie s’inscrit en réalité au cœur d’un dispositif practico-discursif plus complexe qui vise non seulement à soumettre l’architecture aux lois de la marchandisation générale de la société, mais mieux encore à lui donner une « figure » destinée à glorifier cette soumission.
Révolution numérique, paternité et propriété intellectuelle
Antoine Picon
En savoir +Entamée il y a une vingtaine d’années, la révolution numérique n’a pas fait que transformer la pratique du projet. Elle a entraîné une série d’évolutions des structures de la profession d’architecte. La taille des agences a considérablement augmenté dans certains pays, en même temps que se multipliaient les intervenants et les collaborations au sein d’un processus de projet de plus en plus fortement déterminé par les logiciels disponibles et la mise en circulation de modèles numériques. Dans ce contexte, on assiste à une montée en puissance des questions de propriété intellectuelle sur lesquelles on s’interrogera.
Net vendeur
François-Frédéric Muller
En savoir +Maison de famille, maison de vacances, maison secondaire, maison de ville, nous savons toujours qualifier nos maisons. Mais comment vendre ou acheter une maison qui a vécu ? Le marché, par l’entremise de la télévision, nous propose une recette simple : la neutralité. À bas le typique, honte au kitsch, couvrez ces souvenirs que je ne saurais voir ! Pour une meilleure transaction, il faut dépersonnaliser. La maison habitée est bientôt supplantée par la maison objet.
Les architectes le font sur la table
Marie-Pierre Duhamel Muller
En savoir +La profession d’architecte, dans le cinéma commercial américain, et ce depuis un bon demi-siècle, semble être une de celles qui garantissent non seulement le respect de l’entourage, mais aussi et surtout, l’attention féminine. Du Gary Cooper du Rebelle de King Vidor au bouillant Wesley Snipes de Spike Lee (Jungle Fever), en passant par Paul Newman (La Tour infernale) ou Woody Harrelson citant Louis Kahn (Proposition indécente), l’architecte – de sexe masculin et strictement hétéro – est une figure de l’intellectuel idéalement « sexy », plus que l’écrivain, le peintre ou le professeur. Il est créatif et passionné, mais sans la triste mine du pauvre poète, et surtout, il est lié au business, à la circulation de l’argent, au marché, bref à la success story à l’américaine. Tropes scénaristiques et indispensables accessoires des décors (table, équerre, plans) semblent rassemblés pour mettre en valeur le glamour viril des stars et décorer une profession qui serait l’une des plus propices au maintien de l’ordre social et sexuel. Il y aurait donc lieu de chercher dans les genres cinématographiques les moins asservis au commerce une plus subtile idée des relations qu’entretiennent le métier et le désir.
Valeurs de la modénature
Luigi Moretti
En savoir +
Si l’on imagine un édifice classique dépouillé du profil de ses parties, son ordre harmonique tomberait dans une confusion tant plastique que structurelle. Avec les moulures de la base et du chapiteau, le pilier se dé-tache avec clarté de la paroi, ne serait-ce que par une saillie légère, et remplit alors son rôle de soutien. Le pli des ombres sur la corniche entourant une fenêtre consolide formellement l’arête et tranche le vide avec da-vantage de vigueur. Les moulures apaisent ou exaltent l’élément singulier, toujours en fonction de cette structure idéale qui gouverne la représentation architecturale dans son ensemble et qui soulève, strie et densi-fie les surfaces au moyen desquelles la structure elle-même se révèle.
La forme de la ville
Pier Paolo Pasolini
En savoir +
J’ai choisi une ville : la ville d’Orte.
C’est-à-dire que j’ai pris pour thème la forme d’une ville, le profil d’une ville. Voilà ce que je voudrais dire : j’ai fait un cadrage qui faisait voir d’abord seulement la ville d’Orte dans la perfection de son style, en tant que forme parfaite, absolue. C’est plus ou moins un cadrage comme celui-ci. Il suffit que je bouge ce truc-là sur la caméra et voilà que la forme de la ville, le profil de la ville, la masse architecturale de la ville est com-promise, détruite, défigurée par un corps étranger. Il s’agit de cet immeuble, à gauche. Le vois-tu ? Voilà le problème dont je souhaite parler avec toi, parce que je suis incapable de parler dans l’abstrait, dans le vide, pour un public de télévision qui est je ne sais où. Je parle avec toi qui m’as suivi dans tout mon travail et m’as souvent vu affronter ce problème. Quand je suis allé tourner hors d’Italie, au Maroc, en Iran, en Éry-thrée, j’ai souvent été confronté à cette difficulté pour tourner une scène où l’on voit une ville tout entière, intègre. Combien de fois tu m’as vu souffrir, m’énerver, jurer en voyant ce dessin, cette pureté absolue de la forme de la ville abîmés par la présence d’un objet moderne qui n’avait rien à voir avec la forme de la ville, avec ce profil que j’avais choisi.
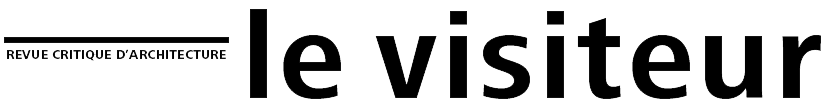


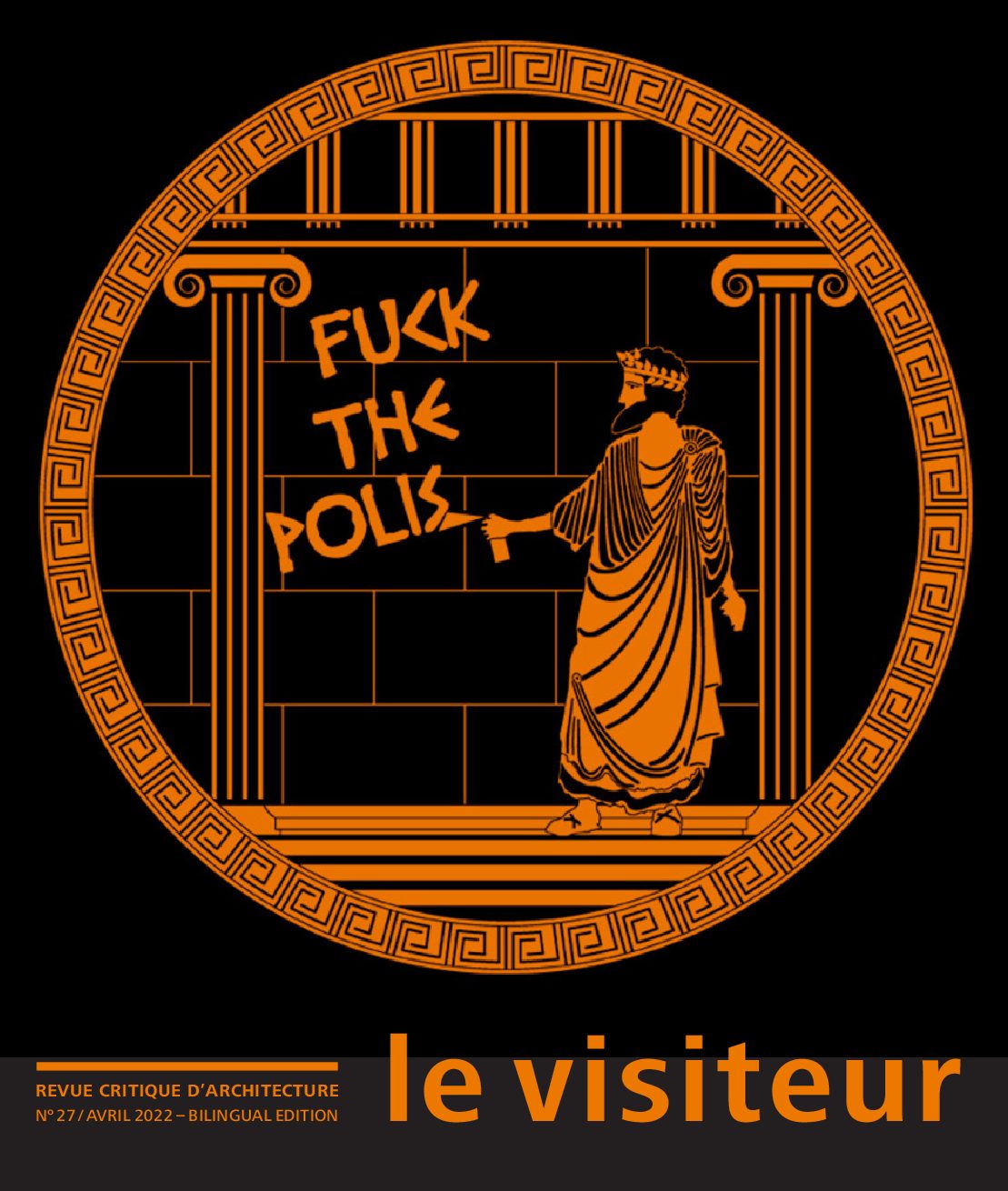


























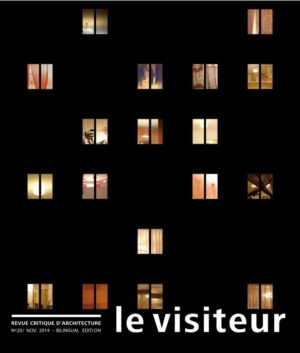
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.