Description
Date de publication: 2007
Éditorial
Karim Basbous
AfficherFaire un projet, c’est poursuivre un objectif à la fois fondamental et gratuit. C’est concevoir un édifice avec le souci de répondre à un certain nombre d’attentes, que celles-ci soient clairement énoncées dans un programme, silencieuses comme des rêves collectifs ensevelis sous les couches de l’habitude et de la normalisation, ou occultées par une pléthore d’images.
Certaines réalisations architecturales explicitent de façon exceptionnelle la dimension théorique du projet. À leur tour, ces réalisations agissent comme des stimuli pour d’autres projets à venir. L’université Bocconi de Milan que termine en ce moment l’atelier irlandais Grafton Architects, fondé par Yvonne Farrell et Shelley McNamara, est un édifice de cet ordre. Sa modernité n’est pas un exercice de style international, mais le moyen d’incarner la cité lombarde dans sa chair même. Les architectes ont trouvé le « ton juste » en nourrissant leur travail d’une connaissance fine de l’histoire des villes italiennes à toutes les époques, et en se mettant à l’écoute de la matière dont cette ville est faite jusque dans ses aspects les plus impalpables : sa texture, son atmosphère, sa lumière brumeuse et ses odeurs. Cézanne parlait de sa peinture comme d’une science des « dessous » ; on retrouve un peu de cette patience dans le projet d’Yvonne Farrell et de Shelley McNamara, bâti sur un fonds constitué d’une accumulation de faits sentis, mesurés, réinterprétés. Les deux architectes irlandaises auront dessiné un bâtiment essentiellement italien, qui semble même réaliser le rêve de la Tendenza : habiter des mégastructures.
Le paysage de Milan n’est comparable ni aux villes françaises, où l’îlot est au service d’une continuité, ni aux métropoles américaines où se juxtaposent des blocs autonomes. Les rues milanaises sont faites de contrastes d’échelles, de silhouettes et d’époques, d’une multitude d’accidents féconds dont l’Italie a le secret pour animer à chaque coin de rue le parcours du flâneur. La Bocconi est à l’image de Milan : l’édifice parvient à être contextuel avec sa différence, il fait corps avec le site sans pour autant en imiter aucune composante.
À l’heure où de nombreux projets ne veulent plus nouer l’architecture et la ville, ou le programme à la forme, la Bocconi est un fait d’armes. Elle convainc par la justesse de son échelle, et en mettant l’effort constructif au service d’un espace urbain intérieur inédit. Le résultat est à la mesure du risque. Ce projet affirme à sa façon que l’architecture se rapporte à l’histoire, au fait politique, aux techniques, au local et à l’universel, mais il l’affirme avec les outils mêmes du projet, c’est-à-dire avec des faits d’espace et de matière, des expériences de pensée et de vie.
Pour déplier le rapport du projet à tout ce qui l’entoure tout en interrogeant la spécificité de son savoir, la Société française des architectes a organisé, en collaboration avec le CNRS, le colloque « Le projet en questions » qui s’est tenu au printemps dernier. Ce numéro et le prochain présentent un certain nombre d’articles issus des communications faites au colloque. La thématique déborde les diverses écoles, tendances ou théories de l’architecture, parce que le projet lui-même, qui est au cœur du métier architectural, concerne, au-delà de la seule pratique des architectes, le destin de l’homme, de sa raison, de son rapport au monde.
Le Visiteur a par ailleurs souhaité rendre hommage à Claude Schnaidt, mort l’an dernier, dont les textes ont été réunis en un volume intitulé Autrement dit. Paul Chemetov a bien voulu évoquer pour nous l’œuvre de l’historien et théoricien pour qui l’architecture était un engagement de tous les instants.
Edificio Grafton, architecture éponyme
Hugh Campbell
En savoir +Début de l’article…
Par un matin d’avril pluvieux à Milan, je visite le nouveau bâtiment conçu par Grafton pour l’université Bocconi, en compagnie d’Yvonne Farrell et de Shelley McNamara, les deux associées principales de l’atelier. Au pied de l’un des escaliers montant aux étages de bureaux, nous tombons sur une signalétique récemment mise en place. Au-dessus du plan des cinq étages du bâtiment avec ses codes de couleur figure la légende Universita Bocconi, Edificio Grafton. Je crus alors que cet audacieux bâtiment d’environ 40 000 m2 portait le nom de ses architectes. Je compris plus tard qu’il n’en était rien. La signalétique fut rapidement refaite et le bâtiment reprit un nom plus générique. Il semble maintenant que la photo, un peu floue, que j’ai prise de cette plaque soit le seul souvenir de son bref statut de bâtiment éponyme. Il est difficile toutefois de ne pas considérer le projet Bocconi comme l’aboutissement majeur du travail de Grafton. Ici les thèmes et la logique qui sous-tendent leur œuvre depuis plus d’une décennie s’épanouissent pleinement ; ici le langage architectural qu’elles ont développé trouve son expression la plus claire et la plus vaste ; ici leur idée du rôle de l’architecture dans la société est démontrée de la façon la plus convaincante. Et tandis qu’on peut considérer ce bâtiment comme une sorte d’aboutissement des réalisations de Grafton à ce jour, il doit être également vu comme une déclaration d’intention, une promesse d’avenir.
À la Bocconi, c’est la structure qui ordonne l’espace. Les grandes séries de poutres suspendues abritant les trois étages de bureaux réservés aux enseignants créent entre elles une succession de cours, de jardins et de puits de lumière, et au-dessous d’elles, comme excavé, un vaste espace libre qui s’étend sur tout le site. Le poids est suspendu et au-dessous est créé l’espace. On sent la puissance de cette stratégie de façon immédiate quand on se déplace dans le bâtiment. Mais cette intuition est en fait le fruit d’un labeur minutieux. La disposition des poutres habitées est destinée à fournir le même degré de lumière et de visibilité aux mille bureaux individuels. La mise en évidence des enveloppes et des sous-faces de chaque poutre permet de conserver une sorte d’unité scalaire, en longueur et en largeur, si bien que cette disposition se lit comme une entité unique, composée d’éléments répétitifs de même nature.
Structuring space
Shelley McNamara et Yvonne Farrell
En savoir +Ce texte est tiré de la conférence qu’Yvonne Farrell et Shelley McNamara, fondatrices et principales associées de l’atelier Grafton Architects, ont prononcée à la Société française des architectes le 23 novembre 2007, sur leur projet pour l’extension de l’université Bocconi à Milan (édifice tout juste achevé).
Début de l’article…
Pour des architectes ayant passé la plus grande partie de leurs vies professionnelles à Dublin, l’idée d’arriver dans une nouvelle ville, à savoir Milan, de construire un nouveau bâtiment dans un nouveau lieu, et où nous étions des étrangers, est extrêmement stimulante. Avant d’y édifier, il nous fallait d’abord nous approprier Milan en tant que ville, nous en imprégner physiquement en quelque sorte, pour ne plus nous y sentir étrangères. Nous raconterons donc l’histoire de cinq ans de travail dans la ville, en mettant l’accent sur les objectifs essentiels de notre projet.
L’université Bocconi est située en lisière du centre de Milan, au sud du Dôme. Tout comme Trinity College, c’est une université « ouverte ». Nous avons assez vite remarqué le potentiel qu’offrait pour le projet l’espace interstitiel entre le groundscape et le skyskape[1]. La possibilité de faire un toit suspendu au-dessus du sol, celle de produire un espace sans limites est quelque chose que nous avions déjà mis au point dans des projets plus petits, mais qui, d’une certaine manière, convenait bien aussi à ce projet plus ambitieux.
[1] En français : paysage au sol, et paysage du ciel.
Architectura logico-graftonica
Raymund Ryan
En savoir +Début de l’article…
L’œuvre de l’agence Grafton se caractérise par son urbanité, son sens des « règles du jeu » architectural, alliés à une liberté d’esprit qui privilégie la nature, la topographie et l’effet de surprise. Les nombreux bâtiments conçus ces vingt-cinq dernières années par Yvonne Farrell et Shelley McNamara et leurs collègues de Grafton (en particulier des projets pour des institutions artistiques, éducatives et gouvernementales) font la synthèse entre une attention à la rationalité et à la typologie, d’une part, et des qualités subtiles, d’autre part.
Leur architecture est non seulement logique mais aussi géologique, topologique, sociologique ; elle intègre le site, le programme et les impératifs de construction pour aboutir à des projets esthétiques plastiquement riches et sociologiquement complexes. Elle incite à l’exploration et à une sorte de promenade architecturale. Cela peut évoquer les rampes de Le Corbusier, et davantage encore les monuments démocratiques d’Alvar Aalto, soigneusement accordés à leur environnement nordique.
Le projet en questions
En savoir +
À une époque où l’architecture risque constamment de voir son action banalisée et son statut amenuisé, en une époque aussi où l’architecture, dans son développement même, semble se démanteler en d’infinies « spécialisations » au risque de se dissoudre, la Société française des architectes a pour ambition d’en souligner la spécificité, la singularité et la nécessité, et de rappeler la place qu’elle occupe dans la culture et le savoir des hommes. Et rien n’en témoigne mieux que la question du projet qui est à l’origine de l’architecture et qui, sous des formes diverses, raconte l’histoire de l’homme et de son rapport au monde. Encore faut-il réussir à saisir l’objet de cette pratique bien particulière, et à comprendre ce que cette expérience de pensée qu’on appelle le « projet » met en jeu.
Nous avons donc souhaité poser la question : que sait-on du projet ? Est-ce la préfiguration d’une réalité construite, une méthodologie de conception appliquée aux bâtiments, ou autre chose ? Et peut-on envisager une définition générale du projet par-delà ses différentes expressions architecturales ?
Pour répondre à ces questions, nous avons réuni, avec le soutien et la participation du CNRS, des architectes praticiens, des enseignants du projet, des historiens, des philosophes et des ingénieurs, français et étrangers. Nous avons multiplié les approches, non pour éluder le sujet, mais pour montrer tout ce que touche le projet, dans ses ramifications historiques, philosophiques, politiques et idéologiques.
Nul n’ignore les difficultés que rencontre l’architecture aujourd’hui, prise entre un système de production du bâti auquel elle est contrainte de se plier et la logique médiatique et mercantile dominante : double emprise qui menace en permanence la liberté et la souveraineté du geste architectural. Nous avons la conviction que, malgré ces conditions, le projet reste une force, nous dirions même une force à la fois d’arrachement et d’inscription, en mesure encore de s’inventer comme manière d’agir sur le réel au sein des procédures de production en vigueur dans nos sociétés. Chacune des interventions que nous publions dans ce numéro décrit à sa façon la nature de cette force.
Pour Luigi Snozzi, le projet est une forme de désobéissance civile vis-à-vis des directives prédominantes dans l’aménagement du territoire, une désobéissance nécessaire pour faire valoir la raison de l’homme et la raison du site. Olivier Gahinet défend une idée du projet où la forme s’adresse à l’usage et à la ville, en retraçant les origines de cette indifférence au lieu et au programme, indifférence que cultivent certaines dérives contemporaines. Antoine Picon intervient sur les enjeux et les écueils des outils numériques, au regard d’une évolution des méthodes et des procédures de conception, mais aussi des principes et des notions sur lesquels la théorie architecturale s’est appuyée, de la Renaissance à nos jours. Chez John Ruskin, nous dit Philippe Potié, la force qui meut le projet est aussi la foi qui en fait un acte quasi rituel, un concentré d’humanité dont Les Sept Lampes de l’architecture font ressortir les aspects matériels et spirituels.
Enfin, nous sommes intervenus nous-mêmes, le premier sur la forme de la pensée au travail dans la conception architecturale et sur la souveraineté du projet ; le second sur sa singulière efficience, c’est-à-dire sur son art incomparable de se déplacer dans l’inertie du réel, et par ses déplacements d’en modifier le centre de gravité.
Appel à la résistance
Luigi Snozzi
En savoir +Cet article représente une synthèse des diverses problématiques qui se posent aujourd’hui à l’architecte : le rapport entre politique et architecture, le rôle social de l’architecte, l’importance de l’éthique, la responsabilité des intellectuels et donc des écoles dans une société qui se définit comme démocratique. À travers le projet architectural se pose le problème du rapport homme-nature, de l’importance de l’histoire et du lieu d’intervention.
Ce texte s’appuie sur des aphorismes des années soixante-dix écrits dans le cadre de mon premier enseignement à l’Ecole Polytechnique Fédérale de Zürich, et présente, à travers quelques projets urbains, des réponses concrètes au développement de la ville en antithèse de la praxis des urbanistes d’aujourd’hui, et en opposition à l’extension urbaine incontrôlée : un quartier d’habitations à Brissago, l’agrandissement de la ville de Pordenone, le plan de protection des collines euganéennes de Padoue, le plan guide pour la commune de Cabras en Sardaigne pour l’introduction du tourisme en zone agricole, et le plan pour la Deltamétropole de Hollande.
« L’architecture vise le permanent et non l’éphémère, et refuse le principe d’efficience, tandis que la société et la politique visent l’éphémère et recherchent l’efficacité maximale. »
Mies et les postmodernes
Olivier Gahinet
En savoir +Début de l’article…
L’histoire de la modernité architecturale est, en partie, une histoire de la fin de la pièce comme élément central du travail de projet : la pièce comme lieu dévolu à chacune des activités humaines dans le bâtiment ; la pièce au dessin contraint par la nécessité d’avoir des murs porteurs en périphérie ; la pièce régie essentiellement par le plan ; la pièce, enfin, comme constituant élémentaire des projets, pièce d’un jeu de construction.
Les inventions techniques du XIXe siècle vont changer la manière de porter les bâtiments, et l’un des premiers à en tirer les conséquences architecturales est Frank Lloyd Wright[1]. Il revendique l’extension horizontale et « l’explosion de la boîte », et les met en scène dans les fameuses planches qu’il dessine pour l’édition Wasmuth en 1910 de ses travaux.
Si l’on prend l’exemple de la maison Robie, le plan montre l’ouverture des angles du grand salon, et les oriels qui semblent projeter l’intérieur vers l’extérieur. La perspective, elle, insiste sur la mise en lévitation des étages successifs, et leur transformation en plans horizontaux abstraits. Toutefois, dans la réalité bâtie, l’espace de la maison Robie est encore assez clos et bas de plafond. L’extension horizontale est obtenue presque « négativement », par une compression considérable de l’espace ; on a l’impression que celui-ci « fuit » latéralement entre les pilastres des menuiseries. Mais c’est la représentation qui compte : elle est saisissante, et aura une influence considérable sur les architectes européens.
Mies va explorer ces thèmes de l’extension horizontale et de l’« explosion de la boîte » d’abord dans son projet de maison de campagne en briques (1923) puis dans le pavillon de Barcelone (1929). Ce dernier a pour programme de n’en avoir pas : d’être pure représentation, dépense, luxe d’espace ; il organise néanmoins sur un mode pratiquement domestique des lieux plus ou moins intimes. Il fonde un modèle d’agrégation complexe d’espaces dans une extension exclusivement horizontale. Le pavillon de Barcelone est presque une maison, presque un équipement. Mais quel que soit l’angle sous lequel on le considère, son modèle de plan fluide horizontal n’est adapté qu’à un programme de petite taille.
[1] Plus précisément, il va créer par ses projets un cadre propice à l’exploitation de ces nouvelles techniques. Lui-même utilise la plupart du temps les murs porteurs, et il justifie ses choix projectuels par d’autres raisons que structurales : l’extension horizontale est liée au paysage de la Prairie et à la volonté de Wright de fonder une architecture proprement américaine ; mais elle est aussi un moyen pour lui de prendre l’exact contre-pied de l’ordre vertical imposé depuis toujours aux projets par les questions structurelles.
Le projet comme recherche
Karim Basbous
En savoir +La conception architecturale ne saurait se réduire à l’expression d’une idée destinée à être traduite en figure, ni même à la production d’une esquisse qu’il s’agirait par la suite de développer au fil d’un processus d’agrandissement des échelles, d’affinage, de mise en précision. Faire un projet ne consiste pas à viser d’emblée une figure à laquelle le programme devra se plier, ni d’errer dans les géométries variables pour saisir arbitrairement une singularité plastique, mais d’initier un mouvement conduisant à une forme sans la préfigurer. Je proposerai donc d’interroger le projet comme une capacité de l’esprit à se mouvoir patiemment dans l’obscurité d’une pensée fragmentaire et tâtonnante, pour finir par s’étonner soi-même en découvrant un agencement insoupçonné. On verra également en quoi cette expérience marque un double renversement : la théorie n’est plus un savoir prescriptif antérieur au projet mais un examen a posteriori de sa réussite, et le verbe « faire » recouvre sa portée conceptuelle.
Le projet au risque du numérique
Antoine Picon
En savoir +Dans l’histoire de la discipline architecturale, les savoirs relatifs au processus de conception proprement dit occupent une position tout à fait paradoxale. D’un côté, ils représentent clairement le cœur de la discipline. Mais de l’autre, ils ont été rarement théorisés de manière frontale. De la Renaissance au XVIIIe siècle, la plupart des auteurs de traités ont préféré se concentrer sur la question des ordres ou encore sur des problèmes de distribution ou de construction. Contrairement aux déclarations de certains de ses pères fondateurs, le Mouvement Moderne ne s’est guère montré plus explicite quant aux procédures de projet. C’est du côté d’un auteur comme Durand ou d’une institution comme l’École des Beaux Arts que l’on trouve en réalité l’une des formulation les plus précises d’un certain nombre d’hypothèses concernant l’apprentissage et la pratique du projet.
Après s’être interrogé sur les raisons de cette étrange mise entre parenthèse, l’intervention proposée tournera autour des mutations induites par la montée en puissance de la culture numérique au cours de la dernière décennie. Celle-ci tend d’une part à déplacer les enjeux du projet.
À l’accent mis sur la surface et à la renaissance de la question de l’ornement répond la crise de l’idéal tectonique auquel avait adhéré la Modernité, si l’on en croit du moins un Kenneth Frampton. Mais le plus important concerne l’explicitation des stratégies de projet. L’usage intensif de l’ordinateur conduit en effet à reposer la question des procédures de conception avec une urgence nouvelle.
Différence, mouvement, projet dans la théorie architecturale des Anciens
Pierre Caye
En savoir +L’architecture se conçoit dès son origine vitruvienne sous la forme d’un couple, le couple de la fabrica et de la ratiocinatio, c’est-à-dire du chantier et du projet : pas de chantier valide sans projet, et de même pas de projet sans sa prise et sa maîtrise du chantier. Il est clair que ce couple originaire est appelé à un grand avenir non seulement dans l’histoire de l’architecture mais aussi, d’une façon plus générale, dans la genèse de la technique moderne. De ce couple, l’architecture vitruvienne ne cherche pas tant à en faire la synthèse qu’à en signifier la différence, l’écart qui ne cesse de s’instaurer et de se réinstaurer entre les deux termes, un écart stimulant qui engendre de nouveaux problèmes et de nouvelles résolutions, bref qui contribue à l’invention architecturale.
Je montrerai dans un premier temps qu’en réalité cette différence fondamentale est tributaire d’une autre différence, au sein même du projet vitruvien, entre la proportion et l’eurythmie, c’est-à-dire entre l’harmonie numérique de l’édifice et son harmonie linéaire. Puis je réfléchirai d’une façon plus générale, sur ce jeu des deux différences et sur sa signification dans l’invention architecturale.
L’architecture comme acte de foi, lecture ruskinienne
Philippe Potié
En savoir +La foi est très certainement la notion qui nous est devenue la plus étrangère pour aborder l’architecture après que le progrès technique ait balayé de son souffle laïque l’art de bâtir. Aussi, à titre d’hypothèse, nous voudrions ici faire l’effort de penser le projet, sous la férule de Ruskin, à la manière d’un « acte de foi ». Loin de nous l’idée d’évoquer le retour à une quelconque religiosité, mais bien au contraire d’essayer « d’isoler » dans « l’acte de foi » sa dynamique édificatrice (au sens où c’est en effet le geste du tailleur de pierre, du menuisier, du peintre qui est posé comme guide dans « Les sept lampes de l’architecture »).
Dans cette perspective, il s’agirait alors d’envisager le projet d’architectural à la manière d’une sorte de rituel, de quête, de parcours initiatique dont l’œuvre achevée constitue le moment de Vérité. Ce faisant, c’est tout le rapport à la matière, à la technique qui se trouve modifié, voire inversé, l’ornement devenant le révélateur de cette « vérité ».
Étonnamment, et c’est la raison de notre retour au texte de Ruskin, cette « foi » dans l’acte d’édifier n’est pas sans faire écho aux élans prophétiques d’une réflexion contemporaine où se mêlent le souci d’une gestion durable de notre environnement, une éthique de la responsabilité et une morale de la précaution. Aujourd’hui comme hier, il est question d’un pacte avec la Nature au regard duquel le projet architectural aurait pour double mission de sacraliser la Matière et de contenir les élans d’une technique suspectée de la profaner.
Un imaginaire du projet est aujourd’hui en train de redéployer son espace qui retrouve des lieux parcourus initialement par les théoriciens du XIXe siècle, et « oubliés » par les Modernes. Nous aimerions ici nous ressaisir de cette pensée dont la « foi » en l’univers créé portait le dessein de tout projet futur.
Jeune homme dans le train de la modernité
Paul Chemetov
En savoir +Début de l’article…
Claude Schnaidt, pour ceux qui l’ont connu ou croisé, était une curieuse personne. Par sa voix, teintée de tant d’accents, Genevois d’origine, mais germanophone, avec de temps à autre des échos de gouaille parisienne. Figure d’apparence ascétique, mais aimant la vie, moine-soldat ? En fait, enseignant passionné. Il assuma, succédant à Max Bill, la direction de l’école d’Ulm, la Hochschule für Gestaltung jusqu’à sa fermeture en 1967-1968 et de l’Institut de l’environnement à Paris (à l’angle de la rue d’Ulm et de la rue Jean-Calvin ! cela ne s’invente pas), fondé par Malraux à la suite de 68, habillé alors d’une façade de Prouvé, avant que le placage de marbre de Philippe Starck ne vienne signifier la fin de cet entracte pédagogique, politique, intellectuel.
Claude Schnaidt, né en 1931, mort au mois de mars 2007, le 22 précisément. « Jeune homme dans le train de la modernité », pour reprendre les mots de Gubler. Il fut proche de cet autre éternel jeune homme, Anatole Kopp, dont le livre Quand le moderne était une cause, non un style résume exactement le parcours de l’un et de l’autre.
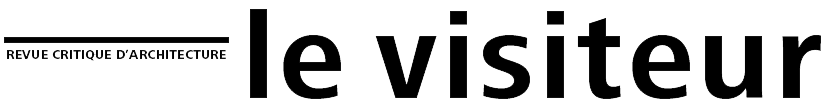


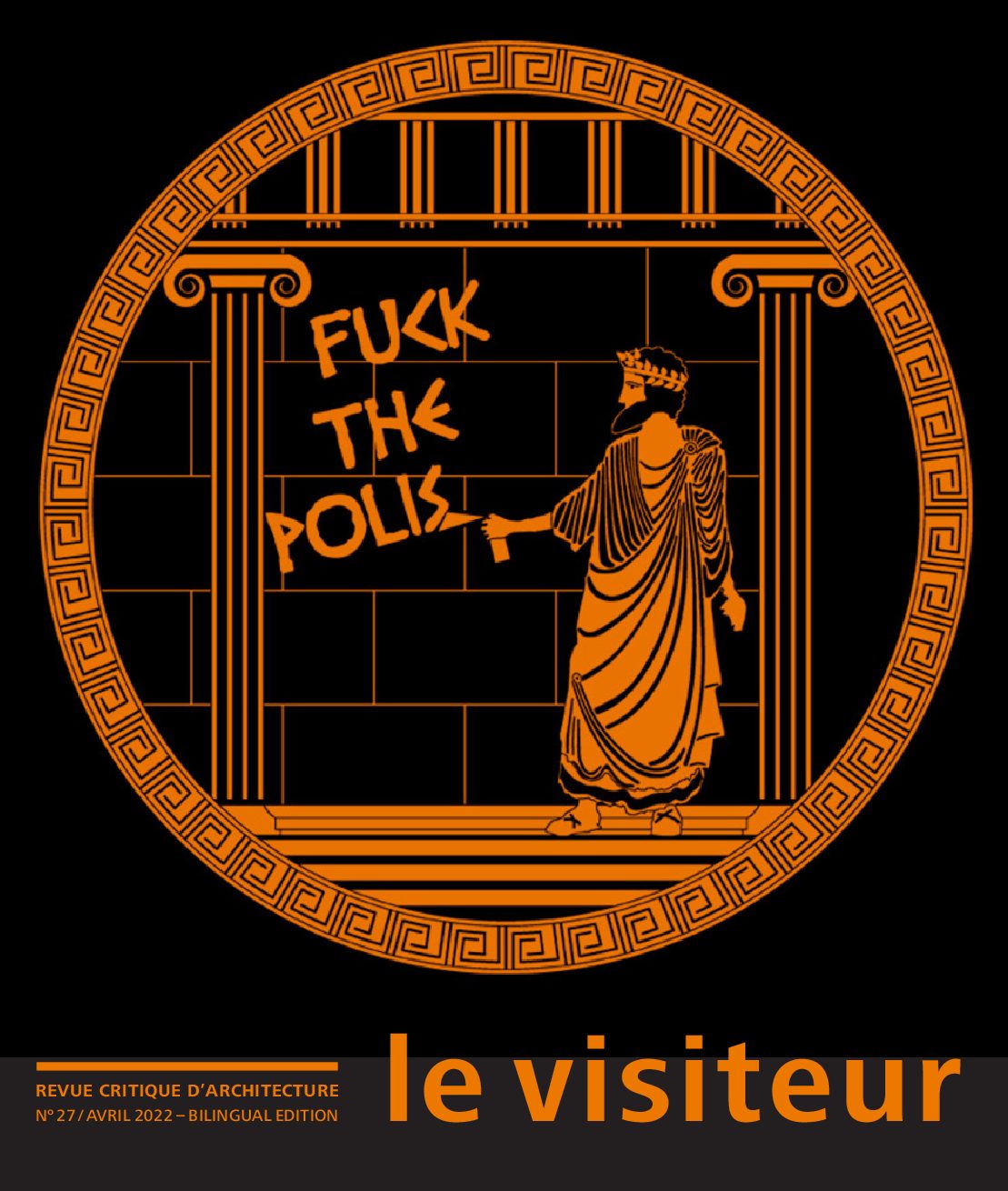



























Avis
Il n’y a pas encore d’avis.