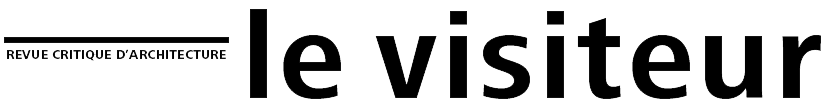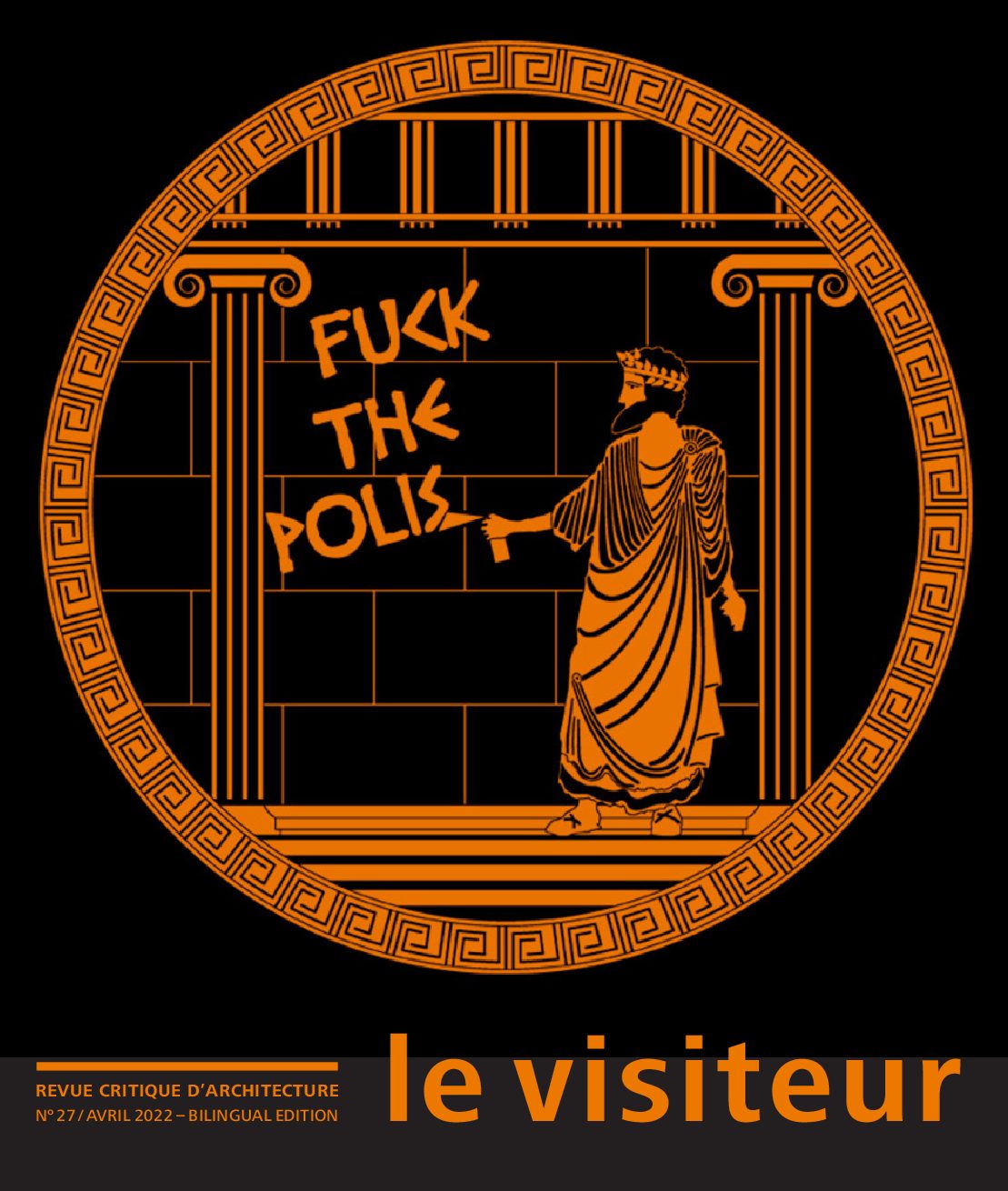Description
Date de publication: 2014
Éditorial – Mémoire et Temps
Karim Basbous
AfficherLes pages qui suivent sont consacrées au temps, une dimension autour de laquelle l’architecture, la philosophie et la musique se croisent. Nulle métaphysique n’occupe cependant le sommaire de ce numéro du Visiteur : les objets, les villes, la mémoire sont précisément les moyens de déjouer l’abstraction du temps afin de l’observer à travers tout ce qui le déforme en quelque sorte, pour le révéler. À l’échelle d’une heure ou d’un siècle, le temps selon ce qui en témoigne nous apparaît tantôt comprimé, tantôt éclaté ou ralenti ; sa course peut sembler continue ou jalonnée d’événements marquants. Le temps apparaît comme le symétrique de l’espace : une notion s’impose à l’esprit aussitôt que l’autre est convoquée, et l’on ne saurait penser l’espace sans inclure le temps. Les grands âges de l’architecture et de la ville ont engagé à chaque fois un rapport au temps spécifique : à la Renaissance, on utilise le point de vue historique – l’Antiquité – au service de l’invention du présent ; l’École des beaux-arts, elle, placera le principe d’imitation et de répétition au cœur de l’enseignement ; les avant-gardes et le Mouvement moderne reposent sur une rupture et sur la dynamique du nouveau. L’idée même de « projet », à savoir l’anticipation d’une réalité, est d’essence temporelle. Dans l’architecture contemporaine, c’est la question de la place de l’histoire et, plus généralement, le sens du legs qui doit être posée. En somme, le temps a plusieurs territoires, plusieurs cartes en jeu, et chacun des auteurs de ce numéro les explore à sa guise[1].
Prenant le contre-pied de la notion d’« éclatement » de la boîte que l’on associe habituellement à la doctrine moderne, ma contribution examine des bâtiments – tout aussi modernes – où les mouvements du regard et du corps intériorisent le plaisir de l’espace en multipliant les situations. On y découvre alors comment le plan « s’ouvre dedans » pour ainsi dire. Cela n’est pas sans rapport avec la « dilatation spatiale », ce principe qui fonde la raison du dessin chez Henri Ciriani, et dont Pierre Caye montre qu’elle est aussi une dilatation de l’instant : il va chercher ainsi à démêler le rapport de l’architecture au monde, à la production et à la souveraineté. Augustin Berque, lui, s’attache à expliquer la notion nippone d’espace-temps dans la pensée japonaise, en s’appuyant notamment sur le haïku et les structures du langage, apportant ainsi un éclairage sur une philosophie où la perception du monde, la formation des choses, se font hors des catégories qui ont longtemps façonné la grille de lecture occidentale. Pour Martin Bressani, le passé de l’architecture est moins ce qui est derrière nous que ce qui fait retour, parmi les vivants, comme un spectre ; son article explore l’intérêt et les limites d’une considération de l’évolution des formes comme une perpétuelle résurgence de ce qui fut. C’est aussi ce principe de résurgence que Philippe Potié met en lumière à travers le destin des villes mythiques, en le rattachant à celui d’une mort programmée.
Erika Naginski s’intéresse au thème de la ruine pour mettre en lumière les affinités entre les images de Piranèse et la philosophie de Giambattista Vico. Psychanalyste et écrivain, Francis Hofstein nous propose une méditation qui traverse des sujets aussi variés que l’art, l’architecture, la religion ou le crime. Antoine Picon et Philip Ursprung interrogent le rapport au temps de l’architecture contemporaine, l’un à partir des relations entre structure et ornement, l’autre à travers la notion d’« éternel présent » qu’évoquent les objets actuels. Sarah Whiting, enfin, établit le lien entre le culte de la vitesse aujourd’hui et l’indécision que trahissent les outils de conception aux fonctions pléthoriques, mais aussi l’inflation des images.
La mémoire, qui est une des dimensions du temps, fait l’objet de deux articles : le premier, d’Aurélien Lemonier, est consacré à l’architecture de l’Inde postcoloniale où la continuité des pratiques, des usages et des idées engagées dans la dynamique politique du XXe siècle ne peut être réduite à l’opposition simpliste entre idéologie moderne et traditionalisme. L’article monographique est signé Jonathan Block Friedman, et il est consacré au mémorial de Yad Vashem conçu par Moshe Safdie, un bâtiment qui arrache le visiteur au temps ordinaire pour le placer dans un temps abstrait, « décomposé » par le plan. Dans le récit qu’il fait de sa visite, l’auteur témoigne autant du réel – hic et nunc – que de l’imaginaire au rendez-vous de toute grande expérience architecturale : l’ordre géométrique des salles se mêle au tumulte des émotions et des pensées que provoque la déambulation. Il nous rappelle ainsi qu’un lieu, comme un texte, en convoque toujours d’autres, en morceaux.
[1] Ces articles sont issus du colloque « Les territoires du temps », organisé par la Société françaises des architectes en partenariat avec le CNRS, avec le soutien de l’Urbaine de travaux.
La promenade dramatique à Yad Vashem
Jonathan Block Friedman
En savoir +Construit près de Jérusalem, le musée de la Shoah de l’architecte Moshe Safdie met en œuvre une gymnastique structurelle et spatiale pour accompagner notre cheminement. Tandis que le « prisme » central répand de manière inattendue son obscurité sur nous, le reste du bâtiment interprète tout autrement le drame, jouant plutôt sur des résonances musicales et un ordre algébrique entre pleins et vides modulés.
La vache et l’éléphant
Une leçon indienne
Aurélien Lemonier
En savoir +Les années qui suivent l’Indépendance de l’Inde (1947) sont une période d’accélération de l’urbanisation. Il s’agit à la fois de définir de nouvelles politiques de planification et de marquer symboliquement la rupture avec la colonisation anglaise. L’architecture moderne que le Premier ministre Nehru favorise pour les grands chantiers nationaux sera un des vecteurs de la nouvelle démocratie. La construction de la ville nouvelle de Chandigarh conduite par Le Corbusier et Pierre Jeanneret acquerra en particulier cette fonction symbolique.
Dès le milieu des années 1960, une génération d’architectes prend ses distances vis-à-vis de la doctrine du Mouvement moderne pour porter une attention particulière aux spécificités de la société indienne : le rapport de la ville à son milieu naturel, comme celui de l’architecture et de son empreinte culturelle à l’accélération de l’économie industrielle. Ils remettent ainsi en cause les traditionnelles oppositions entre modernité et tradition, culture savante et vernaculaire, industrie et artisanat.
Derrière l’entreprise d’interprétation et d’actualisation de l’architecture savante moghole, à laquelle de nombreux architectes comme Raj Rewal se consacrent, c’est finalement un processus de construction d’une « identité » qui est à l’œuvre simultanément au mouvement continu de circulation entre l’Orient et l’Occident que l’Inde suscite et absorbe.
Le monocle et le kaléidoscope
Karim Basbous
En savoir +Depuis un siècle, l’« éclatement de la boîte » est le leitmotiv qui consacre la conquête du dehors comme l’un des thèmes fondateurs de la modernité architecturale. Cependant, nombre de projets emblématiques du XXe siècle montrent un principe autre, à l’ombre des théories : celui de l’implosion par laquelle la dynamique centrifuge a lieu cette fois à l’intérieur du bâtiment, en plusieurs foyers qui se font l’écho du regard et l’intègrent comme un contrepoint du parcours. Cette hypothèse provient d’une question liée à notre expérience quotidienne de l’espace : habite-t-on seulement le lieu où l’on se trouve, ou aussi ceux qui s’offrent à la vue ? En dissociant ces deux réalités vécues – l’occupation physique et la perception visuelle – on découvre un moyen de distinguer deux types d’architecture : celle qui se contente du statut d’objet – lequel se laisse contempler comme un contenant, un vase – et celle, plus complexe, dont le plan est au service de l’odyssée du corps et de l’œil à travers une multiplicité de situations et un lacis de parcours possibles associant à l’expérience d’habiter le désir de l’« à venir » pressenti et la mémoire du passé parcouru. Cette architecture-là invente un type de labyrinthe tridimensionnel dont les points de fuite reconfigurent les lignes à chaque pas, et où, à l’inverse du dédale traditionnel, il ne s’agit pas de chercher l’issue au plus vite mais de remplir son temps dedans.
Architecture, dilatation, improduction
Pierre Caye
En savoir +Si la notion de développement durable apparaît si confuse et infondée, c’est qu’on la prend à contresens. On veut donner de la durée au développement comme si la durée était une simple qualité qu’il s’agit d’ajouter au développement. Or le temps n’est ni une substance ni quoi que ce soit qu’on puisse déterminer et manipuler à l’envi. Il faut bien plutôt inverser la polarité de l’expression « développement durable » : non pas ajouter du temps et de la durée au développement, mais plus fondamentalement penser en quoi notre rapport au temps est essentiel pour comprendre la forme de notre système productif. Cependant dans l’histoire de notre civilisation matérielle et technique, l’architecture nous aide à penser, mieux que toute autre action ou ouvrage de l’homme, le passage de la temporalisation à la production. L’architecture est le médiateur privilégié du temps à la production. Architecturer consiste à espacer, créer des intervalles, dilater. À travers ce travail de dilatation, l’architecture articule le rapport de l’espace et du temps. L’espace contribue à la construction du temps de même que le temps contribue à la construction de l’espace. Cette entre-construction de l’espace et du temps n’est possible qu’en raison de la médiation architecturale qui l’autorise et qu’il importe de questionner en tant que telle. Nous verrons alors que ce travail de médiation est essentiel pour comprendre en quoi l’architecture et son architecturer constituent depuis l’origine une véritable critique de la production à partir de laquelle seulement la notion de développement durable surmonte ses contradictions et ses apories.
Le déploiement des formes, architecturales entre autres
Augustin Berque
En savoir +Le dualisme cartésien a figé l’espace dans un arrêt sur objet abstrait du mouvement de l’existence. Heidegger a rejeté cette détemporalisation de l’espace, et soutenu au contraire que l’être des choses commence à partir de leur contour matériel au lieu de s’y borner. Les formes concrètes sont un processus relationnel en cours de déploiement, et non des objets figés dans leur en-soi. Le premier théoricien du paysage, Zong Bing (375-443), en avait fait un principe : « Quant au paysage, tout en ayant substance, il tend vers l’esprit. » Ce « tendre vers » est ce qui se passe entre le physique et le phénoménal. C’est le déploiement spatio-temporel qui institue l’objet en tant qu’il peut exister pour le sujet, comme les sciences de la nature elles-mêmes (tant la physique avec Heisenberg que la biologie avec Uexküll) l’ont reconnu au XXe siècle. Ce n’est ni l’objet en soi, ni le sujet en soi auxquels s’est bornée l’alternative moderne, mais bien ce « troisième et autre genre » que Platon, dans le Timée, avait reconnu au milieu concret (la chôra). Ce milieu où se déploient concrètement les formes n’est pas pensable selon le double principe d’identité et du tiers exclu qui a dominé le rationalisme grec et par la suite engendré le dualisme et le mécanicisme modernes. Le saisir exige une mésologique admettant le tiers, i.e. ce qui est à la fois A et non-A, telle la chôra, qui est à la fois empreinte et matrice de la genesis (les êtres relatifs du monde sensible). Cela dépasse donc le principe d’identité, lequel s’en tient à l’alternative soit A soit non-A. Ce mouvement a commencé avec la vie, qui a déployé la biosphère en dépassant l’identité à soi de la planète physique. Le mécanicisme moderne l’a interrompu lorsqu’il a prétendu s’appliquer à l’architecture ; car celle-ci, continuant ce mouvement, ne peut exister que dans le déploiement spatio-temporel de ses formes au-delà de l’identité.
Le temps comme atmosphère : vers une spectropoétique de l’architecture
Martin Bressani
En savoir +Traditionnellement, l’architecture a territorialisé le temps en créant de la durée. Par leur solidité et permanence, les palais, cathédrales, tombeaux et autres monuments classiquement au cœur de la discipline architecturale étaient autant de maisons éternelles liant le passé avec le présent. Mais le monument étant devenu synonyme d’oppression depuis au moins la Révolution française, ce rôle de bâtisseur de mémoire a été rejeté avec l’avènement de la modernité. L’architecte cherche désormais davantage à imaginer un futur émancipateur qu’à perpétuer une tradition. Pourtant l’héritage du passé reste un poids inéluctable : tout comme le philosophe ou le scientifique, l’architecte ne peut s’arracher à son horizon historique. Quelles sont alors les modalités actuelles de la présence du passé en architecture ? Comment combler le vide, le deuil, l’absence pour l’architecte déraciné ? Existe-t-il une poétique de la déliquescence du temps, le passé resurgissant de façon spectrale comme un retour du refoulé ?
Je propose une réflexion sur ce processus de « fantomisation » de l’histoire en architecture avec une emphase particulière sur l’historicisme du XIXe siècle. Comment, d’une présence active et normative, le passé s’est-il transformé en atmosphère, en une présence lourde d’affects qui habite le présent comme un spectre ? Cet article propose d’explorer cette « revenance » du passé.
Piranèse et l’image du temps
Erika Naginski
En savoir +Cette intervention a pour sujet les rapports entre l’archéologie « architecturalisée » de Piranèse et les courants intellectuels et esthétiques des Lumières européennes qui ont suscité un mouvement d’admiration à l’égard de l’ingénierie et du monumentalisme de la Rome antique. Nous nous proposons de montrer que l’approche rétrospective de la représentation architecturale adoptée par Piranèse tout à la fois s’inspire de la fusion d’éléments « artefactuels » décrits dans les traités anciens et fait appel à une compréhension des origines historiques de nature manifestement multiculturelle.
Plus peut-être que tout autre architecte de sa génération, Piranèse rattache ses gravures au drame du temps historique ; rejetant catégoriquement les sources grecques, il met en scène le triomphe de l’originalité romaine et de ses racines étrusques. On retrouve des échos de cette position controversée chez des philosophes comme Giambattista Vico, dont les écrits avançaient des arguments sur les origines multiples de la culture, ainsi que des penseurs politiques comme Montesquieu avec sa description de l’émergence et de la chute de la Rome antique, et aussi des historiens de l’Antiquité tels que Francesco Scipione Maffei, dont les travaux sur les artefacts et la langue étrusques ont mis en évidence l’importance des éléments archéologiques et linguistiques dans les explications historiques.
Au cœur de toutes ces problématiques réside la question de l’interprétation de la ruine en termes polémiques. En d’autres termes, il s’agira de sonder comment le collage de fragments divers sur lequel se fonde l’imaginaire architectural de Piranèse a été spécifiquement configuré comme une forme d’argumentation visuelle sur la Rome antique, sur son éthique inspirée – au sens d’authentiquement originale – et, plus généralement, sur la nature profondément temporalisée du processus créatif.
Les arrêts du temps
Francis Hofstein
En savoir +Prendre son temps, est-ce l’avoir ? Et l’avoir, ce qui est rassurant, n’est-ce pas risquer de le perdre, et donc d’en manquer ? Il vaut mieux alors lui imposer des limites, l’inscrire dans une durée, lui offrir un emploi. Cependant, comme le temps est un matériau à la réalité insaisissable et dont l’appréhension est essentiellement subjective, et comme bâtir est une forme de défi du temps, où s’exigent son arrêt, sa suspension pour que s’y inscrive un espace, il n’est pas sûr que cet emploi donne toute satisfaction. Le tout, même s’il se gâte, est de ne pas le tuer et de se contenter de l’assigner à résidence, puis, sans plus penser aux Parques, d’aller emprunter aux poètes leur panneau : Ralentir travaux.
Apocalypse et architecture
Philippe Potié
En savoir +L’apocalypse marque à la fois la fin des temps, la destruction de la « ville maudite », Babylone, et le « dévoilement » de la cité idéale, la Jérusalem céleste. La désintégration de la ville constituerait, pour reprendre le modèle biblique, le ressort temporel d’où « surgirait » (resugere, ressusciter) une vision nouvelle de la cité. Tout se passe comme si la « mise en ruine » opérait l’inauguration d’un projet. Un tel cycle, où le deuil préfigure une renaissance, donnerait corps à une dynamique visionnaire de l’architecture.
Nous proposons de suivre les démarches d’Aldo Rossi, Peter Eisenman ou Le Corbusier en y repérant ces petites mises à mort, ces apocalypses ordinaires, où meurent, s’oublient puis ressurgissent à la mémoire des images, des archétypes, qui sont autant de visions du futur. Une telle perspective permet de mieux saisir le nœud « temporel » où se joue aujourd’hui l’articulation ambiguë entre modernité, postmodernité et contemporanéité. L’apocalypse figurerait cette opération temporelle où vient se conjuguer le rationalisme iconoclaste du purisme moderne avec le délire iconophile postmoderne.
La structure, l’ornement et le temps
D’étranges vaisseaux venus d’ailleurs
Antoine Picon
En savoir +Depuis le XIXe siècle et l’œuvre de théoriciens comme Viollet-le-Duc ou Semper, une partie du problème posé par le rapport entre l’architecture et le temps passait par l’élucidation du lien entre architecture et structure, ou encore architecture et tectonique. La structure ou la tectonique contribuait en effet à inscrire la production architecturale dans le cadre de son époque. Ce rapport entre structure et tectonique, temporalité et historicité, s’appuyait également sur la réinterprétation de la question de la ruine comme révélatrice de la marque du temps sur l’édifice. La ruine contribuait en effet à révéler certaines articulations essentielles de la structure.
Il n’est pas fortuit que la remise en cause de l’approche structurelle par tout un pan de l’architecture numérique contemporaine s’accompagne d’une crise profonde du rapport au temps et à l’histoire. Après avoir évoqué les liens entre architecture, structure et question du temps qui s’étaient noués à partir du XIXe siècle, la communication proposée s’interrogera sur cette crise et sur les moyens d’y remédier.
Accélérer l’hésitation
Sarah Whiting
En savoir +Si le XXe siècle a été dominé par ce que l’on pourrait qualifier de logique textuelle, le XXIe se caractérise déjà comme un siècle visuel dans lequel l’image se substitue au monde. Nous lisons moins mais regardons davantage. Feuilletage des livres et parcours rapide des textes ont remplacé l’étude. L’accès toujours plus large à l’information conduit beaucoup d’entre nous à substituer les remarques aux idées, le catalogage au discernement, les icônes à l’architecture.
En quoi ce glissement de paradigme – vers un monde sans pause – affecte-t-il le discours architectural ? Plutôt que de se lamenter de manière prématurée sur la mort de la théorie architecturale, j’aimerais montrer que nous devons élaborer un discours de célérité au sein de notre culture contemporaine de l’image, ce qui permettrait d’ajuster le jugement, et donc le discours architectural à la vitesse du flux général. Et nous verrons que, paradoxalement, l’accélération du jugement pourrait bien nécessiter de conserver précieusement une lenteur délibérée.
Le monde de cristal : la théorie de l’éternel présent
Philip Ursprung
En savoir +Si l’on en croit certains théoriciens comme Michael Hardt et Antonio Negri, le monde industrialisé se rapprocherait d’un nouveau chronotope, un « éternel présent ». Quel lien pouvons-nous établir entre l’architecture et ce chronotope ? La prédilection de l’architecture pour la structure en boucle (l’éternel retour du même), son intérêt pour l’ambiance et l’attention qu’elle porte à des « événements » s’expliqueraient-ils par ce chronotope ?
Alors qu’au XXe siècle le théoricien adoptait une position statique afin d’être en mesure de saisir un environnement en mouvement permanent, n’est-il pas aujourd’hui en train d’inverser sa posture ? Celle-ci ne serait-elle pas désormais volatile et mouvante, non pas parce que le monde serait lui-même volatil, mais parce qu’il se serait précisément cristallisé ?