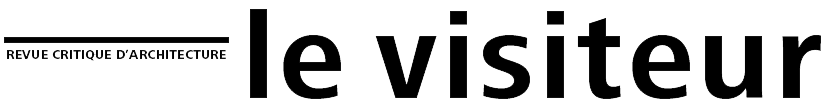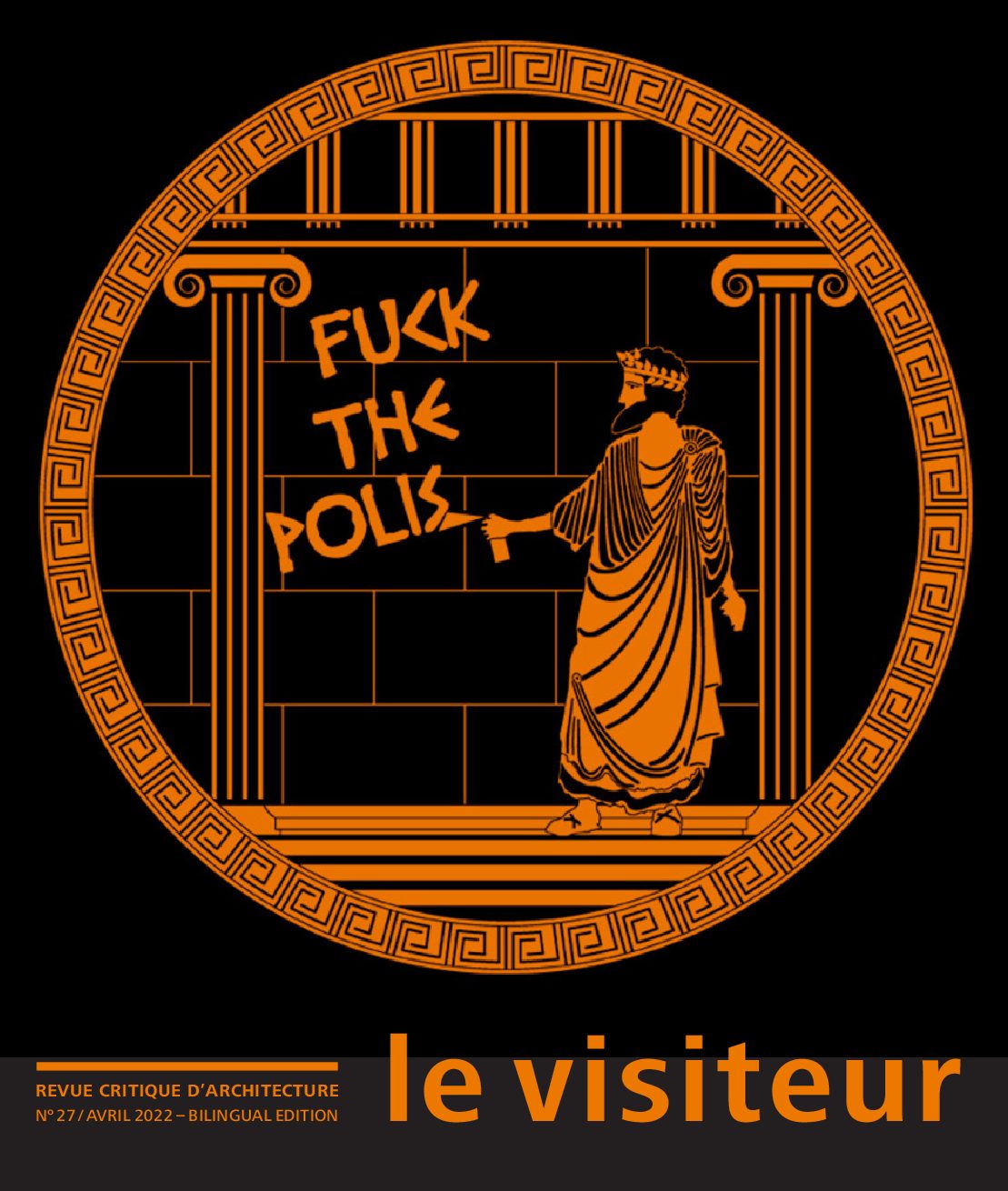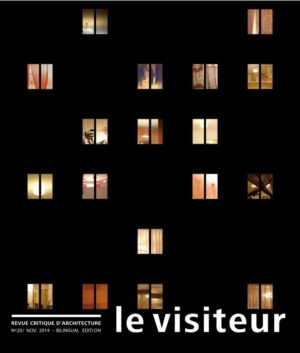Description
Date de publication: 2016
Éditorial : L’élan moderne
Karim Basbous
AfficherPour Baudelaire, « la modernité, c’est le transitoire, le fugitif, le contingent, la moitié de l’art, dont l’autre moitié est l’éternel et l’immuable ». Les mots demeurent, leur signification évolue : il en va ainsi du qualificatif « moderne », dont on se demande ce qu’il signifie aujourd’hui en architecture. Le Mouvement moderne s’était emparé de cette notion pour nommer un ensemble de nouveautés architecturales qui marquaient une rupture avec les conventions. Qu’en est-il depuis ? Pourquoi et comment ce grand mot est-il presque devenu, pour beaucoup d’architectes, un gros mot ? Par quel retournement ce qui représentait le futur se retrouve-t-il désormais associé au passé ? L’élan moderne est-il un moment de l’histoire ou une dynamique intellectuelle susceptible d’être renouvelée ? C’est ce débat que nous avons voulu ouvrir. J’ai souhaité pour ma part m’intéresser à la modernité non comme un attribut de la forme bâtie, mais comme une posture mentale : celle par laquelle l’esprit s’offre une liberté inhabituelle et subversive, à l’opposé des « écoles » qui en institutionnalisent les inventions. Cette liberté, c’est celle aussi avec laquelle les cultures locales se sont entremêlées à l’aspiration universelle de la modernité ; Jean-Louis Cohen analyse dans son article cette tension et le riche croisement des interférences qui ont nourri la scène architecturale et éditoriale.
Nul thème ne semble caractériser davantage l’architecture moderne que la continuité spatiale du dedans au dehors ; pourtant, à y regarder de plus près, elle a été interprétée d’une manière très différente en Europe et aux États-Unis ; Gwenaël Clément explore les vertus de l’horizon californien et de sa mise en scène dans un « art du regard » dont les maisons de l’après-guerre ont été le terrain d’expérimentation privilégié. Ce faisant, il nous instruit aussi sur les correspondances – un thème éminemment moderne et baudelairien – entre l’architecture et tous les arts du cadre.
Pour Le Corbusier aussi, le paysage fut un acteur de premier ordre. Il en a fait une construction, une abstraction qui permet de rendre le contexte immédiat moins important que la chose lointaine : l’horizon et la course des astres. La confrontation du proche et du distant, qui s’opère par l’association incongrue d’échelles différentes et d’objets divers, dans les bâtiments comme dans les natures mortes, recèle des significations latentes. David Diamond les explore dans les dessins et sur les lieux mêmes – comme La Tourette – que nous n’avons pas fini de connaître.
Le sens de la limite s’applique à l’espace : il s’applique également au temps. Le projet architectural comme art de « tenir la distance », cet invariant dont Olivier Gahinet relève les signes à travers les siècles, est mis en cause depuis que la vitesse du changement s’impose : l’auteur propose de penser la question écologique avec des mots, mais aussi avec des figures – théoriques – où sont résolues à la fois les difficultés du paysage urbain actuel et l’économie du projet.
Philippe Potié explore ce que l’on pourrait appeler un inconscient de la modernité, à l’ombre de la technique et du calcul : les projets manifestes du XXe siècle affirment la puissance et l’éloquence des matériaux issus de l’industrie mais, malgré cette revendication positive du progrès, ils demeurent en prise avec un passé archaïque dominé par la nature et ses mythes. Cette archéologie des figures et des traces qui persistent sous les discours trouvera sa résonance dans le beau texte de Pierre Bergounioux qui met en perspective l’histoire de l’Europe à travers le prisme des systèmes productifs dont découle l’ordre social : il suffit à l’auteur de relever quelques faits signifiants – tels que l’invention du collier d’épaules – pour illustrer l’accélération de l’histoire au fil des siècles, et dresser le dur constat de l’état de notre civilisation.
Trace, récit, le moderne est d’abord un projet. Celui d’Auguste Perret pour le centre du Havre est d’une grande cohérence ; l’unité apparente de cette œuvre dissimule pourtant une profonde dichotomie : d’un côté, l’accueil enthousiaste par le public des inventions modernes dans l’espace domestique, et, de l’autre, le rejet par ce même public des principes urbains qui s’y rattachent ; Pierre Gencey analyse et commente l’impossible conciliation de ces deux regards sur un même objet, symptomatique de la relation que le « grand public » entretient avec la modernité depuis un siècle. Pascal Q. Hofstein, quant à lui, analyse un autre objet moderne « clivant », la tour :; l’auteur voit en celle-ci, avant tout, un terrain de recherche sur la ville, et identifie deux grands types de tours dans l’histoire. Il cherche à en comprendre les aspirations esthétiques et sociales, à y déceler les tensions entre les impératifs de rentabilité et les ambitions urbaines, avant d’esquisser un « troisième type », théorique et encore en chantier.
La lumière est un matériau pour l’architecte comme pour le réalisateur : sa métamorphose à travers les différents mouvements cinématographiques et architecturaux reflète l’idée que chacun de ces arts se fait de lui-même. Une certaine lumière moderne – que François Prodromidès qualifie d’« inquiétante » – participe d’une mise en scène où le corps en mouvement est comme un acteur captif. Après tout, les habitants ne sont-ils pas les « personnages » de l’architecture, de même que les personnages d’un film « habitent » l’écran ? De la villa Savoye à la lumière solaire de L’Inconnu du lac en passant par la modernité exhibée de Mon oncle, l’auteur nous offre une promenade architecturale dans le cinéma où chacun des arts semble éclaircir l’autre.
Cinquante ans après sa mort, Le Corbusier suscite des polémiques dont la vivacité semble trahir une inquiétude – encore une, mais ici d’une autre nature. Antoine Picon en recherche les causes inavouées : elles ne résident pas, selon lui, dans la modernité, mais dans la phobie de la modernité, symptôme d’un malaise contemporain.
L’inscription d’un projet dans l’espace urbain implique, de fait, une inscription dans le temps : à ce titre, les grands gestes modernes sont partagés dans leur rapport à l’existant – entre, d’un côté, la table rase et, de l’autre, la soumission aux cultures locales –, mais aussi dans l’idée qu’ils se font de l’achèvement d’un projet – ou de son inachèvement délibéré pour accueillir le futur. David Leatherbarrow s’attache à montrer de quelle manière certains projets modernes, loin de rompre avec les traditions, ont su en emprunter des éléments, mais à des fins autres, renouvelées. La modernité a remis en question ce que l’on pourrait appeler l’adresse de l’art. En partant de cette question qui a opposé Stéphane Mallarmé à Léon Tolstoï, François Chevrier interroge le rapport de l’œuvre artistique et architecturale au public, en s’appuyant sur la danse.
Le thème de ce numéro du Visiteur interroge une capacité à articuler le passé avec l’avenir : c’est aussi le rôle d’une revue qui cherche à faire vivre les textes. Sans verser dans la nostalgie, on peut considérer qu’il y eut un âge d’or des revues d’architecture, du temps où leur nombre et leur contenu participaient d’un grand débat théorique ; elles ont porté alors des articles qui ont fait date. «The Pavilion and the Court[1]», de Richard Padovan, en est un. Nous avons choisi d’en publier la traduction française pour mettre à disposition de tous la pensée de ce grand intellectuel de l’architecture : un de ceux, peu nombreux finalement, qui aident à comprendre et à faire. Il offre ici un regard profondément original sur l’hétérogénéité du Mouvement moderne à sa naissance.
Dans la partie monographique de ce numéro du Visiteur, nous avons voulu rendre hommage au travail d’une grande architecte dont la pensée passe, elle, essentiellement par le projet. Édith Girard a pris part à tous les grands « élans » de sa génération. Son œuvre construite est un vivier d’inventions qui n’avait pas encore fait l’objet d’une analyse systématique : ses projets livrent une partie de leurs sens sous la plume de deux compagnons de route d’Édith : Patrick Germe et Jean-Patrick Fortin qui, chacun, se sont attachés à un aspect de son œuvre.
Édith Girard a fait du logement social un art, et un art complet : un moyen de construire la ville avec des tracés, des échelles et une typologie savante offrant une « situation » digne de ce nom pour chaque appartement. Elle en a fait aussi un moyen de concilier des aspirations opposées, de réinterpréter les modèles historiques et d’ouvrir le territoire pour accueillir le futur : en cela, elle est au cœur de l’élan moderne.
[1] Publié dans The Architectural Review, vol. 170, n° 1018, Londres, décembre 1981.
L’essor
Pierre Bergounioux
En savoir +La littérature est, depuis son apparition, à cinq mille ans d’ici, l’expression la plus précise des successives sociétés. Elle livre, par le biais du langage articulé, une version approchée d’un certain état de la civilisation, c’est-à-dire du stade atteint par le développement des forces productives et des rapports de production assortis, esclavagistes, féodaux, marchands…
Pendant le demi-millénaire où l’Europe a été le sujet de l’histoire, le texte écrit a épousé fidèlement son destin et chaque siècle a versé sa contribution à l’aventure des temps modernes. La Renaissance, qui croit revenir au passé, invente l’avenir, le Grand Siècle met en place les institutions politiques de l’État-nation, le XVIIIe siècle est celui des Lumières, le suivant, celui des révolutions.
La teneur du XXe siècle n’est pas encore définitivement fixée ou, alors, elle est composite et appelle plusieurs qualifications. Il a été celui des extrêmes, selon Eric Hobsbawn, mais aussi celui des loups et encore, selon Peter Sloterdijk, de l’explicitation et ce dans tous les domaines, scientifique et psychologique, technique, philosophique et politique, littéraire…
Si les architectes sont des hommes spéciaux, qui inscrivent dans le paysage, matériellement, l’esprit de leur temps, leurs actes sont chargés d’échos prolongés. On doit s’abriter, circuler, travailler.
L’architecture, comme tous les secteurs d’activité, est traversée par la contradiction qui anime le mouvement historique. D’un côté, les moyens, les vues sans précédent qu’elle tire du présent ; de l’autre, la tyrannie du capital financier, l’injustice tenace de nos sociétés, l’absence criante de projet politique, après l’implosion du socialisme réel.
C’est sur ces thèmes, les uns passés mais persistants parce que cristallisés dans la pierre, la brique, l’acier, les autres tout actuels et, par suite, incertains, que je brode.
Le verbe orphelin
Karim Basbous
En savoir +La modernité a progressivement pris son élan dans le vide laissé par la disparition de Dieu. En architecture, le long règne des « ordres » classiques, à l’aune desquels s’était mesurée la différence des styles, s’est éteint dans le bruit de la révolution industrielle et l’effervescence des avant-gardes. Cette rupture représente bien plus qu’un renouveau des doctrines, des idées et des figures. Elle révèle un renversement plus profond dans le rapport fondamental entre le sujet et le savoir auquel il s’adosse pour concevoir. Par ce renversement, le sujet ne se contente pas du cadre en vigueur à l’intérieur duquel tout projet architectural prend forme et fait sens : il va s’en extraire, pour déployer l’imaginaire ailleurs, au risque d’une mise en péril de la pensée elle-même. D’où la figure du héros, bientôt rattrapée par celle du père.
Je m’appuierai sur quelques-uns de ces porte-lumière qui jalonnent l’histoire du projet depuis la Renaissance pour observer la modernité en elle-même, indépendamment des modalités conjoncturelles par lesquelles elle s’est manifestée et qui tendent à la réduire à un style architectural ou à une idéologie, afin de lui rendre sa définition ontologique. Qu’est-ce qu’être moderne ? Quelle est cette posture depuis laquelle s’invente, hors du flot des projets ordinaires qui confirment la grammaire établie, une nouvelle langue qui prend forme dans l’atelier de soi, par un partage inédit – mais promis à l’universalité – entre les savoirs, la technique et la nature ?
« À qui veut », ou les aventures de la différence spatiale
Jean-François Chevrier
En savoir +En 1898, Mallarmé avançait cette formule en réponse aux critiques de Léon Tolstoï dans Qu’est-ce que l’art ? qui venait de paraître. La question de l’art était posée entre deux métropoles, aux deux extrémités de l’Europe. Il s’agissait de savoir à qui s’adressent les artistes. Tolstoï répond : au peuple, à tout le monde, sans exclusive. Il condamne « l’obscurité » de Mallarmé. Celui-ci répond que l’artiste ne s’adresse pas à tout le monde mais à qui veut : un public socialement et idéologiquement indéterminé, constitué toutefois d’individus favorablement disposés, suffisamment intéressés.
La controverse qui opposa les deux écrivains, le romancier évangélique et le poète athée, est datée, mais elle éclaire la situation actuelle. La question de l’art posée en termes d’adresse concerne la définition du public moderne et celle de toute communauté constituée dans la sphère publique. Elle concerne également la différence spatiale, et par là même l’architecture et la politique urbaine.
Inter, bi, ou transnationale ? L’architecture moderne à l’épreuve des frontières
Jean-Louis Cohen
En savoir +Les frontières nationales – d’ailleurs mouvantes au XXe siècle pour ce qui est de l’Europe – ont été poreuses aux idéaux et aux formes de l’architecture dite « moderne ». L’inscription dans un mouvement international a été revendiquée par beaucoup d’architectes radicaux, si tant est que cette épithète ait un sens, ce qu’ils ont payé au prix fort dans les phases de réaction, de la Russie à l’Allemagne et à l’Espagne.
Dans le même temps, les tentatives n’ont pas manqué pour faire des stylèmes modernes des éléments constitutifs de nouvelles identités nationales, de la Finlande au Brésil, en passant par la Tchécoslovaquie. Pourtant, en rester à la dialectique entre les dispositifs internationaux, tels que les Congrès internationaux d’architecture moderne et leurs avatars, les Rencontres internationales fondées par Pierre Vago, ou les divers réseaux de la réforme urbaine, d’une part, et les groupes et les professionnels nationaux, d’autre part, serait trompeur.
Informées par des représentations complexes, parfois anciennes, les interférences entre les cultures nationales et les relations bilatérales ont été non moins intenses – que l’on pense au rôle de la revue L’Art sacré dans l’architecture religieuse d’après 1945. Observer certaines d’entre elles au travers de projets les cristallisant permettra de saisir plus finement les visages distincts que l’architecture de la modernité aura empruntés entre le cycle de son instauration et celui de sa crise fatale.
Réalités possibles et possibilités réelles : l’architecture à l’âge moderne
David Leatherbarrow
En savoir +Les idées de modernité et de conception de projet qui ont été développées dans l’architecture du début du XXe siècle se renforcent l’une l’autre. Pour les tenants de la nouvelle architecture il ne faisait aucun doute que le siècle nouveau allait être une époque de profonds changements historiques. Ils avaient également toute confiance dans le rôle que seraient appelées à jouer leurs conceptions : le paysage de la vie moderne serait le produit d’imaginations en phase avec des conditions qui s’étaient transformées de façon spectaculaire – aussi éloignées du monde vécu que fussent leurs visions. Pourtant, à mesure que s’écoulèrent les années puis les décennies de la période moderne, les adhésions aux circonstances préexistantes, voire aux traditions, en vinrent à être considérées comme inévitables lorsque des sites, programmes et constructeurs réels furent utilisés comme des matériaux de la réalisation de projets. Mon intervention tentera de répondre à une seule question : quel lien existe-t-il entre les « réalités possibles » imaginées dans les premiers projets modernes et les « possibilités réelles » de construire le monde moderne ?
L’acier et l’onyx, la dualité archaïque de la modernité
Philippe Potié
En savoir +Le récit héroïque de la modernité, dont Giedion fut l’un des propagandistes les plus passionnés, s’il eut le mérite de galvaniser une avant-garde, préparait par un mouvement inverse des lendemains dont le désenchantement était à la mesure des espérances. Aujourd’hui, le travail de deuil de cette modernité ardente étant achevé, s’ouvre un droit d’inventaire plus serein qui met au jour des structures de pensée plus profondes. Moins doctrinale, plus complexe, mais plus riche aussi, l’une des structures que nous voulons ici mettre en évidence semble s’être construite non sur un récit apologétique univoque, mais sur le dualisme antithétique que synthétise le couple nature/culture dont Lévi-Strauss avait révélé la puissance générative dans la construction du récit mythologique. On montrera, dans cette perspective, comment les œuvres les plus célébrées de la modernité mettaient en scène la « machine au pouvoir » sur fond d’un chant élégiaque glorifiant les forces primitives de la nature. Plus encore, on se propose de lire la modernité comme la tentative toujours renouvelée d’une figuration du dualisme archaïque opposant la technique prométhéenne aux puissances souterraines de Gaïa, la terre mère. Traversant l’histoire de la modernité depuis le pavillon de Barcelone en passant par les dernières œuvres de Wright, on tracera une ligne où l’émergence de Ronchamp prend tout son sens. On saisira par là même le lien profond qui lie, dans une perspective inquiète, l’inexorable accélération du temps technologique au rythme immuable du cycle de vie d’une terre primordiale. On découvrira en chemin comment cette modernité portait en elle les germes d’une déconstruction postmoderne qui apparaît comme leurs résurgences naturelles.
Un paradis domestique dans l’enfer urbain
Pierre Gencey
En savoir +Le Mouvement moderne s’est inspiré des récits utopiques pour réinventer la ville, la rue, la maison, la cuisine et même la chaise. Il a partiellement réussi son entreprise puisque, dans la plupart de nos logements, le confort s’assume encore dans le rationalisme et l’hygiénisme, se renforçant par la présence d’objets techniques, innovants et standardisés. On peut tracer le phénomène en remontant jusqu’à la Seconde Guerre mondiale quand, face aux enjeux urbains d’expansion et de reconstruction, tous les médias s’intéressent à l’habitation. Cependant, à cette dilution apparemment réussie de la modernité dans la sphère du logement, s’oppose un violent rejet dans la sphère urbaine : la cité rationnelle et hygiénique, technicisée et standardisée, évoque plutôt les images infernales des romans contre-utopiques que l’idéal du progrès. Pourquoi cette divergence, cet antagonisme ?
Le regard porté actuellement sur la reconstruction du Havre et sur son appartement témoin, œuvre de l’Atelier d’Auguste Perret et du décorateur René Gabriel, peut ouvrir quelques pistes : dans le confinement domestique, la décoration laisse à chaque individu l’illusion du choix et la sensation d’une amélioration de sa vie intime, comme si la collectivité était passée à son service et cherchait à le libérer ; dans le milieu urbain, la construction moderne impose une soumission d’ordre esthétique. Dès lors, tout s’inverse…
La lumière inquiétante
François Prodromidès
En savoir +En 1930, un film muet est réalisé à la villa Savoye de Le Corbusier, à peine inaugurée, par Pierre Chenal : Architecture d’aujourd’hui. Précédant la présentation de la salle de séjour, un carton annonçait : « Cette prise de vues a été réalisée sans le secours de lumière artificielle. » Le fait architectural rencontrait ainsi la prise de vues cinématographique sous le signe d’une déclaration de modernité, dont la lumière naturelle était un acteur essentiel : les intérieurs pouvaient maintenant être filmés nus, sans projecteurs, c’était l’espace même qui rachetait le peu de sensibilité des pellicules, c’était la rupture photogénique du temps. En 2014, j’ai été amené à mon tour à filmer cette même villa. La découvrant pour la première fois, l’omniprésence de la lumière m’a semblé plutôt, sinon aveuglante, du moins inquiétante : où loger son regard dans ce plein feu de la machine à habiter ? Promenant mon regard dans la maison, je repensais alors à quelques cinéastes que ces questions de cadre, de lumière et d’espace moderne avaient préoccupés. Je me souvenais que la lumière naturelle était également une conquête de la modernité cinématographique, et je m’interrogeais sur le rôle qu’on voulait lui faire jouer dans le petit théâtre bourgeois des Savoye.
L’emprunt du paysage et l’énigme de Corbu
David Diamond
En savoir +Cet essai examine la primauté du paysage dans l’œuvre de Le Corbusier : le paysage réel et symbolique, le paysage mis en abîme, et le paysage comme métaphore de l’ordre naturel.
Pour Le Corbusier, les techniques d’emprunt du paysage deviennent un moyen pour le bâtiment d’entrer en contact avec son contexte. À l’image de ce que font les photographes et artistes graphiques quand ils recadrent et arrangent des images en de nouveaux réseaux d’associations, le « paysage emprunté » corbuséen vise à démanteler les habitudes visuelles. Il distord le temps et l’espace par des juxtapositions irrationnelles qui font prévaloir l’illusion sur la connaissance objective du monde.
Les projets auxquels je m’intéresse ne sont pas soumis à leur contexte immédiat ; ils entrent plutôt en dialogue avec des données plus lointaines, parfois urbaines, souvent topographiques, et, dans les dernières œuvres, essentiellement liées aux cycles du temps diurne et calendaire. En déployant ces nouvelles relations, Le Corbusier s’engage dans une communication secrète avec un public qui, par sa perspicacité, son attention et sa patience, a acquis des yeux pour voir.
L’horizon américain
Gwenaël Clément
En savoir +En 1953, le Cinémascope, procédé qui consiste à comprimer l’image à la prise de vues pour la dilater lors de la projection, est utilisé pour la première fois par la 20th Century Fox. Le cinéma américain profite de cette innovation pour prendre l’air, sortir des studios et restituer les grands paysages naturels sur les nouveaux écrans panoramiques. L’élargissement du champ de la caméra et les différents travellings vont dès lors transformer les étendues naturelles en spectacle pour les salles obscures.
En 1960, deux architectes vont chacun livrer une maison plate sur l’un de ces terrains des collines de Los Angeles que l’on dit peu propices à la construction du fait de leur déclivité. Ces projets sont emblématiques d’un nouveau rapport au paysage. John Lautner, avec la Chesmosphere House, et Pierre Koenig, avec la Stahl House, vont dessiner des espaces qui échappent aux premiers plans pour bénéficier d’une vue sans fin. Au principe moderne de continuité visuelle et pédestre entre l’intérieur et l’extérieur immédiat, apanage du binôme traditionnel de la maison et de son jardin selon les principes modernes, Koenig et Lautner substituent l’idée d’un « périmètre hors sol », ouvert largement et exclusivement sur le lointain. L’idée d’un face-à-face avec le grand paysage semble alors remplacer le principe de continuum spatial comme paradigme de la modernité. Dans ce dessein, l’horizon va tendre à se rapprocher, s’inviter à demeure, jusqu’à prendre entièrement possession des lieux pour leur imposer sa propre mise en scène. Dans ce nouveau rapport à l’extérieur, qui fait écho au Cinémascope, c’est la manière d’être au monde qui s’en trouve transformée. C’est cette autre modernité, qui présente une voie parallèle dont la portée reste à révéler, qui fait l’objet de ce texte.
Défier le monde
Pascal Q. Hofstein
En savoir +La tour, bâtiment emblématique d’une conquête verticale, s’est distinguée comme un objet s’affichant tantôt comme prouesse technologique, tantôt comme signal singulier sur l’horizon. De la Cathedral of Learning à Pittsburgh aux tours contemporaines en passant par les grands halls de John Portman, on en relève deux types : le premier traduit l’objectif de rentabilité par l’empilement des planchers, le second, plus généreux, évide une partie de la tour pour y loger un rez-de-chaussée monumental par sa hauteur.
Je m’intéresserai à une troisième manière, plus ambitieuse car elle prend toute la mesure de la hauteur, laquelle n’est pas tant un objectif en soi qu’un moyen. Cette troisième voie renverse les références habituelles : elle redresse le sol en intégrant en altitude des programmes du rez-de-chaussée urbain traditionnel, et elle rabat le ciel comme un tableau.
Tenir la distance
Olivier Gahinet
En savoir +Depuis le début de la modernité (que nous ferons commencer, avec Erwin Panofsky, « à la mort de Goethe ») deux tendances apparemment contradictoires existent dans l’architecture : la première voit dans le projet le moyen de transformer le monde ; la seconde a la permanence comme objectif. Volonté de transformation d’un côté, désir de durer de l’autre : la synthèse, quand elle se fera, aboutira à des lieux hors du temps, semblant être disponibles pour toujours et susceptibles d’abriter les nostalgies à venir.
Cette modernité s’est construite en lien avec la révolution industrielle. Aujourd’hui, une nouvelle révolution est nécessaire : celle qui accompagnerait une nécessaire « déprise » de l’homme sur la Terre (dont la lutte contre le changement climatique est un des aspects) ; celle qui laisserait leur place à nos commensaux sur la planète ; celle qui restaurerait la dignité et la souveraineté de l’homme sur lui-même.
On se demandera quelle « architecture de la parcimonie » pourrait accompagner cette révolution future, et quels espaces pourraient être à leur tour les lieux de mémoire à venir, pour continuer l’aventure moderne en habitant, enfin, le temps.
Au secours ! Le Corbusier revient, ou de la difficulté d’être postmoderne
Antoine Picon
En savoir +Le cinquantenaire de la mort de Le Corbusier a été marqué par de très nombreuses manifestations célébrant une œuvre imposante d’architecte, d’urbaniste, de dessinateur et de peintre. Mais cet anniversaire a aussi été marqué par une polémique concernant les inclinations fascisantes de Le Corbusier dans les années 1930, son antisémitisme ainsi que son comportement sous Vichy. Sans entrer dans les détails de cette polémique, l’article s’interroge sur les raisons profondes qui lui ont donné naissance, à commencer par un refus de la modernité urbanistique et architecturale assez répandu, alors même que la modernité a cessé de régner sur les centres-villes et les banlieues. Non sans quelque paradoxe, ce refus de la modernité pourrait bien cacher une angoisse autrement plus fondamentale devant une condition postmoderne qui apparaît plus menaçante encore aux yeux de certains que la modernité héroïque qu’incarne la figure de Le Corbusier.
La cour et le pavillon
Le problème de la culture et de l’espace dans l’architecture De Stijl
Richard Padovan
En savoir +Le Corbusier et Theo van Doesburg se sont rencontrés pour la première fois dans la galerie parisienne L’Effort moderne, lors de l’exposition organisée par le second autour de l’architecture De Stijl. Cette rencontre représente le choc de deux principes opposés au sein de l’architecture moderne.
Le premier est l’idéal du pavillon en tant qu’objet isolé dans l’espace de la nature. On peut en suivre la trace depuis les essais de Laugier et Rousseau, puis au XIXe siècle, dans les villas romantiques situées à l’extérieur des villes, jusqu’aux prairie houses de Wright. Ce modèle s’oppose à celui de la cour, qui s’incarne dans les demeures fortifiées et les places des villes densément peuplées.
Le conflit qui a opposé ces deux principes s’éteindra en 1929 avec le pavillon de Barcelone et la villa Savoye : l’un est un pavillon dans une cour, tandis que l’autre installe une cour dans un pavillon. Mais cet état d’apaisement n’était que momentané. Cet article analyse la raison de cet échec, qui réside dans des conflits non résolus à l’intérieur même de la société : entre les besoins de la communauté et ceux de l’individu, entre liberté et égalité.
« L’écrin du paysage »
Patrick Germe
En savoir +Édith Girard appartient à la « génération critique » qui émerge des ruines de l’École des beaux-arts à la fin des années 1970. Comment a-t-elle pu s’engager dans l’architecture loin des démarches sectaires ? Comment a-t-elle construit un enseignement et une œuvre ouvrant sur une « nouvelle réalité » ? Cet article explore différents jalons fondateurs d’une architecture urbaine moderne : le lieu à l’épreuve de l’altérité, la représentation de l’extérieur à l’intérieur, l’intimité à l’échelle collective, et la cour comme espace principal de l’immeuble de logements et volume ouvert.
La strada novissima d’Édith Girard
Jean-Patrick Fortin
En savoir +Dès sa première œuvre en 1983, la rue Carnot à Stains, Édith Girard (1949-2014) devient une figure majeure de la critique du postmodernisme dominant. Comment a-t-elle pu faire d’une modeste route de banlieue une strada novissima ? Le projet de Stains prend en charge toutes les dimensions de la ville : la continuité du temps historique et la continuité de l’espace – ici, la banlieue –, la science des tracés, la profondeur des vues, le rôle du logement collectif, le sol et la marche à pied, l’organisation des programmes, le territoire. Tandis que les grands ensembles proposaient une présence lâche, sans tension et sans orientation, la strada novissima d’Édith Girard offre une présence englobante par ses mesures et ses proportions. Ville signifiante, elle sollicite l’émotion du citoyen : la critique, comme les institutions, en resteront sans voix.