Description
Date de publication: 2017
Éditorial : Le beau et le laid
Karim Basbous
AfficherL’architecture a commerce avec le beau, mais ce rapport s’est distendu avec le temps. La dimension esthétique au sens traditionnel du terme est-elle devenue marginale en architecture ? Rien n’est moins sûr, car le beau peut occuper l’esprit sans être pleinement assumé. Nous avons souhaité traiter cette question sous un jour nouveau, en nous intéressant au laid comme au beau. Ces deux notions entretiennent des rapports plus complexes que la simple antinomie (tout ce qui n’est pas beau n’est pas laid pour autant) ; chacune de ces deux notions habite notre quotidien, et l’on croit savoir si une chose est belle ou laide sans devoir préciser ce qu’on entend par là, ou ce que sont le beau et le laid.
À la fois savantes et communes, ces notions ont pu être utilisées différemment suivant les arts, où elles ont contribué à évaluer les œuvres. Mais nous ne savons pas toujours à quels savoirs, concepts ou principes on s’adosse lorsqu’on use de ces adjectifs, ni quelle relation au style, au goût, à la faculté de juger ces notions entretiennent. Plus qu’avec les objets eux-mêmes, elles ont à voir avec le regard que l’on porte sur eux et qui évolue sans cesse : l’histoire est riche de revirements par lesquels telle œuvre se voit déchue, tandis qu’une autre gagne peu à peu les faveurs du public ; ce fut le cas notamment de la tour Eiffel et du Centre Pompidou, que l’on a appris à aimer. Si on ne les trouve plus laids, les trouve-t-on beaux pour autant ? Peut-être le beau et le laid se mêlent-ils parfois désormais, et l’on peut se demander quelle place ont encore ces critères dans le jugement critique sur le monde bâti à ses multiples échelles, depuis le détail jusqu’au paysage, en passant par les quartiers et les villes.
Chacun de ces deux mots est chargé d’une longue histoire, elle-même faite de profondes mutations intellectuelles et sociales, et nous avons souhaité ici traiter aussi bien les appréciations passées et contemporaines du beau et du laid : ces deux notions résistent en effet à tout cantonnement historique. La beauté, qui a longtemps été un critère de la qualité architecturale, n’est plus guère mise au premier plan par les architectes. Ma contribution est consacrée à la gravité, dont le beau en architecture pourrait n’être considéré que comme une conséquence. Entendue dans les deux sens du terme, cette notion peut être considérée depuis l’Antiquité comme le « pourvoyeur de sens » de la forme architecturale : l’architecture peut-elle s’en défaire sans déchoir en une marchandise soumise aux aléas de la mode ?
La beauté a une histoire : de toutes les époques, la Renaissance est assurément celle où elle fut le plus théorisée ; la beauté y est d’abord canonique et s’y affirme comme « mesure », mais Yves Hersant montre comment est apparue au fil des siècles une autre forme de beauté, fugace, fragile et plus difficile à définir : la grâce, notion subtile dont le lecteur appréciera l’actualité. Du XVe au XXe siècle, le corps est le témoin le plus éloquent des transformations de la conception du beau en Occident. C’est à lui que s’intéresse Georges Vigarello qui examine dans son article les mutations du vêtement et des postures, qui sont une mise en scène de soi. Ce corps est celui-là même qui habite l’architecture, seul art à pouvoir concilier l’utile et le beau, voire l’utile et le sublime, comme l’examine Baldine Saint Girons qui étudie le rapport qu’entretiennent ces deux notions dans un article où la densité et la profusion des idées ouvrent de multiples pistes de réflexion. Cette question du rapport entre l’utile et le beau, souvent disputée, donnera lieu, entre les deux guerres, à une « querelle des modernes » : le lyrisme de Le Corbusier et le fonctionnalisme « strict » de ses détracteurs se sont opposés à l’occasion du projet du Mundaneum ; Guillemette Morel Journel retrace et commente cette joute intellectuelle qui confirme l’impossibilité de « ranger » Le Corbusier dans une école de pensée ou une famille idéologique.
Les débats de ce type entre architectes sont rares aujourd’hui. Le jugement trop immédiat – hier dans les journaux, aujourd’hui sur les écrans – ne peut discerner les grandes évolutions culturelles : seule une lente maturation intellectuelle parvient à intégrer les nouvelles représentations du beau. Bruno Reichlin médite la fonction non seulement du temps, mais aussi de la connaissance et de « la part de soi » dans le jugement esthétique de l’art et de l’architecture modernes. On peut se demander, d’ailleurs, si l’« étrangeté » actuelle de certains projets peut être considérée ou non comme une nouvelle forme du beau, en attente d’être assimilée. C’est la question que pose Bruno Marchand dans l’article qu’il consacre à l’œuvre de Valerio Olgiati, dont les curiosités structurelles défendent la possibilité d’une « région esthétique » à la lisière du beau et du laid, de l’ordre et du désordre. La contribution de Marie-José Mondzain est également consacrée à cette dichotomie, mais à travers la philosophie, la poésie et le cinéma, pour sonder l’énigme que recouvre l’événement exclamatif : « Que c’est beau ! »
Certains objets échappent à l’opposition des deux termes : la ruine, notamment, qui fascine – consciemment ou pas – le monde contemporain ; François-Frédéric Muller en explore les multiples significations par le biais d’une fiction qui éclaire le pouvoir des images aujourd’hui, dans un récit dont la forme est le territoire. Enfin, dans une réflexion magistrale sur l’état présent de la production bâtie, Franco Purini oppose la face sombre de la ville – largement représentée dans le cinéma et la littérature, et dont il montre la fascination qu’elle peut exercer – aux visions solaires et progressistes que les « maîtres modernes » ont défendues ; surmonter aujourd’hui la contradiction entre ces deux aspects de la ville appelle une culture du projet architectural et urbain encore inexistante, mais nécessaire : il nous la fait entrevoir.
La structure Dom-ino n’est ni belle ni laide ; elle installe un espace de liberté que Le Corbusier va explorer tout au long de sa carrière, pour réinventer à chaque projet de maison un ordre inédit entre la structure et l’espace. Olivier Gahinet nous fait voir le fil d’Ariane qui les relie, et la manière dont l’architecte a regardé son propre travail pour projeter. À la lecture de cet article, les « familles » de projets qu’identifient les historiens deviennent les « chapitres » d’un récit dont la suite demeure à écrire, ou plutôt à dessiner.
Nouvelle jeunesse de la ruine
François-Frédéric Muller
En savoir +À l’apparition du goût pour la ruine, c’est l’objet antique qui frappe l’imagination. Les tambours des colonnes effondrées ramènent le spectateur plusieurs siècles en arrière. La beauté frissonnante des cadavres de pierre évoque un âge d’or perdu qui sert de modèle. Plus tard, les romantiques entretiennent cette fascination ambivalente pour les monuments éventrés, moins pour nourrir les utopies que pour jouer avec les limites de la beauté et de la laideur. Si une grande partie de la littérature contemporaine perpétue cet amour de la ruine apprivoisée, les industries du jeu vidéo et du cinéma nous saturent d’images de villes détruites dans des convulsions de fin du monde. La ruine n’est plus un objet inerte, elle se fabrique sous nos yeux. Elle n’est plus l’engrais pour le monde à venir mais le spectacle sans cesse renouvelé de notre fin. Dans une complaisance nihiliste d’adolescent attardé, l’image de la ville agonisante est devenue un produit. On ne fera pas un lien direct entre cet univers visuel et la production contemporaine. On cherchera plutôt en quoi ce nouvel âge de la ruine nous renseigne sur notre expérience de la ville postmoderne, en quoi cette vision toujours renouvelée de la fin de l’histoire confère à des bâtiments d’une laideur commune la beauté étrange d’un freak.
L’architecture sans gravité
Karim Basbous
En savoir +Le beau architectural est une récompense : il se manifeste lorsque le projet ne cherche pas à plaire, mais se laisse investir de symboles qui le dépassent, lesquels à leur tour portent le sens du projet au-delà de l’actualité. Dans l’œuvre des maîtres du XXe siècle, la raison et le mystère se disputent les figures, scellant la dimension tragique du fait architectural. Les épopées de Wright, Le Corbusier, Kahn et Aalto sont écrites avec des œuvres inattendues, plénières et souveraines, dédaignant toute causalité technique et pratique, toute facilité et tout compromis. Elles ont élevé pour une dernière fois le projet architectural au rang d’héroïsme. Ce prestige a vécu. Le postmodernisme y a mis fin en destituant le projet, et en vulgarisant le goût de l’architecture (dans les deux sens du terme : répandre largement, et rendre grossier). Depuis, l’idéal véhiculé et promu est celui d’une émancipation à outrance : libéré du savoir, de la mémoire et des combats, de toute instance et de toute responsabilité sociale, le projet architectural peut enfin goûter à la légèreté absolue et inconditionnelle. La comédie a pris sa revanche sur la tragédie. Aux grands récits on préfère désormais les « petites histoires », et l’architecture du plaisir initiatique a cédé la place à celle de l’amusement trivial. Pourquoi et comment l’ambition d’un savoir universel a pu être remplacée par la satisfaction d’un folklore global ? Comprendre cette destitution est un préalable pour imaginer quel régime de valeurs peut naître des ruines de l’ancien.
La ville du bien et la ville du mal, ou du beau et du laid
Franco Purini
En savoir +L’architecture est un art du meilleur : elle doit rendre toujours plus libres et heureux ceux qui habitent cette terre. Elle ne devrait donc pas se livrer aux expressions de la douleur, de l’inconfort, de la désorientation, du danger, de la laideur ou du mal, mais se dédier exclusivement à accueillir, apaiser, œuvrer au beau et faire le bien. Toutefois, il n’en va pas ainsi. Le langage de l’architecture est imbriqué dans un complexe d’autres langues au sein desquelles, à l’instar de la poésie, de la littérature, de l’art, du cinéma ou du théâtre, le négatif est omniprésent. Ces langues souillent constamment l’architecture, d’où la dialectique du beau et du laid. Or cette dialectique n’a pour objet que la suprématie du beau. De ce point de vue, il est du plus grand intérêt de comprendre comment la notion de beauté, qui est liée pour moi à un idéal de rationalité comme forme invariante du classique, est régulièrement amenée à contrer son renversement, comme si ce que l’on désigne comme un beau neuf devait fatalement être le contraire du beau obsolète. En ce sens, la catégorie de l’antigrazioso du futurisme est un nœud fondamental, comme le fut en son temps la poésie romantique du XIXe siècle.
Un tas d’ordures assemblées au hasard : le plus bel ordre du monde
Marie-José Mondzain
En savoir +Le beau et le laid ne spécifient pas deux régimes contradictoires propres à la forme des choses ou des êtres, mais sans doute deux régimes de notre sensibilité en présence de l’apparition de ces formes. Pour ne pas sombrer dans le double écueil d’une distribution normative des valeurs ou d’un relativisme tantôt sceptique et tantôt savant, pourrait-on revenir à ces territoires confus et contradictoires où la pensée grecque, par exemple, notamment Héraclite à qui j’emprunte le titre de mon texte, tentait de penser ensemble la forme et l’informe, le Cosmos et le Chaos. Dès lors, les régimes de sensibilité laisseront entrevoir les ambivalences pulsionnelles où voisinent l’angoisse et la jouissance, la fascination et l’effroi. Il ne s’agit pas de célébrer de complaisantes confusions mais plutôt de faire émerger une zone d’indétermination qui donne leur frappe politique aux choix des formes et à l’usage des mots. C’est à la liberté des gestes et à la joie éprouvée devant les formes quelles qu’elles soient que l’on peut légitimer un recours au lexique de la beauté et de la laideur.
Y a-t-il un sublime de l’utile ? Les pouvoirs de l’architecture et la minute du sublime
Baldine Saint Girons
En savoir +En 1746, Charles Batteux refusait encore de considérer l’architecture comme un des beaux-arts. Aussi bien la regroupa-t-il avec l’éloquence dans la classe des arts de la commodité ou des arts du service. Autant dire que l’entrée de l’architecture dans la nouvelle science qui allait devenir l’esthétique n’allait aucunement de soi. Et ce n’est donc pas étonnant si, aujourd’hui encore, l’architecture oblige à repenser l’esthétique en remettant en cause les idées de beau et de sublime, de contemplation désintéressée, d’espace fictif ou de plaisir esthétique.
Le beau lui-même frappe par son ambivalence. Objet d’enthousiasme et d’amour, il est également source de déception en tant que simple phénomène de surface et de tromperie lorsque lui manque la solidité de l’utile. Si les liens de l’architecture au beau ont été à ce point mis en question, pourrait-on créditer l’art d’édifier de sublime en adoptant une solution tierce entre la revendication d’un fonctionnalisme exacerbé et l’apologie d’une architecture sublime, exclusive de l’utile ? Bref, faut-il aller jusqu’au bout de la réversion utilitariste, conçue par Hegel comme un « résultat » de l’Aufklärung, et prôner, sous certaines conditions, un sublime de l’utile qui nous reconduise au réel, sans sombrer dans l’abstraction de l’inconstructible ou la dangerosité de l’inquiétant ?
Du beau au gracieux
Yves Hersant
En savoir +Selon la conception « classique », telle que la défendent nombre d’auteurs de la Renaissance, le beau dépend de l’harmonie, c’est-à-dire de la juste combinaison ou disposition des parties : il serait affaire de proportions. Mais certains, ne se satisfaisant pas de cette approche quantitative, ajoutent (ou opposent) un élément qualitatif ; ainsi naissent diverses théories de la grâce, dont celle qui considère comme gracieux ce qui semble accompli sans effort. De ces débats ont résulté des notions nouvelles, comme celle de sprezzatura, et une série de questions : faut-il considérer que l’ordre et la mesure se manifestent gracieusement, ou bien la grâce échappe-t-elle à toute mesure ? Grâce et beauté se complètent-elles, ou s’opposent-elles ? Et dans le cas de l’architecture, selon quels critères pourrait-on dire d’un bâtiment qu’il est gracieux ?
Les transformations du corps et de la beauté
Georges Vigarello
En savoir +La recherche toute traditionnelle et classique des proportions idéales du corps fait d’emblée penser à une quasi-« éternité » des critères de beauté physique : ils traversent apparemment le temps. Le constat plus trivial de la transformation des modes et des sensibilités dans l’histoire fait en revanche penser aux changements de ces critères : leur instabilité dans le temps. Rien de discutable, rien de négligeable sans doute aussi, dans de tels changements. Reste que l’interrogation à leur égard doit porter en priorité sur leur contenu précis. Elle doit porter encore sur leur signification : leur convergence possible, par exemple, avec la culture et la mentalité d’une époque. S’y ajoute le fait que la matérialité du corps change à son tour, non seulement la consistance des chairs, non seulement la stature ou la santé, mais la vision de sa résistance et de son efficacité. Une histoire de la beauté physique ne peut de ce fait être dissociée d’une histoire de l’existence du corps et de son versant le plus concret. C’est à de telles confrontations que sera consacré cet exposé sur les transformations du corps et de la beauté.
Beauté et modernité – A propos d’une controverse entre architectes « modernes »
Guillemette Morel Journel
En savoir +La catégorie du beau n’est guère de mise dans les arts et l’architecture d’aujourd’hui. Il y eut pourtant un épisode de l’histoire de l’architecture où un architecte s’est emparé de la beauté pour en faire frontalement un enjeu de la modernité, et ce au péril de sa réputation. En 1929, Le Corbusier répondit à ses détracteurs de la Neue Sachlichkeit (Nouvelle Objectivité), qui l’accusaient d’avoir conçu un projet académique pour le Mundaneum de Genève en forme de ziggourat, par un long texte significativement intitulé « Défense de l’architecture ». Un des slogans les plus marquants en était : « L’utile n’est pas le beau. »
En n’hésitant pas à affronter de plein fouet l’ire de ses compagnons de route, Le Corbusier affirme que la beauté transcende les postures idéologiques et formalistes et garde, quels que soient les styles par lesquels elle est exprimée, une pertinence au cœur même du projet moderne.
Méfions-nous du beau
Bruno Reichlin
En savoir +Les notions de beau et de laid se heurtent à un obstacle épistémologique : elles laissent croire qu’on a affaire à des « choses » dont on jauge les qualités. Or la dimension esthétique est une propriété relationnelle et non pas une propriété d’objet et la relation esthétique est intentionnelle et spécifique dans le sens où l’on peut la distinguer d’autres activités représentationnelles. En effet, il n’existe pas d’objets esthétiques mais uniquement une conduite esthétique qui investit des objets quelconques. Il n’y a pas non plus de scission entre une « connaissance sensible », apanage d’instinctifs illuminés et une « connaissance cognitive » qui serait le lot des intellectuels besogneux. En résumant on retiendra que l’œuvre propose et l’observateur dispose : il comprend, il apprécie en fonction de sa culture, de ses compétences et de sa créativité herméneutique. Parce que la compréhension d’une œuvre d’art, disait Bertolt Brecht, est aussi une forme de travail. Tandis que pour ceux qui entrent en art comme d’autres en religion, le beau ne se discute pas, le beau a toujours raison ; pour le public, qu’il advienne ce que le beau, ce que l’art commande. Jean Dubuffet écrivait en mai 1968 (tiens donc !) dans le pamphlet Asphyxiante culture : « Beau vient en droite ligne du chant des anges, du buisson ardent dont le professeur Chastel, en robe étoilée, révèle à la Sorbonne, entouré de ses servants, le dogme inaltérable (avec la férule). » Le beau contre la science ?
L’étrange, à la lisière entre le beau et le laid
Bruno Marchand
En savoir +« Pour que vous aimiez quelque chose il faut que vous l’ayez vu et entendu depuis longtemps, tas d’idiots. » Cette déclaration de Francis Picabia datant de 1920, écrite en lettres capitales sur une pancarte portée par André Breton transformé pour l’occasion en homme-sandwich, questionne le rôle joué par la familiarité dans l’appréciation d’une œuvre. Cette affirmation peut-elle être rapportée aux notions de beauté et de laideur ?
On aurait ainsi tendance à considérer qu’une œuvre est belle ou laide en fonction du degré de familiarité de son image ou, selon un autre point de vue et dans le champ architectural, si ses traits formels et stylistiques sont conformes aux codes habituels et partagés ; en d’autres termes, si on peut y reconnaître les lois de l’harmonie et de proportion, ces « vérités réconfortantes » comme les désignait Le Corbusier.
Mais cette question de la familiarité nous oriente aussi vers la notion de l’étrange et vers des objets qui, justement, ne nous apparaissent pas familiers ; des objets dont le caractère singulier confère des impressions inhabituelles et insolites, des objets que l’on pourrait situer à lisière entre le beau et le laid.
L’exposé s’attachera à tisser des liens théoriques entre ces notions, notamment à travers l’analyse de l’œuvre récente de l’architecte suisse Valerio Olgiati, en particulier le Weber Auditorium Plantahof réalisé à Landquart en 2010, près de Coire.
Regarder voir
Olivier Gahinet
En savoir +En 1886, dans Par-delà le bien et le mal, Nietzsche écrit : « Voilà qui est fâcheux ! C’est toujours la vieille histoire ! Lorsque l’on a fini de se bâtir sa maison, on s’aperçoit soudain qu’en la bâtissant on a appris quelque chose qu’on aurait dû savoir avant de… commencer. L’éternel et douloureux “trop tard !”. La mélancolie de tout achèvement ! »
L’architecte, lui, anticipe. C’est son métier : il projette. C’est ce que fait, en 1914, Charles-Édouard Jeanneret (né un an après la publication du texte de Nietzsche) quand il invente un système d’ossature en béton qui doit permettre la construction en série de maisons à bon marché. Cette ossature – qu’il a baptisée Dom-ino – sera publiée en 1930, début du premier tome de son Œuvre complète. Celui qui est devenu Le Corbusier écrit alors qu’elle aura attendu quinze ans pour se voir utilisée, dans le projet des maisons dites « Loucheur » (1929).
En réalité, le schéma de cette ossature, ce dessin qui ouvre le premier tome de l’Œuvre complète et va connaître une immense fortune critique parmi les historiens de l’architecture, représente pour tous les projets puristes « ce qu’il faut savoir avant de commencer », pour reprendre les termes de Nietzsche. On va voir que, si les projets puristes explorent les thèmes posés par Dom-ino, cela va bien au-delà de l’ossature ; il faudra longtemps à Le Corbusier pour en faire le tour, et ce n’est qu’après la Seconde Guerre mondiale, à la villa Shodhan, qu’il en sortira, littéralement, par le haut. Entre-temps, il aura montré comment un architecte peut regarder ses propres projets et, surtout, les voir.
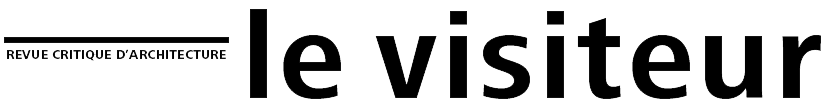


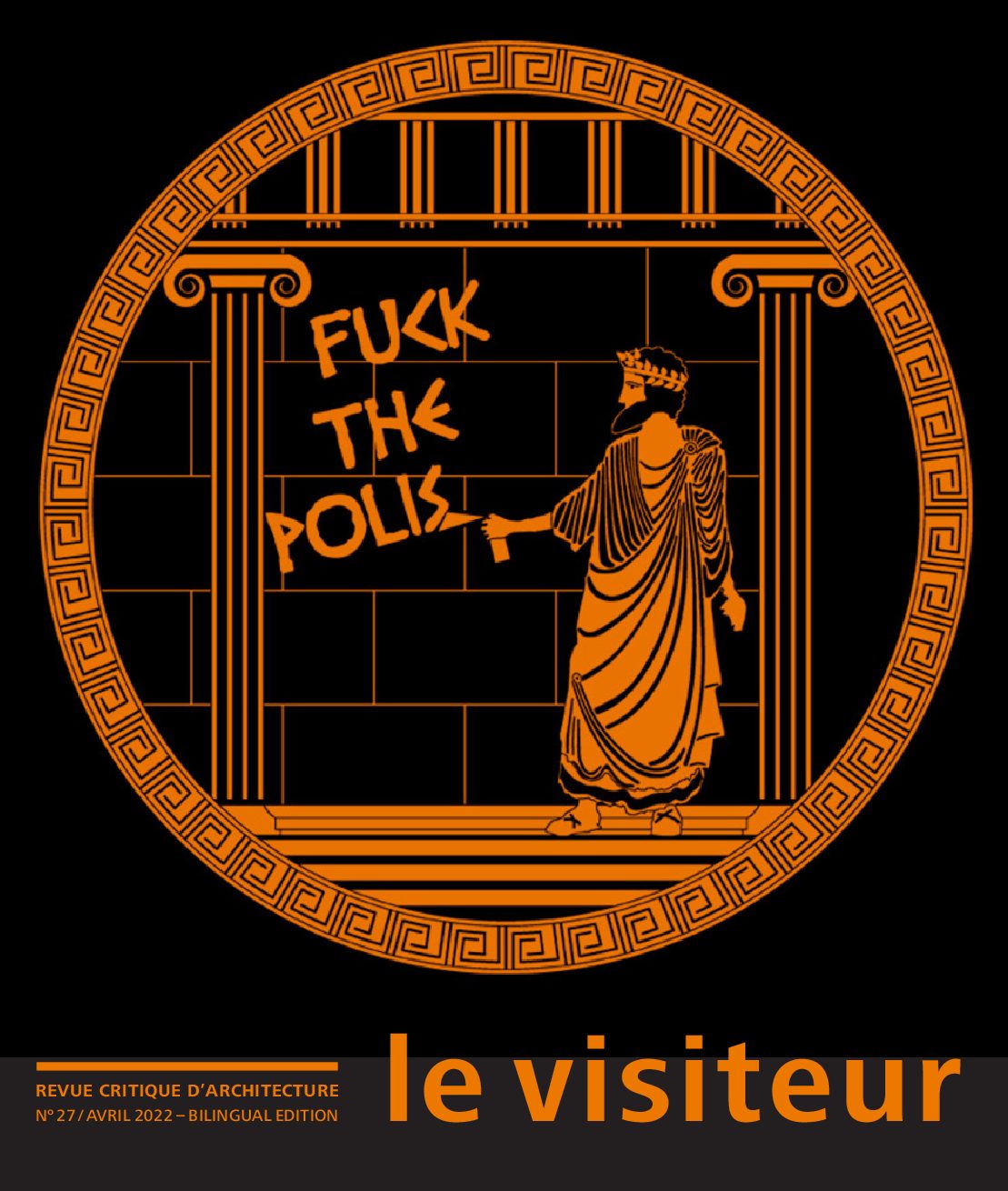


























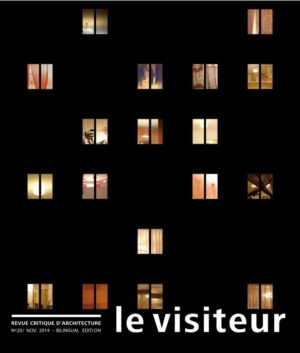
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.