Description
Date de publication: 2011
Éditorial
Karim Basbous
AfficherLe territoire est au cœur de ce seizième numéro du Visiteur : nous consacrons un dossier à l’œuvre de Luigi Snozzi dans le village tessinois de Monte Carasso, et nous poursuivons la publication d’une série d’articles issus du colloque « Le territoire dans tous ses états », organisé par la Société française des architectes et le CNRS[1].
L’« urbanisme » est aujourd’hui une pratique souvent détachée du projet, qui se contente de codifier l’occupation du territoire d’une manière générique, sans regarder les lieux dans leur spécificité. Le travail de Luigi Snozzi défend, à l’inverse, une réglementation empirique, conçue comme un ensemble d’exceptions propres à chaque situation. En ce sens, il renoue avec ce qu’on appelait au siècle des Lumières l’« embellissement des villes », et nous rappelle cette époque où la règle du droit et le réglage du dessin d’un centre urbain entretenaient un rapport de complicité.
Monte Carasso n’aurait été qu’un bourg comme tant d’autres si la rencontre, en 1978, entre Luigi Snozzi et le maire Flavio Guidotti ne lui avait réservé un destin particulier ; l’aventure est, aussi, politique.
À Monte Carasso, Luigi Snozzi déjoue les écueils qui réduisent généralement la portée du projet architectural et urbain : face au patrimoine – en l’occurrence, un couvent de la Renaissance –, il se montre davantage progressiste que conservateur : il transforme l’édifice autant qu’il le réhabilite. À l’uniformité des grilles juridiques du droit de la construction, il oppose une surprenante règle topique. Celle-ci ne précède pas la conception mais se fonde, a posteriori, sur la solution architecturale. Car pour Luigi Snozzi, le projet est le commencement, et la règle, un provisoire aboutissement. Chaque intervention retrouve ainsi une liberté que la normalisation lui confisque habituellement. Luigi Snozzi responsabilise le projet : la plus petite parcelle prend en charge le territoire, et les règles qu’il invente pour la ville ne sont pas des textes à appliquer, mais des principes à interpréter. Enfin, Luigi Snozzi travaille sur le long terme : Monte Carasso est le fruit d’un travail de trente ans. Trente années pendant lesquelles s’est construit, entre l’architecte, le maire et l’habitant, un peu de ce « lien social » dont on regrette aujourd’hui la dégradation généralisée dans nos sociétés.
Luigi Snozzi lui-même raconte, sur un ton qui associe l’humour à la provocation, l’expérimentation architecturale et administrative de cette opération. Judith Rotbart et Laurent Salomon, Fabio Merlini et Pierre-Alain Croset dégagent ensuite la singularité territoriale, urbanistique et politique que représente « le cas Monte Carasso ».
Tous les territoires n’ont pas le privilège de faire l’objet d’un travail aussi abouti que ceux sur lesquels travaille Luigi Snozzi. Dans son article, Ruth Marques retrace les moments clés de l’évolution de la ville européenne. Au croisement d’une lecture économique, politique et esthétique du territoire français au cours du XXe siècle, elle montre la violence faite à l’idée même de lieu, avant d’en exposer le possible retour.
Le territoire sur lequel se penche Philippe Potié n’est pas celui que l’on occupe physiquement, mais celui qui se construit dans l’inconscient collectif. L’auteur analyse les dispositifs de regard et de récit que convoque New York délire pour révéler la fiction urbaine fondatrice de l’« effet Manhattan ». Les trois derniers textes explorent chacun un aspect de la violence urbaine : trois violences qui rapprochent, elles aussi, des territoires très différents : violence de la planification pour Yves Pedrazzini, violence des guerres asymétriques pour Saskia Sassen, et violence des dispositifs de surveillance pour Rémi Baudouï.
Enfin, Le Visiteur est heureux d’accueillir un texte de Martine Dassault qui fait ressortir la dramaturgie de l’espace architectural du couvent de la Tourette, et l’oppose à « l’innocence » de la chapelle de Ronchamp. L’auteur confronte chacun de ces deux édifices avec son double en peinture, dans un saisissant parallèle dont nous laisserons la surprise au lecteur.
[1] Colloque « Le territoire dans tous ses états », organisé par la Société française des architectes et le CNRS, les 13 et 14 novembre 2009, avec le soutien de l’université Paris-Est Marne-la-Vallée et de l’Urbaine de travaux.
Monte Carasso : à la recherche d’un centre
Luigi Snozzi
En savoir +Menée en étroite concertation avec les autorités communales de Monte Carasso et la population, cette expérience représente une alternative à la planification basée sur le zoning. Le projet propose un nouveau centre pour le village, de densifier le village et de contrôler spatialement les espaces publics, en réduisant les quelque 250 règles de constructions précédemment en vigueur, au nombre de 7.
Le territoire, le maire et l’architecte
Judith Rotbart et Laurent Salomon
En savoir +« Toute idée qui en nous est absolue, autrement dit adéquate et parfaite, est vraie. »
Baruch Spinoza[1]
Début de l’article…
Cela remonte à la nuit des temps, ou au moins à la sienne : l’architecte dispose d’une compétence qui lui permet de lire le site, d’en imaginer la transformation, de l’envisager comme lieu à venir dès lors que le projet l’aura transformé. Le territoire est le sujet de sa réflexion, de son investigation méticuleuse avant tout comme préalable nécessaire à une édification future. Ce territoire est pour l’architecte un sujet qu’il étudie afin de servir l’identification d’une population, d’accompagner l’élaboration d’un projet social. De son côté, le politique pense le territoire comme l’aire de son pouvoir. Il l’aménage. Il pense dédier des lieux aux activités humaines ou économiques, mais ne leur attribue que des endroits, des places disponibles. Sa vision du territoire ne comporte aucune forme, elle semble même en fuir le présage. Elle est une abstraction, et non cette conquête à venir qu’observait Alexandre depuis le haut des montagnes, afin de la décrypter ; ou cette étendue qu’on découvre quand on la survole tel un oiseau[2]. Ainsi, l’architecte appréhende le territoire essentiellement dans le but d’y construire, le politique le comprend avant tout pour y déployer son action. Ce sont là deux rudes principes de réalité auxquels Monte Carasso nous semble cependant avoir échappé.
[1] « Omnis idea, quae in nobis est absoluta, sive adaequata et perfecta, vera est. » Baruch Spinoza, Éthique, II, prop. 34.
[2] « Par la vue d’oiseau, une novation d’importance est apportée dans le comportement de l’esprit : vue en clair – en plan – classée : le plan est détaillé suprêmement (lecture à deux dimensions), […]. Désormais, une grande part des confusions dues au simple fait que les yeux de l’homme sont à 1,60 mètre au-dessus du sol se résolvent par une lecture sans ambiguïté. Ce qui permet « de voir les choses d’en haut », aspirations constantes des constructeurs de bâtisses ou d’idées, est passé désormais dans la réalité tangible. » Le Corbusier, Les Trois Établissements humains, Paris, éditions de Minuit, 1959, p. 138.
Le logos architecte
Fabio Merlini
En savoir +Structure du texte…
De l’enchantement du temps au désenchantement de l’espace.
L’espace à l’épreuve de la modernité
Appel à la résistance : pour une « valorisation éthique de l’espace »
Luigi Snozzi et Monte Carasso : expérimenter la longue durée
Pierre-Alain Croset
En savoir +Début de l’article…
Monte Carasso constitue un lieu unique dans le paysage de l’expérimentation architecturale et urbanistique de la fin du XXe siècle. Unique en premier lieu pour l’exceptionnelle durée temporelle de cette expérience : quand Luigi Snozzi fut contacté en 1979 par les autorités communales, jamais il n’aurait imaginé trouver dans cette toute petite communauté un terrain aussi fertile, au point de lui permettre de travailler pendant plus de trente ans aux côtés de l’infatigable maire Flavio Guidotti. Snozzi trouva pour la première fois à Monte Carasso l’occasion de mettre en pratique des principes développés dans une riche série de « contre-projets » qui avaient remis en cause – parfois de façon fortement polémique – les relations entre le projet architectural et la planification urbanistique. Critique audacieuse de l’urbanisme « officiel », ces contre-projets ont dénoncé la manière habituelle des autorités publiques de choisir l’emplacement des équipements publics. Les alternatives d’implantation qu’ils proposaient, pour défendre une relation plus forte entre l’édifice et le territoire, leur ont valu d’être considérés « hors concours ». Cette « guérilla urbaine » qu’il a menée apparaît manifeste dans ses projets pour un quartier résidentiel à Celerina (1973), et surtout pour la nouvelle gare de Zurich (1978, avec Mario Botta). Comme l’explique fort bien Snozzi lui-même, la commune de Monte Carasso n’aurait jamais accepté de remettre en question des décisions déjà prises – en l’occurrence l’emplacement de la nouvelle école en périphérie – sans le courage politique des autorités. Ce courage a su convaincre : par la suite, le maire Guidotti fut continuellement réélu. À Monte Carasso, un rapport de confiance entre un architecte, un homme politique et une population s’est construit patiemment ; un cas tout à fait unique où une architecture apparemment « d’avant-garde » parvient à pénétrer profondément un tissu social.
Témoignage
Paulo Mendes da Rocha
En savoir +Début de l’article…
J’ai connu Luigi Snozzi lors d’une réunion internationale organisée par l’université catholique bolivarienne, en Colombie. Plusieurs architectes étaient venus des quatre coins du monde, parmi lesquels Jo Coenen et Luigi Snozzi.
Avant la réunion proprement dite, l’université avait prévu une excursion pour tous les invités, dans la ville extraordinaire de Carthagène des Indes. C’est au cours de cette promenade fort agréable dans la baie et la ville fortifiée, que nous eûmes l’occasion de nouer une grande amitié, bien avant que je ne connaisse son œuvre.
New York, le nègre et le schizophrène
Philippe Potié
En savoir +En prenant pour guide les figures du « nègre » et du « schizophrène », les héros de New York délire, on tentera de cerner la manière dont l’imaginaire du projet s’empare de la mégalopole. On mettra en évidence les opérateurs de fiction qui ont permis de construire, à travers des « jeux d’espace » aurait dit Louis Marin, une topologie qui trame la « théorie rétroactive de Manhattan ». Moins que les concepts de congestion ou de lobotomie qui semblent tenir le devant polémique de la scène, on insistera sur le travail des figures qui constituent les ressorts efficaces d’une « technologies du fantasme » permettant de se saisir de l’échelle délirante de la mégalopole.
La ville en trois ruptures
Réquisitoire contre un non-lieu [1]
Ruth Marques
En savoir +Début de l’article…
« Comment la France est devenue moche »
Ce titre d’un article paru dans Télérama[2] en février 2010 m’a rappelé une question que je m’étais posée il y a sept ou huit ans, à l’occasion d’un périple en Bourgogne : émerveillée par les magnificences conjuguées du patrimoine bâti et du paysage viticole, j’ai soudain trouvé insoutenable la si banale disgrâce du périurbain. Je suis rentrée de ce voyage éblouie, mais en deuil aussi de cette ville qu’apparemment nous ne savions plus fabriquer. Cela se passait à une époque où un débat plus idéologique que technique opposait adversaires acharnés de toute forme d’« étalement urbain » et partisans fervents d’un nouveau French dream, celui d’une « ville émergente ». Et je me trouvais, par mes fonctions[3], au cœur de cette petite guerre.
Les villes devaient-elles donc cesser de croître ? Et, d’ailleurs, de quelle ville parlait-on ?
[1] Cet article reprend des éléments d’un propos paru dans La Pierre d’angle, n°049/050, actes du colloque de décembre 2008, « Aménagement durable et patrimoine », publié par l’Association nationale des architectes des bâtiments de France, mai 2009.
[2] Télérama, n°3135, 16 février 2010, article de Xavier de Jarcy et Vincent Rémy.
[3] Chef des missions aménagement durable et mobilité urbaine à la DGUHC, ministère de l’Équipement.
Violences urbaines, violence de l’urbanisation et urbanisme de la peur
Dialectique destructive de l’environnement construit
Yves Pedrazzini
En savoir +Au Nord comme au Sud, les habitants des périphéries répondent parfois violemment à des « projets urbains » opposés à toute volonté de cohésion territoriale, fragmentation spatiale et division sociale s’étant imposées comme modèles. La violence des villes est celle de la planification urbaine et du Plan comme idéologie libérale – c’est-à-dire capitaliste. Qualifier de violences urbaines des tactiques de résistance spatiale de populations urbanistiquement reléguées est une ruse de l’État. Les réponses que les pouvoirs publics (en accord avec des acteurs privés ayant prouvé leur aptitude à dépecer et ruiner les villes, aussi formellement) donnent aux « violences urbaines » postulent la responsabilisation des victimes de l’urbanisation.
Ces réponses consistent à renforcer les barrières architecturales qui défendent les « territoires de paix », c’est-à-dire à les protéger contre l’« horizon de violence » des exclus.
Des architectes et des urbanistes pensent l’espace comme des policiers. Les communautés fermées sont à la mode, un urbanisme de la peur spatialise un mépris des pauvres, désormais criminalisés et parqués. Les villes sont des archipels d’îlots sécurisés et hantés par la peur de l’Autre, la peur des lieux de l’Autre. Il s’agit du projet urbain de notre temps. Le lien social est pris dans les malls, imitation triste et clinquante des anciens espaces publics dont on craint de prolonger la publicité. L’incertitude essentielle de la ville moderne a entraîné son hyper sécurisation.
Ville ouverte : au-delà des guerres asymétriques et de la violence environnementale
Saskia Sassen
En savoir +Début de l’article…
Depuis longtemps lieux de conflits – guerres, racismes, haines religieuses –, les villes ont eu tendance à désamorcer ces sources de tensions par le biais du commerce et de pratiques civiques, à la différence des États nationaux qui ont traditionnellement opté pour la confrontation militaire. Ainsi, la résorption des conflits urbains a favorisé l’épanouissement de la vie citoyenne dans les villes. Aujourd’hui, ces dernières perdent progressivement cette compétence et affrontent de nouveaux types de violences tels que la guerre asymétrique ou le « nettoyage » ethnique et social. De plus, ces espaces urbains à forte densité de population, générateurs de tensions et accablés par les inégalités et l’injustice, voient naître d’autres conflits secondaires, anomiques, tels que les guerres de la drogue ou les catastrophes environnementales majeures qui menacent notre futur proche. Ces conflits d’un genre nouveau remettent en cause les compétences commerciales et civiques traditionnelles des villes qui leur ont permis de maintenir la paix et d’intégrer la diversité sociale, culturelle, religieuse et ethnique.
L’instabilité de l’ordre urbain participe d’une désarticulation plus générale des logiques organisationnelles existantes, laquelle met elle-même en danger la logique qui a associé territoire, autorité et droits dans le schéma organisationnel dominant de notre époque : l’État-nation[1]. Ce phénomène survient alors même que les États nationaux et les villes restent des marqueurs essentiels du paysage géopolitique et de l’organisation matérielle du territoire. Par exemple, l’ordre urbain qui a présidé à la création de la « ville ouverte[2] » en Europe perdure encore, tout en devenant purement visuel et de moins en moins social.
[1] Le paysage émergent dont il est question ici favorise une multiplication de divers cadres spatio-temporels et minisystèmes normatifs là où la logique dominante tendait autrefois à produire de grands cadres unitaires nationaux, spatio-temporels et normatifs (voir Saskia Sassen, Territory, Authority, Rights : From Medieval to Global Assemblages, Princeton, Princeton University Press, 2008, a, chap. 8 et 9). Cette prolifération de systèmes spécialisés s’étend même à l’intérieur de l’appareil d’État. Je démontre qu’il n’est plus possible de parler de « l’État », et de « l’État national » opposé à « l’ordre mondial ». Il existe un nouveau type de segmentation au sein de l’appareil d’État, avec un organe gouvernemental de plus en plus fort et privatisé aligné sur des acteurs mondiaux précis, et une vacuité de la législation dont l’efficacité risque de se confiner à des affaires principalement intérieures, et de moins en moins nombreuses (voir Sassen, ibid., chap. 4).
[2] On entend par là une ville où les espaces créés pour la représentation bourgeoise servent également à la formation du sens civique de tous (NDLR).
Panoptique sécuritaire
De l’actualité de Michel Foucault
Rémi Baudouï
En savoir +Depuis une vingtaine d’années, la montée en puissance des politiques de sécurité urbaine s’est caractérisée par une inversion de paradigme. Autant dans la déclaration de 1789 la liberté fut fondatrice du principe de sécurité et d’égalité, autant aujourd’hui c’est le principe de sécurité qui fonde la liberté. Ce bouleversement conceptuel encourage l’idéologie techno-sécuritaire qui affecte notre environnement quotidien et touche l’espace public. À destination des architectes, urbanistes et maîtres d’ouvrage, la prévention situationnelle se définit comme la science de l’aménagement sécuritaire de l’espace construit. Par un saut de près de deux siècles, la « ville panoptique » d’aujourd’hui semble parachever le système du panoptique conceptualisé par Jeremy Bentham. Cette conférence examinera à la fois l’étendue, les mutations et les limites atteintes aujourd’hui dans la mise en œuvre d’une sécurité urbaine à l’échelle de la nouvelle « ville panoptique ». Il interrogera en quoi les catégories foucaldiennes sur le pouvoir, les normes, le biopouvoir ou encore l’enfermement demeurent plus que jamais pertinentes pour saisir et comprendre la nature des mutations sécuritaires dans lesquelles nous sommes aujourd’hui entrés dans le gouvernement des villes.
De la Tourette à Ronchamp : guerre et paix
Martine Dassault
En savoir +« Il faut réveiller les gens.
Bouleverser leur façon d’identifier les choses.
Il faudrait créer des images inacceptables.
Que les gens écument.
Les forcer à comprendre qu’ils vivent dans un drôle de monde.
Un monde pas rassurant.
Un monde pas comme ils croient. »
Pablo Picasso[1]
Début de l’article…
J’appris un jour qu’il n’était pas impossible de loger une nuit au couvent de La Tourette. Le mystique rejoignait le mythique. J’allais passer toute une nuit dans le saint des saints, méditer, rêver, toutes aspirations confondues, j’allais vivre, entre ombre et lumière, l’expérience du sacré. Je partais voir Corbu chez Dieu, sans me douter que j’allais croiser ici bien autre chose que douce sérénité. Mon esprit et mes sens déroutés, mon attente serait pour le moins troublée.
(…)
Mon bagage posé à l’étage supérieur, je décidai, quitte à me perdre, de fuir l’étroitesse glaçante de ma cellule, et me retrouvai, deux niveaux plus bas, en direction de la chapelle, mais à mesure de ma déambulation, je compris que l’expérience que j’allais vivre serait d’abord sensorielle. Les algorithmes des fameux « pans de verre ondulatoires » de Xenakis délivraient leur partition à plein régime, libérant un tempo qui montait crescendo et rivalisait avec le mien, s’affranchissant de ma cadence et de ma volonté, comme si le phénomène, enclenché par la dynamique pentue de ma promenade, se jouait pourtant malgré moi. « L’architecture se marche[2]. » Les mots se superposaient aux rythmes, aux ombres des lignes projetées sur le sol, aux bruits raréfiés, aux silences amplifiés. Par jeu je m’arrêtai plusieurs fois, et la phrase musicale lancinante, silencieuse mais pourtant sonore, suspendait sa dramaturgie verticale en linéaire, à l’unisson des horizontales où le regard s’accrochait, reprenant en synthèse les empreintes des planches de coffrage du béton, montant en puissance à chaque nouvelle étape. Mon œil communiquait avec mon oreille et délivrait des informations visuelles et sonores de « marteau sans maître » que je ne maîtrisais plus. Une complicité évidente entre les lignes de force verre-béton imposait physiquement son déterminisme accéléré. Il me sembla qu’un nouvel espace était né, étrangement clos et pourtant ouvert, dictant des lois inédites, où les contraires trouvaient moyen de cohabiter en bousculant leurs limites. Ce choix de l’extrême, d’une cinglante radicalité, laissait la place à de nouvelles propositions, des libertés où l’architecture générait sa musique en y obligeant la nature dont on apercevait, par plaques ou par tranches, des plages d’herbes folles et des silhouettes de frondaisons centenaires. « La musique courante s’effondre ; le monde se remplit d’une nouvelle musique : celle des machines et celle des folklores. L’oreille reçoit des nourritures fraîches. La sensibilité est libérée ; elle est comblée de révélations émouvantes[3]. »
[1] Propos sur l’art, Paris, Gallimard, 1998, p. 141.
[2] Le Corbusier, Entretien avec les étudiants des écoles d’architecture, Paris, Minuit, 1957.
[3] Le Corbusier, Quand les cathédrales étaient blanches, Paris, Denoël, 1965, p. 184.
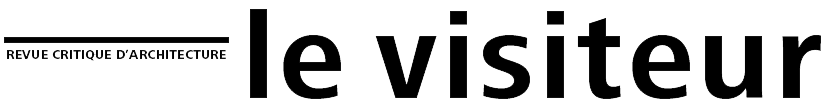



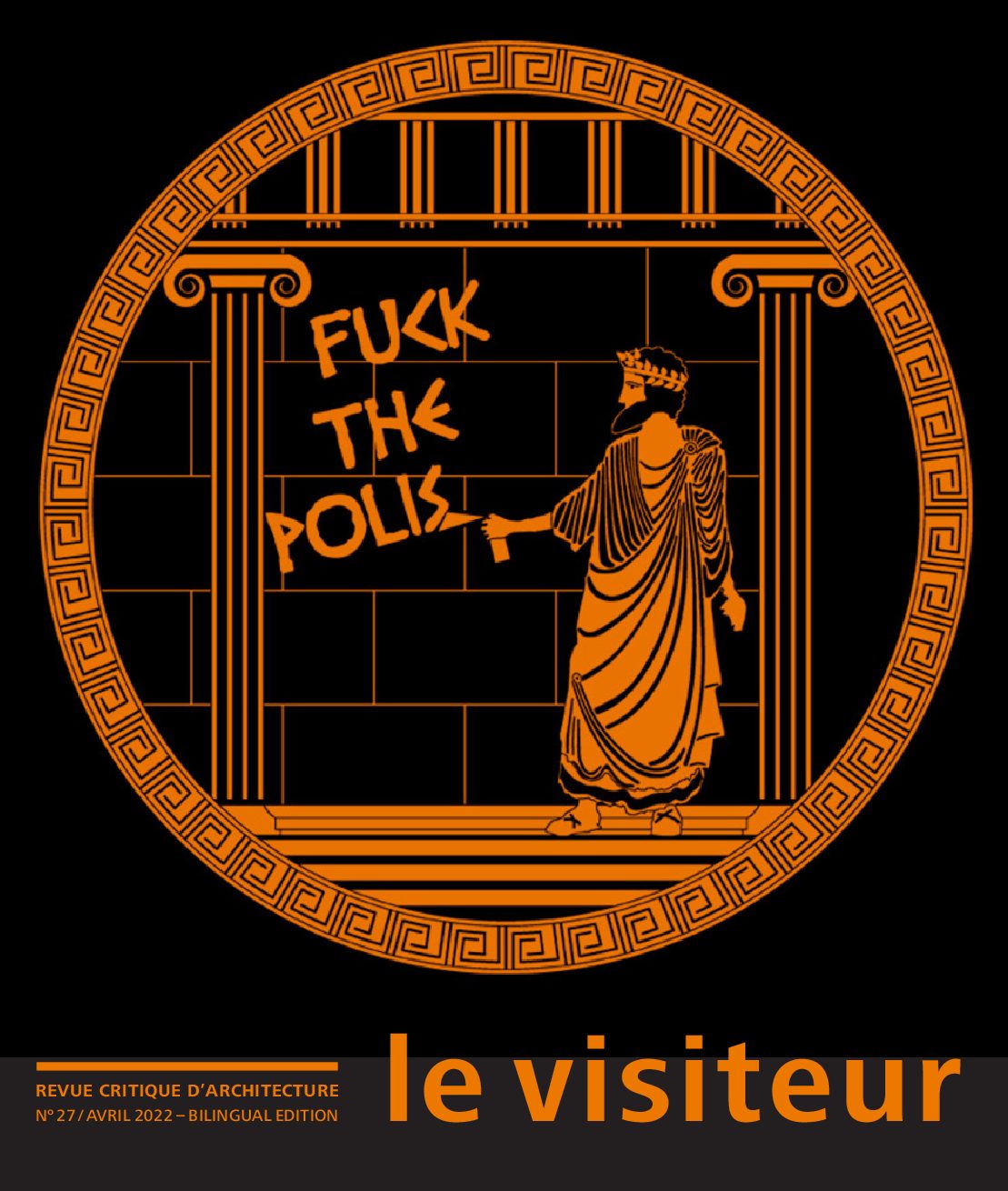


























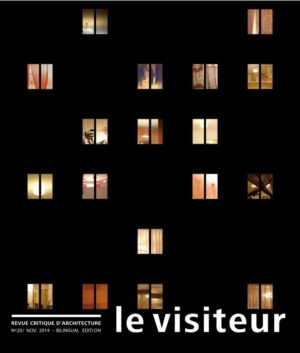
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.