Description
Date de publication: 2009
Éditorial
Karim Basbous
AfficherCe numéro du Visiteur aborde par des biais très divers la question du rôle social de l’architecture. Dans une première partie, nous avons choisi de rendre hommage à deux figures singulières de l’architecture brésilienne : Sérgio Bernardes (1919-2002), et surtout João Filgueiras Lima, dit « Lelé » (né en 1932). Il n’est pas nécessaire de rappeler l’importance des grandes figures de l’architecture brésilienne qui ont marqué la modernité d’après-guerre comme Oscar Niemeyer et Lucio Costa. Avec Bernardes et Lelé, nous découvrons des expériences architecturales qui, pour être moins connues, sont tout aussi décisives.
Alors que les monuments de Brasília traduisent une volonté d’État, les équipements que construit Lelé contribuent, eux, à faire une société. Moins iconiques, plus anonymes, ils sont la démonstration que la générosité du projet ne se limite pas à ce que l’œil peut immédiatement mesurer, apprécier, reconnaître, mais se manifeste aussi dans le processus de production qui précède l’ouvrage.
Au gaspillage des énergies et des capitaux dont l’actualité donne la mesure tragique, à l’errance intellectuelle qui n’a pas épargné la théorie architecturale, au culte de l’arbitraire, à la violence des nouveaux impérialismes financiers, le projet tel qu’il est exposé dans les pages de ce numéro oppose l’économie, entendue comme l’art d’organiser et de gouverner les ressources de l’homme. Ce « bon usage » des richesses, comme on aurait dit autrefois, confère aux choix constructifs une légitimité sociale.
Lelé déplace les limites traditionnelles du projet ; il occupe les champs de l’industrie, du chantier, de la technique, pour transformer l’efficience capitalistique en une efficience écologique et sociale. Jean Prouvé en avait rêvé, Lelé l’a réalisée : l’alliance entre le dessin et l’industrie, afin de concevoir les composants en même temps que leur agencement. Pour lui le dessin ne précède pas le calcul, ni ne s’impose par la seule grâce des figures. L’ambition de Lelé n’est pas de conquérir une gloire d’auteur aux frais de maîtres d’ouvrage vaniteux, mais de rassembler un atelier collectif mêlant recherche expérimentale, projet, construction et pédagogie[1].
Les « tristes tropiques » ont pris leur revanche, et la vieille Europe a de quoi être jalouse de ces continents où l’on fait ; avec un enthousiasme et une liberté qui se font rares depuis que les prêtres du postmodernisme ont désenchanté tout un pan de la discipline, depuis que le poids des discours empêche de penser « en faisant », depuis que la forme architecturale n’est plus cette découverte qui en appelle d’autres, depuis que l’on ne sait plus s’étonner que dans l’extravagant. L’œuvre de Lelé est emplie d’une bienveillance, d’un souci du confort et du plaisir dont nous prive l’architecture qui se livre tout entière au slogan et au cliché.
Dans ce numéro, Lelé – qui produit en silence – laisse la parole aux architectes, historiens et critiques. Le dossier que nous lui consacrons s’ouvre avec le texte de Maria Elisa Costa sur la formation et le parcours de Bernardes et de Lelé, et notamment sur leur rapport à Oscar Niemeyer et Lucio Costa. Judith Rotbart et Laurent Salomon, eux, voient dans l’œuvre de Lelé le contre-exemple de l’évolution récente de la production européenne, en particulier dans son rapport à la construction et au politique. André Corrêa do Lago relève dans l’œuvre de Lelé l’expression d’une condition culturelle brésilienne qui s’est constituée en maintenant une certaine distance vis-à-vis des théories de l’Europe nourricière. Hugo Segawa et Ana Gabriella Lima Guimarães, comme Ana Luiza Nobre, nous éclairent sur les recherches techniques de Lelé, et commentent l’aventure du réseau Sarah qui a réinventé l’environnement hospitalier dans ses aspects constructifs et sociaux. Cláudia Estrela Porto présente quelques villas de Lelé, une production à la fois typique et singulière de l’architecte. Elles commencent habituellement avec le croquis d’une coupe donnant lieu à une superstructure puissante qui donne l’échelle, et sur laquelle s’appuie toute l’organisation du programme. Dans ces maisons, la structure n’est pas dissociée de l’espace ; elle forme un dispositif habitable en lui-même, duquel se dégage la spatialité de l’édifice. Dans cette architecture où le gros-œuvre fait tout, les maisons sont des ponts, des portiques, des basiliques ou des halles.
Lauro Cavalcanti retrace, lui, le parcours de Sérgio Bernardes qui a précédé Lelé dans l’expérimentation constructive.
La seconde partie du Visiteur revient sur des débats plus familiers aux lecteurs européens. Georges Teyssot et Olivier Jacques étudient l’usage des logiciels à l’œuvre dans le projet Metropol Parasol de Jürgen Mayer H. (actuellement en chantier à Séville) où sont expérimentées de nouvelles réponses au programme, au site, et à l’usage de l’espace public.
Olivier Gahinet se penche sur le « cas Rem Koolhaas » : son discours, son rapport aux critiques, aux clients, et surtout ses bâtiments. Certains lecteurs y verront un pamphlet avant même de le lire, d’autres reconnaîtront, entre les lignes, la défense de valeurs sociales qui ne doivent pas être réservées au Brésil.
[1] Tels sont les objectifs de l’Institut brésilien de la technologie de l’habitat qu’il vient de fonder.
Outros caminhos
Maria Elisa Costa
En savoir +Début de l’article…
Penser le Mouvement moderne dans l’architecture du Brésil demande de faire retour à ses origines. Dans les années 1920, l’architecture éclectique s’impose partout, avec une totale liberté dans le choix du meilleur style pour « habiller » des structures autonomes, débarrassées désormais de la contrainte des murs grâce aux nouvelles techniques de construction. Un mouvement dit « néocolonial » fait alors son apparition au Brésil.
Le rêve d’Imhotep
Judith Rotbart et Laurent Salomon
En savoir +Début de l’article…
Le temps où Imhotep organisait la taille des pierres dans les carrières du Nil pour construire son œuvre de Karnak est révolu. Cette idée d’une architecture dont le créateur contrôlerait le processus de réalisation depuis la production des matériaux jusqu’à leur mise en œuvre est difficilement compatible avec une conception industrielle de la production du bâtiment ainsi qu’avec une conception doctrinaire de la division du travail[1]. De plus, le temps présent privilégie des architectures sans liens directs avec les processus économiques, consommatrices de technologies de pointe et faisant, par l’image, l’apologie de toutes les formes de pouvoir. On y trouve des techniques de pointe empruntées au champ des applications mathématiques pour définir ces formes considérées comme nouvelles ; on y trouve aussi les matériaux de pointe, voire des matériaux courants employés de façon insolite. Cette situation crée une césure exacerbée entre un créer visant à générer l’image, et un construire assigné à la concrétiser, coûte que coûte. Si l’on est favorable à ce type de projet architectural, on y voit une posture critique dénonçant les modes de production conventionnels qui ne répondent plus aux attentes des commanditaires, ceux-ci réclamant de se promouvoir par l’image. Comme s’il incombait naturellement à l’architecture (ou à l’architecte) de satisfaire un tel besoin. Si en revanche on s’y oppose, c’est pour dénoncer une séparation radicale entre le domaine créatif et le domaine social, puisqu’une des conséquences premières de ces nouvelles approches conceptuelles « sophistiquées » est le coût des constructions qui en résulte, très éloigné des budgets dévolus aux constructions courantes.
[1] En septembre 2008, Lelé présente son travail à la Biennale d’architecture de Colombie, à Carthagène. Devant 2000 architectes et étudiants de toute l’Amérique du Sud, il commente ses œuvres et les croquis qui en divulguent la genèse. À qui l’approche, il remet une carte de visite « Directeur technique du Centre de technologie du réseau Sarah », usine inventée par lui pour développer le projet des établissements médicaux du docteur Aloysio Campos da Paz. Sur cette carte ne figure même pas son titre d’architecte.
Heroi desconhecido
André Corrêa do Lago
En savoir +Début de l’article…
L’architecture de Lelé[1] est souvent liée à celle d’Oscar Niemeyer[2] ; pas seulement en raison de l’influence du maître sur l’architecture brésilienne de façon générale, mais surtout du fait que le jeune Lelé commence sa carrière à Brasília au tout début de la construction de la nouvelle capitale, au moment même où les premières structures de Niemeyer s’élèvent au cœur du cerrado[3] comme une promesse d’avenir et de modernité pour le pays. De plus, les affinités idéologiques entre les deux architectes ne doivent pas être négligées : leurs convictions sont à gauche, et leur rêve de changer le monde donne une force supplémentaire à leur proximité intellectuelle. Cet idéalisme explique en grande partie pourquoi aucun des deux n’a cédé aux tentations de la révision du modernisme dans les années 1970 et 1980. Ce qui caractérise le postmodernisme, comme le rappelle Olivier Gahinet, c’est son refus de changer la société[4]. Lelé et Niemeyer, eux, n’ont jamais abdiqué cette volonté.
[1] João Filguieiras Lima, né en 1932.
[2] Né en 1907.
[3] Il s’agit de la savane brésilienne.
[4] Olivier Gahinet, « Mies et les postmodernes », Le Visiteur n°12, Paris, novembre 2008.
João Filgueiras Lima : l’architecture aux limites
Ana Luiza Nobre
En savoir +Début de l’article…
En dépit de la multiplication des études critiques et historiographiques dédiées à l’architecture de la seconde moitié du XXe siècle, des œuvres de grand intérêt apparues dans les années 1960 et 1970 restent pratiquement inconnues hors de leur pays d’origine. Tel est notamment le cas des projets de João Filgueiras Lima, dit Lelé, né en 1932 à Rio de Janeiro où il obtient son diplôme d’architecte, mais dont la formation s’effectuera, de fait, sur les chantiers de Brasília.
Comment présenter aujourd’hui l’œuvre de cet architecte presque octogénaire qui a gardé pour nom le sobriquet de son enfance[1] ? On pourrait commencer évidemment avec Brasília. Inaugurée en 1960, la nouvelle capitale du Brésil est réalisée à partir du plan urbanistique de Lucio Costa et des projets architecturaux conçus, pour l’essentiel, par Oscar Niemeyer. On pourrait aussi rapprocher son œuvre d’autres, également singulières, nées au confluent de l’architecture, du design et du bâtiment, comme celle de Jean Prouvé. De toutes les façons, il faut le souligner, la production de Lelé est exceptionnelle. Exceptionnelle aussi bien pour l’Amérique latine que pour le reste du monde parce qu’elle dénote une grande maîtrise des techniques constructives et de la logique industrielle en même temps qu’une claire conscience des problèmes environnementaux et culturels du moment, sans jamais verser dans la rhétorique de la haute technologie ou du « développement durable ».
[1] Lelé est un terme argotique qui signifie fou, insensé.
Les maisons de l’amitié
Cláudia Estrela Porto
En savoir +Les quelques résidences conçues par Lelé, « les maisons d’amis », comme il les baptise lui-même, sont moins connues du public mais n’en sont pas moins intéressantes que le reste de son œuvre par l’inventivité, la rigueur technique, l’innovation et la sophistication de structure qui président à leur conception. Toutes, à l’exception d’une seule, ont été dessinées pour des amis – un véritable exercice d’empathie –, pour le plaisir de réaliser le rêve de leur propriétaire. Pour Lelé, une bonne architecture résulte de l’exacte interprétation d’un programme spécifique. Il considère les maisons comme un programme éminemment individuel réalisé pour un client déterminé. Ce n’est qu’en connaissant bien la personne ou en étant son ami que l’architecte saura interpréter et décliner le programme. Dans ce cas, la confiance aidant, l’architecture répond aux désirs du client, ce qui donne un bon projet. Lelé estime que cette relation ne peut être commerciale et refuse tout honoraire pour son travail. Tout est une question d’amitié où l’affectif l’emporte : le seul intérêt qui vaille est de prendre soin de l’ami.
Lelé : le créateur, le constructeur, le contexte
Hugo Segawa et Ana Gabriella Lima Guimarães
En savoir +Début de l’article…
Qui sont les plus éminents architectes brésiliens du tournant de ce siècle ? Outre Oscar Niemeyer, s’il n’était hors concours, nous nommerions volontiers Paulo Mendes da Rocha et João Filgueiras Lima, dit Lelé. Le premier obtient en 2000 une reconnaissance internationale avec le prix Mies van der Rohe pour l’Amérique latine, puis le Pritzker en 2006. Le second ne bénéficie pas d’une aussi grande visibilité médiatique – il ne s’inquiète d’ailleurs pas de la reconnaissance publique[1]. Pourtant, le groupe restreint mais fervent de ses admirateurs en a fait un architecte « culte ».
Mendes da Rocha, quatre-vingt-un ans, et Lelé, soixante-dix-sept ans : deux architectes dans la plénitude de leur art, mais qui représentent deux conceptions très différentes de l’architecture au Brésil.
[1] Il n’existe qu’un seul livre, déjà dépassé : Giancarlo Latorraca (dir.), João Filgueiras Lima, Lelé, São Paulo/Lisbonne, Instituto Lina Bo e P.M. Bardi/Editorial Blau, 1999.
Sérgio Bernardes : moderniser le moderne
Lauro Cavalcanti
En savoir +Début de l’article…
Sérgio Bernardes est né en 1919. Plus jeune que Lucio Costa de dix-sept ans et qu’Oscar Niemeyer de douze, il se distingue comme le meilleur architecte de la seconde génération des modernistes cariocas. Bernardes adopte et adapte la syntaxe de ses aînés pour en faire une langue résolument personnelle mêlant des influences considérées jusqu’alors comme antagoniques. L’architecture de Bernardes procède de l’intérieur vers l’extérieur. Elle privilégie le détail et garde une attitude minimaliste face à l’utilisation de l’espace : dans les constructions du début de sa carrière, l’angle droit règne en maître. Contrairement aux autres architectes cariocas dont le langage découle, initialement, d’un dialogue avec la tradition française corbuséenne, l’architecture de Bernardes entretient, en certains points, une relation plus étroite avec le rationalisme et le minimalisme de Mies van der Rohe. Mais les maisons qu’il réalise dans les années 1950 établissent un dialogue plus mesuré avec la nature environnante. Cette posture s’oppose à celle de Mies dont les espaces vitrés sont tantôt envahis par le paysage (maison Farnsworth), tantôt isolés d’un monde imparfait pour mieux s’ouvrir à l’intérieur. La dialectique visuelle avec le paysage, l’utilisation de matériaux nus pour en explorer la texture naturelle, la prédominance du plan horizontal dans ses compositions le rapprocheraient du langage organique dont Frank Lloyd Wright est le représentant le plus important. Bernardes invente une architecture à la fois organique et rationnelle. Parce qu’il mêle des positions dissemblables, il contribue à discréditer et à rendre inopérante toute approche simpliste de la production architecturale.
Faire parler les algorithmes
Les nuages virtuels du Metropol Parasol (Séville)
Georges Teyssot, avec Olivier Jacques
En savoir +Début de l’article…
À la suite à un concours international remporté durant l’été 2004, le projet de Metropol Parasol par l’agence berlinoise de Jürgen Mayer H. a été sélectionné, offrant une série d’équipements à ériger sur la plaza de la Encarnación, au cœur de la ville historique de Séville, sur un terrain laissé à l’abandon par la destruction du Marché central en 1973[1]. Établissant une canopée, d’éminents parasols aux formes arrondies abritent divers services et créent par leur échelle d’imposantes plateformes sur lesquelles il sera possible de se promener. Dans une entrevue avec l’architecte Jürgen Mayer H., Terence Riley comparait les formes spongieuses du projet à celles de « champignons[2] ». Venant se joindre à l’image promotionnelle d’un parasol géant, les métaphores de protubérances mycologiques sont récurrentes et suggèrent la croissance rapide et spontanée d’une place publique, poussant à la verticale à partir du sol. Cette construction a été aussi présentée sous le terme de « nuage théorique », illustrant ainsi le caractère précaire de la structure, sa fluidité presque surréaliste, alors que l’on est confronté à la nature fluide, voire visqueuse, du bâtiment[3]. Il est question d’une structure conçue à la verticale et d’un programme s’élevant par une succession d’ectoplasmes vaporeux et aériens.
[1] Lancé le 31 octobre 2003, le Concours international d’idées pour le design urbain de la plaza de la Encarnación et de son voisinage fut organisé par la mairie de Séville ; le 16 février 2004, soixante-cinq équipes avaient participé à la première phase du concours ; puis, le 23 avril 2004, les dix équipes sélectionnées pour la phase finale remettaient leurs projets ; parmi les membres du jury international, on comptait Toyo Ito, Jacques Herzog et Alejandro Zaera/Farshid Musahabi (studio FOA). Voir http://www.sevilla.org/encarnacio/eng/inicio.html.
[2] Terence Riley, « Architecture as an Adventure : A conversation with Jürgen Mayer H », I.D. Magazine, vol. 55, n°2, 2008, p.48; Terence Riley, On-site : New Architecture in Spain, New York, The Museum of Modern Art, 2005; Terence (alias Tery) Riley est le précédent responsable de la section architecture du MoMA à New York.
[3] Joseph Cory, « Realizing the Endless : The work of Jürgen Mayer H. and the legacy of Frederick Kiesler », Papers of Surrealism, Issue 5, printemps 2007, p. 1.
L’architecte, le critique et le client
Olivier Gahinet
En savoir +« […] L’architecture hollandaise est encore marrante, encore colorée, encore bon marché, toujours frivole. Et puis quoi d’autre ?
Nous souffrons sérieusement d’être emprisonnés dans cette situation. Nous souffrons de cette absence totale de critique. Nous souffrons de l’incapacité des critiques à analyser ce que nous faisons vraiment, à montrer ce que nous ne faisons pas, ou à suggérer ce que nous devrions faire.
Nous avons besoin de critiques qui soient des partenaires, pas des alliés, et encore moins des représentants de commerce[1]. »
Rem Koolhaas
« Il faut bien se dire que dans cette docte assemblée le dress code tourne autour de Dieu = Corbu, Diable = Koolhaas. Une fois admis ce postulat de dért, on prend beaucoup de plaisir à lire cette revue. »
Archicool, e-lettre n°862, lundi 3 août 2009 (à propos du Visiteur)
Début de l’article…
Rem Koolhaas jouit dans le milieu architectural et au-delà d’une réputation à la fois grande et singulière. Il est au nombre des invités permanents aux petits et grands concours internationaux, et il a publié plusieurs ouvrages qui, tous, ont marqué le public. Il termine à Pékin le chantier d’un des plus grands bâtiments du monde et est, en même temps, le représentant par excellence de l’avant-garde, dont chaque projet est attendu et surprend : ses projets – construits ou non – ont marqué l’histoire de l’architecture contemporaine depuis trente ans.
Tous ses collègues, même les plus heureux en termes de réputation et de clientèle, ne jouissent pas de la même aura d’unanimité : nous connaissons tous certains critiques, certains architectes ou des amateurs qui trouvent que Zaha Hadid, décidément, est une « artiste » qui fait toujours le même bâtiment, en des copies vraiment trop nombreuses et trop indifférentes ; qu’Herzog et de Meuron sont devenus des hommes d’affaires de la vêture ; que Jean Nouvel construit vraiment trop vite, et qu’il ferait mieux de construire mieux ; que tous les quatre devraient laisser rentrer un peu de lumière dans leurs bâtiments. Rem Koolhaas, lui, jouit d’une réputation intacte d’intellectuel et de bâtisseur tout à la fois, une réputation telle que la plupart de ceux qui écrivent sur l’architecture le considèrent comme une référence[2]. Cette unanimité n’est pas en elle-même suspecte : il est possible que Rem Koolhaas soit le très grand architecte décrit par la critique la plus répandue. Mais il est possible que RK soit également un symptôme : celui d’un équilibre nouveau dans le triangle que forment l’architecte, le client et le critique, et plus largement entre les champs de l’architecture et de l’économie.
[1] Intervention au séminaire « A critical judgement », Delft, décembre 2000 ; paru dans Le Visiteur, n°7, automne 2001 (trad. Sébastien Marot).
[2] Il y a naturellement des exceptions. On peut citer dans la critique française Jean-Claude Garcias (L’Architecture d’aujourd’hui, n°280, avril 1992) et encore écrit-il sur l’urbanisme de RK à Lille. Quand il s’agit d’architecture, de telles critiques sont plus rares : William J.R. Curtis a étrillé certains projets peu médiatisés de l’OMA (et peu montrés par RK lui-même), notamment le projet perdu pour le concours du port de Tanger et le projet lauréat du centre de conférences de Cordoue.
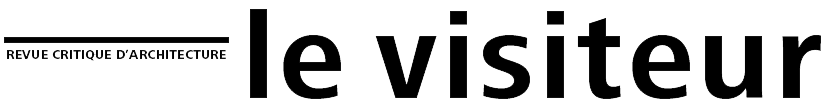



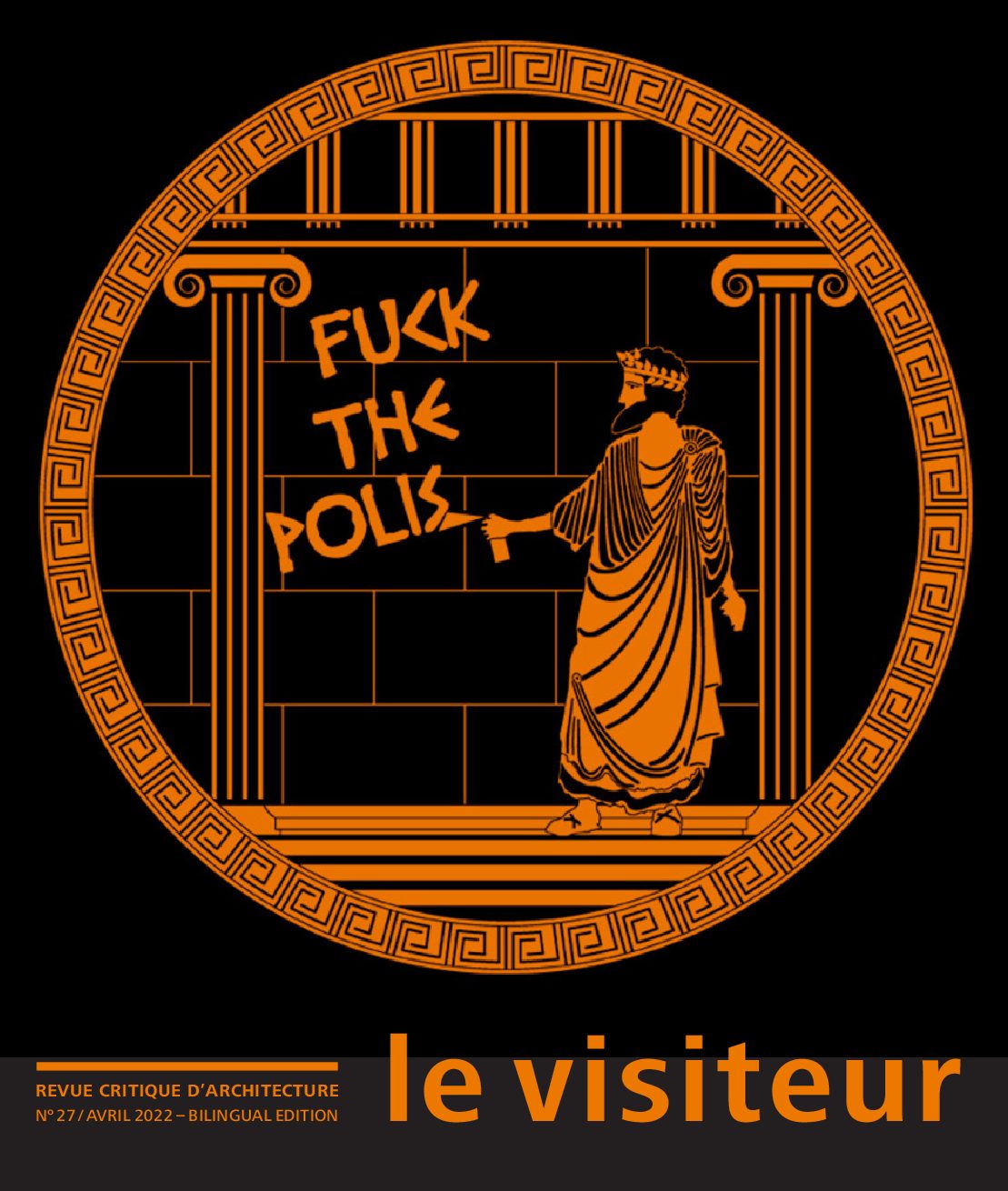


























Avis
Il n’y a pas encore d’avis.